Matt Reeck
***
Je suis intimé d’écrire cela.
Je ne dis pas que c’est dieu qui m’intime.
Non, c’est la langue elle-même.
Il est 3 heures du matin, le 1er décembre.
Je suis à Palerme, en Sicile.
Je me suis levé.
Des souvenirs me viennent.
Je suis fragilisé par ces derniers deux ans. Je suis intact mais susceptible de m’effondrer à la moindre souffrance.
Mon premier souvenir de Paris est la main de ma mère. Ma famille. Mon père avec son appareil photo Minolta. Ma sœur toujours côte à côte avec moi. On avance à pas lourds vers l’Opéra Garnier. Il y a du monde. C’est bruyant. Des voitures. Des camions. Partout. C’est un monde urgent. La pollution s’engouffre dans mes poumons. Même aujourd’hui, quand je sens de l’échappement, mon corps est transporté directement à Paris, à cette époque, et je me sens plus sophistiqué, plus excité par le monde qui m’entoure. Si l’on regarde plus loin, les façades des cathédrales sont émaillées, couvertes d’un vernis noir. À l’époque, personne ne pense au changement climatique, à cet avenir secret.
J’ai huit ans. Neuf ans, peut-être. On habite une petite maison dans la campagne britannique, un « cottage », Mead Close Cottage, aux environs d’Oxford où mon père passe son année sabbatique. On est tous contents. D’être en famille. Oui, c’est avant. Avant l’adolescence. Avant le divorce. Avant le début des divagations de mon père.
Cette année-là, on achète une VW Vanagon, un camping-car, le meilleur du monde, à mon avis. On est sur le périphérique. C’est bouché. C’est l’été. Tout le monde va au sud. Nous, on veut aller aux pays de la Loire. Aux châteaux. On ne bouge plus. Mon père descend de la voiture. Il y a un grand camion à côté avec un autocollant sexiste. La forme d’une femme assise et nue, le dos tout droit, ou plus, en arche, poussant son sein vers le ciel.
J’ai huit ans. Neuf ans, peut-être.
*
Mon attirance pour les langues vient du fait que je veux être différent. Toujours différent. Où suis-je, que suis-je, peu importe : je veux être différent. Je veux être moi en tant qu’un autre.
Deuxième souvenir. Ou troisième. C’est 1990. C’est la rue Saint-Roch. Près de l’Opéra Garnier. On est à l’hôtel. C’est notre voyage autour du monde. Le cadeau de notre père à nous, la dernière fois qu’on aurait l’occasion de voyager ensemble, il nous a dit, et, effectivement, c’est devenu une réalité, même si ce n’était pas pour les mêmes raisons.
L’occasion, c’est la fin des études du lycée de ma sœur. Désormais, notre famille ne peut pas être la même, elle change, naturellement, avec le déplacement de ma sœur. Elle ne sera plus présente, elle commence sa vie à nouveau, à l’université, une petite université avec son allure de cloître, sur une colline dans un état bien loin de nous. Mon deuxième, ou troisième, souvenir de Paris se passe là-bas, à la rue Saint-Roch dans le sous-sol d’un bâtiment où se trouve Monoprix. Quel drôle de supermarché au sous-sol ! Puis, en face de notre hôtel, il y a un kiosque avec des magazines, quelques-uns avec des femmes nues sur leurs couvertures. Dans notre chambre, ma sœur et moi, on regarde des pubs sur la télé. Une femme nue se douche. Ses seins se voient. Ses mamelons.
Je suis jeune. J’ai quinze ans. Seize ans. Tout est nouveau pour moi. C’est la nouveauté qui me frappe, m’attire.
*
Les dates m’échappent. C’est 1987. Stephen Roche gagne le Tour de France. On attend les cyclistes à la rue de Rivoli. On les attend. Puis, soudainement, les vélos passent devant nous. Qui est là ? Roche est là. Il va gagner le Tour. C’est prévu, certain. On est debout, c’est la rue de Rivoli. J’ai quinze ou seize ans. Les dates m’échappent. Non, j’ai juste treize, quatorze ans. C’est une autre visite à Paris.
Non, l’hôtel Saint-Roch n’est pas sale, mais très moche. Dans notre chambre, il y a deux lits. Je me couche dans le lit près des fenêtres. Dans la salle de bains, il y a un bidet. On s’en moque. On se propose de laver nos visages dans le bidet. Notre chambre est grande, mais celle de nos parents est petite. Le lit occupe presque toute la chambre. Le tapis près de la salle de bains reste mouillé tout le temps.
Ma sœur pense toujours à son petit ami. Elle a déjà un petit ami. Moi, non. Je me méfie des autres. Que peut faire un adolescent avec les autres quand il n’est pas sûr de lui-même ? À la fin de l’année 1990, en août, quand on se retrouve encore aux États-Unis, à Tacoma, à la maison de mes grands-parents, cette bizarre maison où l’on doit monter au premier étage pour y entrer, dont le balcon fournit un bon regard sur Mont-Rainier, c’est l’anniversaire de ma sœur, le 13 août. Elle parle à son petit ami à l’appareil. Il annonce son envie de s’en séparer, disant qu’elle vit dans un monde de Barbie qu’il ne partage pas, avec son père, le chef du commissariat, une famille catholique de quatre frères et sœurs, une pauvre famille, mal éduquée. Il ressent le décalage, et il ne l’aime plus.
*
J’ai une bonne mémoire. Peut-être trop. Non, je ne suis pas l’une de ces personnes qui se souviennent de tout. Non, pas comme ça. Si vous me demandez une date au hasard, je ne pourrais pas vous dire le temps qu’il faisait ni ce que je faisais ou ressentais. Mais, en tout cas, j’ai une bonne mémoire. Ça m’aide. Et ma fille de huit ans est comme ça, aussi. Elle nous pose la même question trois fois, puis, claque, la porte se ferme. Les infos, les nouvelles, entrent là-dedans, et elles ne sortent jamais, des otages à l’intérieur de son cerveau.
Ça me plaît, de voir ça en elle.
*
Donnez-moi du temps et je vais vous expliquer.
Ce n’est pas difficile à expliquer mais ça prend du temps.
Même si, je comprends bien, vous n’avez pas le temps. Le temps de m’entendre.
Même si toute l’après-midi, hier, je vous entendais.
Oui, moi-même, j’avais quelque chose à dire sur ce sujet-là, que vous avez si bien et si largement expliqué.
Pendant des heures, je vous entendais.
Je me suis dit, « Ton tour viendra, même toi, Matt. »
Mais mon tour n’est pas venu.
Jamais.
Normalement, j’attends l’occasion où je peux prendre la parole, puis, vite, il y a un changement de ton, de circonstances.
Quelqu’un dit, « Oh là ! »
Quelqu’un dit, « Bref ! »
Et la fin est dépassée. Elle est passée. Croisée. Comme une frontière dure. La fin est déjà au passé.
Soudainement personne n’a plus envie d’entendre. Ni moi, ni personne.
Et c’est ça.
Je retourne à ma chambre.
Je prends le stylo, le crayon, le cahier.
Je passe mon tour en silence, en écrivant, en écrivant à vous, qui ne voulez plus m’entendre.
C’est ça.
Il y a toujours ça.
Je comprends bien.
Ce n’est pas votre faute.
Vous n’êtes pas fautifs.
Vous faites de votre mieux, tout le temps, ou presque.
C’est que je suis trop passif, je dois être plus agressif.
Je dois vraiment prendre la parole, je dois me lever, vous approcher, et claquer la main sur votre bouche.
Pour qu’elle ne bouge plus.
C’est ça.
C’est toujours ça.
Mais je ne suis pas cette personne.
Je retourne à ma chambre.
Ou peut-être n’écris-je pas à vous, mais à moi-même ?
Peut-être c’est ça.
Ça ?
Est-ce vraiment ça ?
Est-ce que mon père ne m’entendait pas quand j’étais petit ? Pas assez, vous comprenez, il n’était pas un diable.
Non, même s’il jouait trop le rôle de dictateur.
Nous, on était un tout petit pays, et lui, le dictateur, parfois bienveillant, plus ou moins bienveillant.
Peut-être c’est ça.
C’est quelque chose à l’intérieur de moi qui aurait dû être réglé.
*
Il est 8h moins le quart, le 1 décembre, à Palerme. Il pleut.
À l’est, ou peut-être c’est l’ouest, je perds mon sens de l’orientation dans cette ville, les nuages de la semaine passée se dispersent.
J’ai encore une heure.
Une heure de silence.
Je vais en profiter.
Un autre souvenir : Je vis avec ma grand-mère. Je ne me rappelle pas si c’est à son nouvelle adresse ou plutôt à l’ancienne maison, celle où l’on entre au premier étage. C’est l’anniversaire de quelqu’un. Probablement, de mon grand-père, dont anniversaire est en août, comme ma sœur.
C’est l’été. Je conduis. Dans la voiture sont mes grands-parents. Mon grand-père à côté de moi, ma grand-mère dans le siège arrière. On traverse le pont Narrows pour accéder l’île à côté de Tacoma. J’aime conduire. C’est un plaisir de contrôler un engin aussi puissant qu’une voiture. On va à la fête. C’est au restaurant d’un petit aéroport. Mon oncle sept ans de plus que mon père est là avec son épouse, ma tante, une femme d’une beauté classique mais assez névrosée à cause de sa mère cruelle. J’ai une photo de la rencontre chez moi, je dois la chercher pour vérifier si quelqu’un d’autre n’y est pas aussi.
Je me sens très éloigné de la scène. J’ai cette capacité, ou cette défaite, où, de temps en temps, même si je suis présent physiquement, je me sens tellement éloigné de la scène que je ne réside plus dans ma chair. C’est ça. Toujours ça. Je me sépare pour me préserver. Mon grand-père n’a pas de volonté. Accablé d’Alzheimer, il vit sans vivre. Il bouge sans bouger. Il me reconnaît, mais en tant que son fils à lui, mon père, ce qui ne me gêne pas, j’aime être reconnu comme le fils de mon père, je suis fier de lui. Il était mon père, il m’aimait, je l’aimais, je le vois régulièrement dans mes rêves.
Mon grand-père ne parle presque plus. Il me dit bonjour, et en disant bonjour à son fils, il sourit, puis il se tait.
Il est une baleine. Un échantillon dans le magasin de curiosités chez Balzac. Un livre que j’aime beaucoup, La peau de chagrin.
Je gère une baleine.
Je l’enlève de la voiture.
Je le guide tout au long du trottoir.
Je l’assieds à la table.
Mais je ne guide pas la fourchette jusqu’à sa bouche. Il le fait en tremblant. La montée de l’assiette jusqu’à sa bouche prend des heures. Ma grand-mère le menace, pensant qu’il est normal.
J’ai vingt-deux, ou vingt-trois ans.
J’imagine que je suis souriant dans la photo. J’ai appris cette formalité. On sourit quand quelqu’un prend notre photo. Mais, à l’intérieur, je suis vide. J’attends. J’attends l’avenir, les choses à venir. J’attends un ailleurs, j’attends de m’échapper à mes arrières, même si je les aime. À l’occasion de la fête, je ressemble à mon grand-père, moyennement vivant, mi-abîmé—lui, dans un état de décroissance, moi, dans un état de croissance.
3 décembre
Ça s’ajoute.
Ça s’améliore.
Après la fin d’une semaine intense, je me suis reposé dans ma chambre. Deux heures s’éclipsaient sans ma connaissance. Je m’étendais sur le lit, le dos en contact avec les draps, avec le matelas. Je ne regardais rien. Puis je me suis conjugué en position de fétus. Je restais comme ça.
Deux heures s’en allaient. Soudainement, j’étais encore prêt à me réincarner. En quoi que ce soit. Comme moi. Comme moi en tant que quelqu’un d’autre.
*
C’est difficile d’être sensible tout le temps. C’est difficile d’être toujours une personne cohérente. Quelqu’un que les autres personnes peuvent reconnaitre … Ah, oui, c’est lui. Il correspond à lui-même. Toujours le même. Un bon gosse. Bien connu. Compréhensible.
Fin de l’après-midi, le port de Palerme. Un petit moment d’ouverture dans une ville où les bâtiments penchent vers le trottoir, où les rues sont étroites et la circulation chaotique. Ici, un grand trottoir pour se balader. Je m’assieds sur une marche, presque tout seul, et mon regard se tourne vers le nord. Je suis au sud de l’Europe, mon regard se tourne vers le nord. Je m’imagine à Oran, à Alger. Il y a une tentation de m’imaginer plus au sud que je suis. Plus loin.
La lumière vive de l’ouest allume les grands bâtiments entourant le port. Puis, tout s’en va. La lumière descend à l’autre côté des nuages, des bâtiments, des collines. C’est l’hiver. Le soleil se couche vite. Les bateaux avec leurs longs mâts. Des palmiers plantés au bord de la promenade donnant à la scène l’apparence de Miami, où je ne suis jamais allé. Les petits bateaux des pêcheurs vides à cette heure-ci. La lune aux cieux, me rappelant qu’il me faut toujours expliquer à ma fille pourquoi de temps en temps on voit la lune pendant la journée. Qu’il me faut toujours apprendre cela.
Demain je pars. Demain soir, je les verrai encore. Elles, dont la présence me soulage tellement.
Moi, fragilisé par ces derniers deux ans. Moi, qui pleure quand je songe trop, ma réalité si hasardeuse, si incertaine, et leur présence dans ma vie, si souhaitable.
Les petits qui comprennent la joie.
4 décembre
Zone d’embarquement.
Je suis un zonard.
Cécile a dit que la traduction ajoute toujours un faux sens. Qu’il y a une fausseté au cœur de la traduction. Je ne savais pas quoi dire. Elle était si convaincue par ses propres mots. Mais je dirais que la même chose se passe toujours en s’exprimant. Je me rends toujours compte qu’il y a un décalage de sens et d’intention quand je m’exprime. Je triche. Un peu. Je mens. Un peu. Pas exprès. C’est une performance. L’occasion me le demande. L’histoire de nos vies est presque toujours si banale qu’on risque d’ennuyer des autres en la racontant, si l’on ne ment pas, un peu, si l’on n’exagère pas, un peu.
Il y a quelqu’un qui m’entend, et je raconte l’anecdote pour lui, pour elle, pour cette audience.
C’est pourquoi je me sens toujours coupable après m’être exprimé. J’ai toujours ce sentiment. Aujourd’hui aussi. Celui de vouloir nier tout ce que je viens de dire. La compulsion de m’exprimer, de me mettre en contact avec des personnes, cela me donne le sentiment de m’avoir sali. Après une séance chez le psychologue, ou une longue conversation avec un nouvel ami, je veux toujours faire la sieste, m’absenter, me réfugier. Peut-être l’expression elle-même n’est-elle pas une tricherie personnelle. Et, peut-être, si c’est vrai, une tricherie plus grave que celle de la traduction qui n’a pas ce côté personnel.
Je respire lentement. Mon souffle fait son va-et-vient. Il gonfle les poumons, puis les dégonfle. Il y a une année que mon père est mort d’une double embolie pulmonaire. C’était imprévu, un cauchemar.
Je prends du recul par rapport à la semaine passée. Je prends mes distances avec la performance de soi que j’ai faite, et bien faite, en vérité. Je laisse évanouir une partie essentielle de mon être, mais je n’ai pas encore pris la décision de reprendre ma plus grande partie. Je reste flou, indistinct. Une existence imprécise.
Mais c’est incontestable qu’il soit réel, cet espace où l’existence se divise, où elle fait son va-et-vient, l’interstice, même si c’est impossible à concevoir d’une existence pour laquelle on n’a pas déjà fait nos choix. Ma zone de vie s’étend d’ici jusque-là. Oui. Je sais. Ce n’est pas une infinité de possibilités.
La politique des zonards : de nier des appartenances. Je ne me définis pas consciemment comme cela ou ceci. Je change vite. Je m’adapte vite. Je fais mes choix subrepticement.
Flou, fluidité, flux.
Rangé en mobilité.
Si, je m’exprime honnêtement ! Ces mots m’arrivent. J’ai du mal à les empêcher. Je les note. C’est à vous de les aimer, ou pas. Je m’articule. Même si c’est toujours en tangente. Être en soi. Être en soi-même ? Non, pas si précieux que ça.
Je passe par les portes qui m’infléchissent. C’est une longue série de portes, l’une après l’autre. Même si je ne me déplace pas. Même si.
Pourquoi parles-tu si bien le français ? Elle m’a demandé, des personnes m’ont demandé. C’est la légèreté de mon expression, la qualité de ma voix. Adaptable aux autres voix.
Je me sers du français pour m’exprimer, à moins que ce soit la langue qui se sert de moi ?
C’est le problème : je m’attache trop aux choses. Je m’attache fortement à mes filles. Je m’attache aux langues. Absurdement. Follement. Jusqu’à la déraison.
Est-ce qu’on contrôle bien tous nos comportements ? Est-ce que c’est la langue qui nous contrôle, ou nous qui la contrôlons ? Est-ce que vous en êtes sûr ?
*
On avance pour s’arrêter, pour attendre dans un lieu un peu différent par rapport à celui où l’on était. 5 mètres en avance, 5 mètres encore en avance, est-ce que c’est vraiment un déplacement progressif, ou une manière de circuler en cercles, de s’approcher d’un futur flou que nous comprenons en termes physiques, géographiques, et territoriaux, un avenir quelconque, en avenir en tant que tel, mais un avenir nouveau : qui sait s’il est un avancement de nos intérêts humains … statut, argent, amour, fidélité, contentement, repos …
Par ce déplacement, on échappe à un futur particulier, dit connu, peut-être déplaisant, pour un autre futur plus vague, mais, justement, avec plus d’allure, un futur méconnu, différent de ce qu’on connait, la vie qu’on avait, et cette différence compte beaucoup. 5 mètres de différence comptent beaucoup.
C’est comme les nuages qui montent vers l’ouest, comme s’ils sont des bateaux, des jonques, au-dessus d’une vaste mer où nulle île ne s’impose à la fin des vagues qui traînent là où elles ne savent pas, là où personne ne sait.
*
On charge les compartiments de bagages. On les surcharge. Il n’y a pas assez d’espace pour nos vies. Peu importe. On voyage entourés de nos trucs, de nos déchets. Imaginons un monde où l’on embarque en bateaux, en trains, en avions, avec les habits qui nous habillent et rien d’autre. Même les pensées, on les dépose aux portails de la gare.
Je me décharge de cette langue. De l’autre côté de l’océan, je n’aurai plus envie de m’exprimer comme cela. Le contexte m’échappera. Là-bas, dans la ville, je serai partiellement effacé, cet aspect de ma vie sera comme une marque au crayon sur un feuillet qu’on ne peut plus lire cinq jours après. Là-bas, je me rendrai lisible au monde d’une manière différente, le contexte me règle toujours, je change sans avoir pris une décision, la langue s’impose à moi. Une langue que je n’ai pas choisie, mais qui m’a choisi, comme toute langue, à chaque fois.
Les rugissements de l’engin grandissent. Ils me choquent. On fuit. On fuit de cette réalité. On fuit au-dessus des océans.
*
Là-bas, j’étais entouré de bons esprits. Fortes personnalités. Des personnes de bonté et de bonne volonté. Avec une bonne humeur. Des personnes comme ceux qu’on veut rencontrer au monde. Des personnes qui voulaient vivre parmi l’humanité, même si elles étaient des solitaires, même si elles n’étaient pas, par revanche, des misanthropes.
C’est la même pour moi : solitaire, mais, j’espère, pas misanthrope, même si, de temps en temps, l’humanité me trouble, et il devient difficile de penser que c’est une espèce vraiment valable … même si je pense de temps en temps … j’aurais dû être un ver, creusant en roulette dans les sous-sols de la terre, pénétrant des régions inconnues, avec de si pénibles efforts, de vrais ouvriers, ces braves …
Ça n’a pris que des minutes pour voir la gentillesse de ces personnes. Je parlais avec une collègue en face de l’hôtel quand le formateur est venu se joindre à la conversation sans l’interrompre, sans imposition, sans introduction, comme si l’on était déjà amis. Ou, la première séance, la femme qui s’est déplacée pour rendre son siège à quelqu’un d’autre. La disponibilité d’être bienveillant, de s’occuper des autres, de poser des questions, d’interroger pour mieux comprendre. La volonté de vouloir comprendre. Qui est rare au monde. Ils étaient des étrangers, mais ils avaient de l’attention pour les autres, pour les détails, ce qui est rare.
Normalement, on vit dans des îlots. Un îlot pour chacun. Ou à l’intérieur des containers sur les bateaux de cargaison qui se croisent dans le noir des nuits orageuses.
*
De temps en temps, je pense que je ne suis pas bien élevé. Même si je suis poli, personne ne me dit impoli, même si je souris, même si je ris quand les autres rient, au moment approprié, quasiment spontanément, même si je feins, de temps en temps, quand je n’ai pas compris la blague, même si j’ai compris les mots, mais je ne comprends pas toujours pourquoi quelqu’un trouve une situation si drôle, si prête à se déclamer en anecdote. Je m’explique : c’est juste ça, la manière d’être parmi et pour les autres. D’être si attentif, tourné vers les autres. Que je ne comprends pas toujours cela.
Là-bas, il y avait des moments où je n’en pouvais plus. Être parmi. Être pour. Et, à ces occasions, sans avoir rien demandé à personne, je sautais de mon siège, je fuyais. Pendant que les autres se déplaçaient lentement vers le balcon pour fumer une autre cigarette et pour en causer un peu plus, je me suis lancé comme une baïonnette vers la porte. Je descendais l’escalier, je sortais de l’immeuble, je m’éloignais de cette scène. En me jetant dans la rue, je me promenais comme un dingue à pas légers, à foulées rapides, sans avoir d’autre but de sentir la vie réémerger dans mes jambes, dans mes muscles, d’oublier mon rôle toujours un peu mal joué, à cause de mon impolitesse, qui ne s’exprime pas mais qui existe, à cause de mon inconfort d’être humain.
*
Vers la fin du vol, je sens la lourdeur de la journée. Je suis fatigué. Jusqu’ici, le trajet m’a pris 18 heures.
J’enlève mes lunettes pour les poser sur mon crâne. C’était l’un de ces comportements que je reconnaissais, quand j’étais petit, comme un geste d’adulte. Puis, pendant des années, je refusais de le faire. Je ne peux plus refuser, je ne peux plus résister la mort. Je suis adulte. Oui, je suis adulte, même si je me sens toujours ado.
La lente descente commence. C’est un long processus. Le nivellement de l’air n’est pas évident pour les yeux, mais après que le pilote nous ait informé de notre approche de la ville, l’avion trébuche, trébuche, trébuche. Il y a là quelque chose qui n’est pas évident : les escaliers invisibles descendant des cieux, la lourdeur de l’air change. C’est le vent, qui marque les pays des cieux, des microclimats, des terrains, comme sur terre, ou la différence entre le côté est et le côté ouest d’une colline peut produire des vignobles tout à fait différents.
L’air circule dans l’avion. Il y a de petites tétines métalliques d’où il vient. Je porte un masque. J’éternue dans mon masque.
La descente est longue.
J’essaie de ne pas penser à chaque étape qui m’amène vers le futur. Mais la démarche prend du temps.
L’avion trébuche, trébuche, trébuche. Sur des obstacles invisibles.
On est assis en silence. On essaie de jouer nos rôles sans impatience.
On feint de ne rien sentir.
On lit les bouquins, on regarde la télé. On bâille.
5 décembre
La première chose que j’aperçois à mon retour à la ville, c’est le silence. Je traverse la rue sans problème, sans souci. Les écouteurs aux oreilles. C’est la légèreté qui vient de pouvoir renoncer au monde. J’entends des frivolités de la programmation de la radio que je préfère, une façon de ne pas penser … C’est mon biberon, maman, ne me prive pas de ça !
Dans la ville, tout est plus grand, plus répandu, même la distance entre les gens. On ne se bat plus, on ne se trébuche plus, on ne se heurte plus. Pas plus.
Ici, personne ne me touche.
À la maison, je suis enveloppé d’amour, on se touche tout le temps, on se pend comme des singes glorieux aux arbres. Mon corps ne m’est guère déchiffrable. Ces quatre corps qui se touchent, qui n’en sont qu’un.
Mais sur la rue, le régime de la différence s’impose.
J’entre dans le bureau du médecin, et la musique de la radio m’envahit, elle s’embrouille dans mon esprit. Des souvenirs s’ouvrent, bons et mauvais, la musique me réjouit, elle me déprime. Elle me pousse vers des endroits où je ne veux pas aller : le passé, la banalité, le mouvement général de l’humanité, les intempéries de ma vie, les blessures.
Et puis j’ai le sentiment que je gâche le temps. Qu’on gâche le temps. Le temps de nos vies. Sans un contact fort avec la vie, avec le vif, on gâche, on rate, on perd. On a déjà raté la vie en n’en profitant pas, en n’en profitant pas autant.
C’est la pression. C’est trop fort, ce sentiment qu’il nous faut toujours en profiter.
Profitez de Paris, de Palerme, de …
On essaie de profiter tout le temps, mais pour quelle fin ?
Moi, qui admets des moments de suspension et de faiblesse où je n’en peux plus. Où je lâche tout.
7 décembre
Je tousse. Mes filles toussent. Je dépasse des personnes qui toussent dans les rues. Dans la ville, la toux. Dans l’avion, la toux. À Palerme, la toux. La toux d’hiver nous unifie.
Il est 4 h 30 du matin. Je suis là.
Dans la rue, personne. Silence total. Ma fille de quatre ans dort sur le canapé. Elle s’endort dans la chambre qu’elle partage avec sa sœur, mais, presque toujours, elle vient dormir sur le canapé, toujours à une heure différente. Celle de huit ans dort tout au fond de l’appartement. Elle tousse, je l’entends depuis la cuisine. La moitié de son école maternelle est absente, un virus d’estomac circule. La maîtresse est absente. Mais ma fille, elle est soigneuse, elle porte toujours son masque dans la salle de classe. Je lui dis de temps en temps, «C’est pas nécessaire de porter ton masque ici … » Mais elle est une personne aussi. Elle prend ses décisions pour elle-même.
*
Parmi vous, il y a des personnes qui ne vivent qu’à 5 mètres de distance, l’une de l’autre. À Paris. Moi, je vis à l’écart. J’étais à la fac, je vivais avec une famille dans leur maison, j’avais une toilette dans mon placard, je souffrais, c’était pendant cette saison de ma vie que je me suis rendu compte du fait que j’aime vivre à l’écart, aux parages de la ville, à l’orée de la forêt, à la lisière du désert. Ça continue. Je n’aime pas que la vie soit trop centralisée. Qu’il n’y ait aucun arrière-plan, aucun hors-texte, des coins de rue, des allées, où la vie se traîne en silence, inaperçue, oubliée. Si je me sens abandonné par la foule, ce n’est pas un regret, je cherche inconsciemment cette condition. Et si je m’imagine tout seul, ce n’est pas vrai. Je vis en famille. Ma famille me protège, ma baraque est ma barricade.
C’est ce que je voulais vous expliquer.
C’était un vrai plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une très bonne saison de Noël. Et je vous dis au revoir, même si l’on ne se reverra jamais.
Matt Reeck
Remerciements à Khalid Lyamlahy pour sa lecture et son amitié.
site internet de Matt Reeck
////////////// Autres documents
par Nathanaël
Faire le vide.
Si je m’arrête sur une seule phrase comme sur une image, en vidant la feuille des signes devenus soudain superflus, ou bien se propulsant comme un courant, en écartant le cadre justement d’une convention philosophique, ce qui m’est donné, à moi comme à d’aucuns, (…)
par Nathanaël
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.


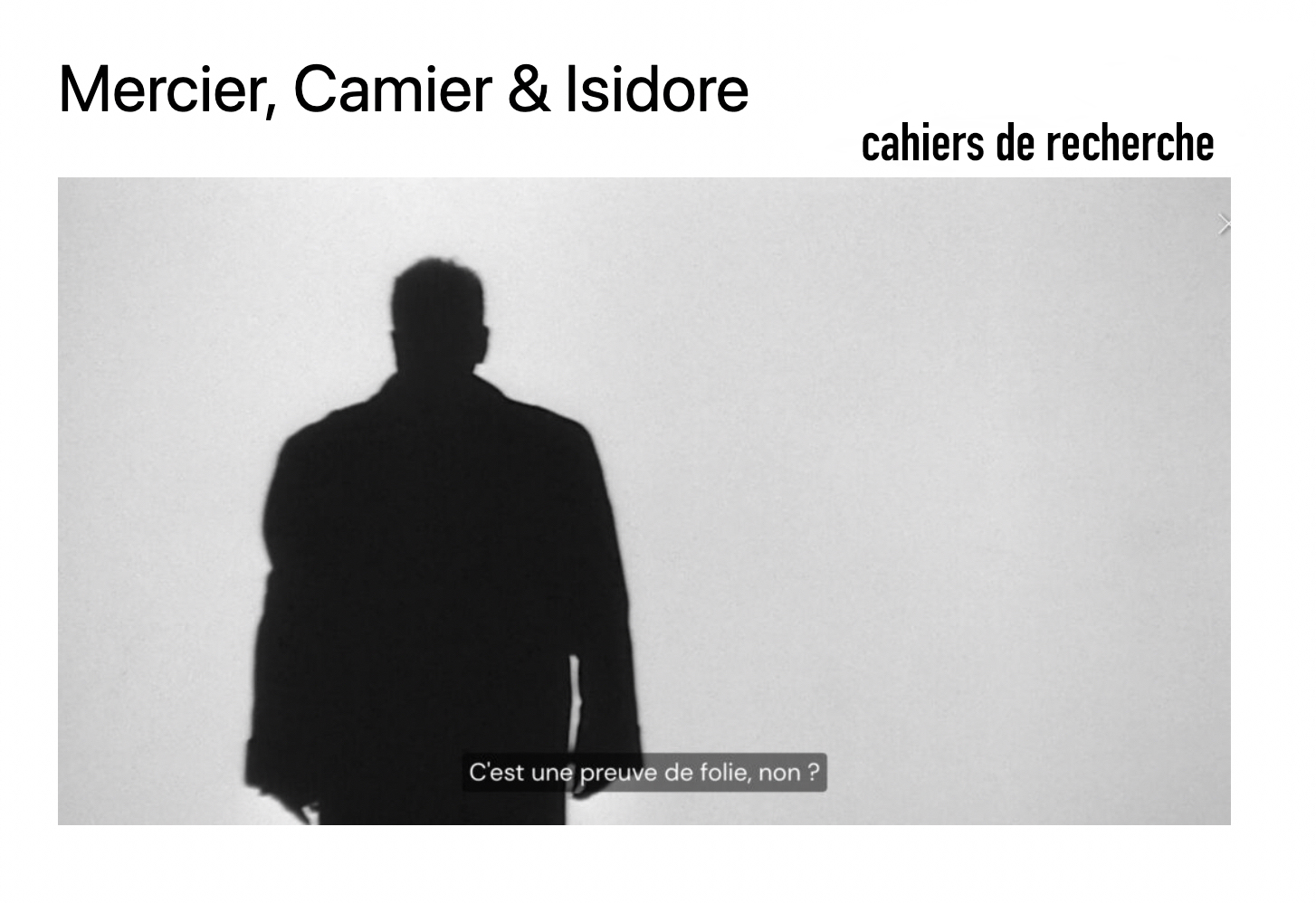



Intimations
Matt Reeck
***
Je suis intimé d’écrire cela.
Je ne dis pas que c’est dieu qui m’intime.
Non, c’est la langue elle-même.
Il est 3 heures du matin, le 1er décembre.
Je suis à Palerme, en Sicile.
Je me suis levé.
Des souvenirs me viennent.
Je suis fragilisé par ces derniers deux ans. Je suis intact mais susceptible de m’effondrer à la moindre souffrance.
Mon premier souvenir de Paris est la main de ma mère. Ma famille. Mon père avec son appareil photo Minolta. Ma sœur toujours côte à côte avec moi. On avance à pas lourds vers l’Opéra Garnier. Il y a du monde. C’est bruyant. Des voitures. Des camions. Partout. C’est un monde urgent. La pollution s’engouffre dans mes poumons. Même aujourd’hui, quand je sens de l’échappement, mon corps est transporté directement à Paris, à cette époque, et je me sens plus sophistiqué, plus excité par le monde qui m’entoure. Si l’on regarde plus loin, les façades des cathédrales sont émaillées, couvertes d’un vernis noir. À l’époque, personne ne pense au changement climatique, à cet avenir secret.
J’ai huit ans. Neuf ans, peut-être. On habite une petite maison dans la campagne britannique, un « cottage », Mead Close Cottage, aux environs d’Oxford où mon père passe son année sabbatique. On est tous contents. D’être en famille. Oui, c’est avant. Avant l’adolescence. Avant le divorce. Avant le début des divagations de mon père.
Cette année-là, on achète une VW Vanagon, un camping-car, le meilleur du monde, à mon avis. On est sur le périphérique. C’est bouché. C’est l’été. Tout le monde va au sud. Nous, on veut aller aux pays de la Loire. Aux châteaux. On ne bouge plus. Mon père descend de la voiture. Il y a un grand camion à côté avec un autocollant sexiste. La forme d’une femme assise et nue, le dos tout droit, ou plus, en arche, poussant son sein vers le ciel.
J’ai huit ans. Neuf ans, peut-être.
*
Mon attirance pour les langues vient du fait que je veux être différent. Toujours différent. Où suis-je, que suis-je, peu importe : je veux être différent. Je veux être moi en tant qu’un autre.
Deuxième souvenir. Ou troisième. C’est 1990. C’est la rue Saint-Roch. Près de l’Opéra Garnier. On est à l’hôtel. C’est notre voyage autour du monde. Le cadeau de notre père à nous, la dernière fois qu’on aurait l’occasion de voyager ensemble, il nous a dit, et, effectivement, c’est devenu une réalité, même si ce n’était pas pour les mêmes raisons.
L’occasion, c’est la fin des études du lycée de ma sœur. Désormais, notre famille ne peut pas être la même, elle change, naturellement, avec le déplacement de ma sœur. Elle ne sera plus présente, elle commence sa vie à nouveau, à l’université, une petite université avec son allure de cloître, sur une colline dans un état bien loin de nous. Mon deuxième, ou troisième, souvenir de Paris se passe là-bas, à la rue Saint-Roch dans le sous-sol d’un bâtiment où se trouve Monoprix. Quel drôle de supermarché au sous-sol ! Puis, en face de notre hôtel, il y a un kiosque avec des magazines, quelques-uns avec des femmes nues sur leurs couvertures. Dans notre chambre, ma sœur et moi, on regarde des pubs sur la télé. Une femme nue se douche. Ses seins se voient. Ses mamelons.
Je suis jeune. J’ai quinze ans. Seize ans. Tout est nouveau pour moi. C’est la nouveauté qui me frappe, m’attire.
*
Les dates m’échappent. C’est 1987. Stephen Roche gagne le Tour de France. On attend les cyclistes à la rue de Rivoli. On les attend. Puis, soudainement, les vélos passent devant nous. Qui est là ? Roche est là. Il va gagner le Tour. C’est prévu, certain. On est debout, c’est la rue de Rivoli. J’ai quinze ou seize ans. Les dates m’échappent. Non, j’ai juste treize, quatorze ans. C’est une autre visite à Paris.
Non, l’hôtel Saint-Roch n’est pas sale, mais très moche. Dans notre chambre, il y a deux lits. Je me couche dans le lit près des fenêtres. Dans la salle de bains, il y a un bidet. On s’en moque. On se propose de laver nos visages dans le bidet. Notre chambre est grande, mais celle de nos parents est petite. Le lit occupe presque toute la chambre. Le tapis près de la salle de bains reste mouillé tout le temps.
Ma sœur pense toujours à son petit ami. Elle a déjà un petit ami. Moi, non. Je me méfie des autres. Que peut faire un adolescent avec les autres quand il n’est pas sûr de lui-même ? À la fin de l’année 1990, en août, quand on se retrouve encore aux États-Unis, à Tacoma, à la maison de mes grands-parents, cette bizarre maison où l’on doit monter au premier étage pour y entrer, dont le balcon fournit un bon regard sur Mont-Rainier, c’est l’anniversaire de ma sœur, le 13 août. Elle parle à son petit ami à l’appareil. Il annonce son envie de s’en séparer, disant qu’elle vit dans un monde de Barbie qu’il ne partage pas, avec son père, le chef du commissariat, une famille catholique de quatre frères et sœurs, une pauvre famille, mal éduquée. Il ressent le décalage, et il ne l’aime plus.
*
J’ai une bonne mémoire. Peut-être trop. Non, je ne suis pas l’une de ces personnes qui se souviennent de tout. Non, pas comme ça. Si vous me demandez une date au hasard, je ne pourrais pas vous dire le temps qu’il faisait ni ce que je faisais ou ressentais. Mais, en tout cas, j’ai une bonne mémoire. Ça m’aide. Et ma fille de huit ans est comme ça, aussi. Elle nous pose la même question trois fois, puis, claque, la porte se ferme. Les infos, les nouvelles, entrent là-dedans, et elles ne sortent jamais, des otages à l’intérieur de son cerveau.
Ça me plaît, de voir ça en elle.
*
Donnez-moi du temps et je vais vous expliquer.
Ce n’est pas difficile à expliquer mais ça prend du temps.
Même si, je comprends bien, vous n’avez pas le temps. Le temps de m’entendre.
Même si toute l’après-midi, hier, je vous entendais.
Oui, moi-même, j’avais quelque chose à dire sur ce sujet-là, que vous avez si bien et si largement expliqué.
Pendant des heures, je vous entendais.
Je me suis dit, « Ton tour viendra, même toi, Matt. »
Mais mon tour n’est pas venu.
Jamais.
Normalement, j’attends l’occasion où je peux prendre la parole, puis, vite, il y a un changement de ton, de circonstances.
Quelqu’un dit, « Oh là ! »
Quelqu’un dit, « Bref ! »
Et la fin est dépassée. Elle est passée. Croisée. Comme une frontière dure. La fin est déjà au passé.
Soudainement personne n’a plus envie d’entendre. Ni moi, ni personne.
Et c’est ça.
Je retourne à ma chambre.
Je prends le stylo, le crayon, le cahier.
Je passe mon tour en silence, en écrivant, en écrivant à vous, qui ne voulez plus m’entendre.
C’est ça.
Il y a toujours ça.
Je comprends bien.
Ce n’est pas votre faute.
Vous n’êtes pas fautifs.
Vous faites de votre mieux, tout le temps, ou presque.
C’est que je suis trop passif, je dois être plus agressif.
Je dois vraiment prendre la parole, je dois me lever, vous approcher, et claquer la main sur votre bouche.
Pour qu’elle ne bouge plus.
C’est ça.
C’est toujours ça.
Mais je ne suis pas cette personne.
Je retourne à ma chambre.
Ou peut-être n’écris-je pas à vous, mais à moi-même ?
Peut-être c’est ça.
Ça ?
Est-ce vraiment ça ?
Est-ce que mon père ne m’entendait pas quand j’étais petit ? Pas assez, vous comprenez, il n’était pas un diable.
Non, même s’il jouait trop le rôle de dictateur.
Nous, on était un tout petit pays, et lui, le dictateur, parfois bienveillant, plus ou moins bienveillant.
Peut-être c’est ça.
C’est quelque chose à l’intérieur de moi qui aurait dû être réglé.
*
Il est 8h moins le quart, le 1 décembre, à Palerme. Il pleut.
À l’est, ou peut-être c’est l’ouest, je perds mon sens de l’orientation dans cette ville, les nuages de la semaine passée se dispersent.
J’ai encore une heure.
Une heure de silence.
Je vais en profiter.
Un autre souvenir : Je vis avec ma grand-mère. Je ne me rappelle pas si c’est à son nouvelle adresse ou plutôt à l’ancienne maison, celle où l’on entre au premier étage. C’est l’anniversaire de quelqu’un. Probablement, de mon grand-père, dont anniversaire est en août, comme ma sœur.
C’est l’été. Je conduis. Dans la voiture sont mes grands-parents. Mon grand-père à côté de moi, ma grand-mère dans le siège arrière. On traverse le pont Narrows pour accéder l’île à côté de Tacoma. J’aime conduire. C’est un plaisir de contrôler un engin aussi puissant qu’une voiture. On va à la fête. C’est au restaurant d’un petit aéroport. Mon oncle sept ans de plus que mon père est là avec son épouse, ma tante, une femme d’une beauté classique mais assez névrosée à cause de sa mère cruelle. J’ai une photo de la rencontre chez moi, je dois la chercher pour vérifier si quelqu’un d’autre n’y est pas aussi.
Je me sens très éloigné de la scène. J’ai cette capacité, ou cette défaite, où, de temps en temps, même si je suis présent physiquement, je me sens tellement éloigné de la scène que je ne réside plus dans ma chair. C’est ça. Toujours ça. Je me sépare pour me préserver. Mon grand-père n’a pas de volonté. Accablé d’Alzheimer, il vit sans vivre. Il bouge sans bouger. Il me reconnaît, mais en tant que son fils à lui, mon père, ce qui ne me gêne pas, j’aime être reconnu comme le fils de mon père, je suis fier de lui. Il était mon père, il m’aimait, je l’aimais, je le vois régulièrement dans mes rêves.
Mon grand-père ne parle presque plus. Il me dit bonjour, et en disant bonjour à son fils, il sourit, puis il se tait.
Il est une baleine. Un échantillon dans le magasin de curiosités chez Balzac. Un livre que j’aime beaucoup, La peau de chagrin.
Je gère une baleine.
Je l’enlève de la voiture.
Je le guide tout au long du trottoir.
Je l’assieds à la table.
Mais je ne guide pas la fourchette jusqu’à sa bouche. Il le fait en tremblant. La montée de l’assiette jusqu’à sa bouche prend des heures. Ma grand-mère le menace, pensant qu’il est normal.
J’ai vingt-deux, ou vingt-trois ans.
J’imagine que je suis souriant dans la photo. J’ai appris cette formalité. On sourit quand quelqu’un prend notre photo. Mais, à l’intérieur, je suis vide. J’attends. J’attends l’avenir, les choses à venir. J’attends un ailleurs, j’attends de m’échapper à mes arrières, même si je les aime. À l’occasion de la fête, je ressemble à mon grand-père, moyennement vivant, mi-abîmé—lui, dans un état de décroissance, moi, dans un état de croissance.
3 décembre
Ça s’ajoute.
Ça s’améliore.
Après la fin d’une semaine intense, je me suis reposé dans ma chambre. Deux heures s’éclipsaient sans ma connaissance. Je m’étendais sur le lit, le dos en contact avec les draps, avec le matelas. Je ne regardais rien. Puis je me suis conjugué en position de fétus. Je restais comme ça.
Deux heures s’en allaient. Soudainement, j’étais encore prêt à me réincarner. En quoi que ce soit. Comme moi. Comme moi en tant que quelqu’un d’autre.
*
C’est difficile d’être sensible tout le temps. C’est difficile d’être toujours une personne cohérente. Quelqu’un que les autres personnes peuvent reconnaitre … Ah, oui, c’est lui. Il correspond à lui-même. Toujours le même. Un bon gosse. Bien connu. Compréhensible.
Fin de l’après-midi, le port de Palerme. Un petit moment d’ouverture dans une ville où les bâtiments penchent vers le trottoir, où les rues sont étroites et la circulation chaotique. Ici, un grand trottoir pour se balader. Je m’assieds sur une marche, presque tout seul, et mon regard se tourne vers le nord. Je suis au sud de l’Europe, mon regard se tourne vers le nord. Je m’imagine à Oran, à Alger. Il y a une tentation de m’imaginer plus au sud que je suis. Plus loin.
La lumière vive de l’ouest allume les grands bâtiments entourant le port. Puis, tout s’en va. La lumière descend à l’autre côté des nuages, des bâtiments, des collines. C’est l’hiver. Le soleil se couche vite. Les bateaux avec leurs longs mâts. Des palmiers plantés au bord de la promenade donnant à la scène l’apparence de Miami, où je ne suis jamais allé. Les petits bateaux des pêcheurs vides à cette heure-ci. La lune aux cieux, me rappelant qu’il me faut toujours expliquer à ma fille pourquoi de temps en temps on voit la lune pendant la journée. Qu’il me faut toujours apprendre cela.
Demain je pars. Demain soir, je les verrai encore. Elles, dont la présence me soulage tellement.
Moi, fragilisé par ces derniers deux ans. Moi, qui pleure quand je songe trop, ma réalité si hasardeuse, si incertaine, et leur présence dans ma vie, si souhaitable.
Les petits qui comprennent la joie.
4 décembre
Zone d’embarquement.
Je suis un zonard.
Cécile a dit que la traduction ajoute toujours un faux sens. Qu’il y a une fausseté au cœur de la traduction. Je ne savais pas quoi dire. Elle était si convaincue par ses propres mots. Mais je dirais que la même chose se passe toujours en s’exprimant. Je me rends toujours compte qu’il y a un décalage de sens et d’intention quand je m’exprime. Je triche. Un peu. Je mens. Un peu. Pas exprès. C’est une performance. L’occasion me le demande. L’histoire de nos vies est presque toujours si banale qu’on risque d’ennuyer des autres en la racontant, si l’on ne ment pas, un peu, si l’on n’exagère pas, un peu.
Il y a quelqu’un qui m’entend, et je raconte l’anecdote pour lui, pour elle, pour cette audience.
C’est pourquoi je me sens toujours coupable après m’être exprimé. J’ai toujours ce sentiment. Aujourd’hui aussi. Celui de vouloir nier tout ce que je viens de dire. La compulsion de m’exprimer, de me mettre en contact avec des personnes, cela me donne le sentiment de m’avoir sali. Après une séance chez le psychologue, ou une longue conversation avec un nouvel ami, je veux toujours faire la sieste, m’absenter, me réfugier. Peut-être l’expression elle-même n’est-elle pas une tricherie personnelle. Et, peut-être, si c’est vrai, une tricherie plus grave que celle de la traduction qui n’a pas ce côté personnel.
Je respire lentement. Mon souffle fait son va-et-vient. Il gonfle les poumons, puis les dégonfle. Il y a une année que mon père est mort d’une double embolie pulmonaire. C’était imprévu, un cauchemar.
Je prends du recul par rapport à la semaine passée. Je prends mes distances avec la performance de soi que j’ai faite, et bien faite, en vérité. Je laisse évanouir une partie essentielle de mon être, mais je n’ai pas encore pris la décision de reprendre ma plus grande partie. Je reste flou, indistinct. Une existence imprécise.
Mais c’est incontestable qu’il soit réel, cet espace où l’existence se divise, où elle fait son va-et-vient, l’interstice, même si c’est impossible à concevoir d’une existence pour laquelle on n’a pas déjà fait nos choix. Ma zone de vie s’étend d’ici jusque-là. Oui. Je sais. Ce n’est pas une infinité de possibilités.
La politique des zonards : de nier des appartenances. Je ne me définis pas consciemment comme cela ou ceci. Je change vite. Je m’adapte vite. Je fais mes choix subrepticement.
Flou, fluidité, flux.
Rangé en mobilité.
Si, je m’exprime honnêtement ! Ces mots m’arrivent. J’ai du mal à les empêcher. Je les note. C’est à vous de les aimer, ou pas. Je m’articule. Même si c’est toujours en tangente. Être en soi. Être en soi-même ? Non, pas si précieux que ça.
Je passe par les portes qui m’infléchissent. C’est une longue série de portes, l’une après l’autre. Même si je ne me déplace pas. Même si.
Pourquoi parles-tu si bien le français ? Elle m’a demandé, des personnes m’ont demandé. C’est la légèreté de mon expression, la qualité de ma voix. Adaptable aux autres voix.
Je me sers du français pour m’exprimer, à moins que ce soit la langue qui se sert de moi ?
C’est le problème : je m’attache trop aux choses. Je m’attache fortement à mes filles. Je m’attache aux langues. Absurdement. Follement. Jusqu’à la déraison.
Est-ce qu’on contrôle bien tous nos comportements ? Est-ce que c’est la langue qui nous contrôle, ou nous qui la contrôlons ? Est-ce que vous en êtes sûr ?
*
On avance pour s’arrêter, pour attendre dans un lieu un peu différent par rapport à celui où l’on était. 5 mètres en avance, 5 mètres encore en avance, est-ce que c’est vraiment un déplacement progressif, ou une manière de circuler en cercles, de s’approcher d’un futur flou que nous comprenons en termes physiques, géographiques, et territoriaux, un avenir quelconque, en avenir en tant que tel, mais un avenir nouveau : qui sait s’il est un avancement de nos intérêts humains … statut, argent, amour, fidélité, contentement, repos …
Par ce déplacement, on échappe à un futur particulier, dit connu, peut-être déplaisant, pour un autre futur plus vague, mais, justement, avec plus d’allure, un futur méconnu, différent de ce qu’on connait, la vie qu’on avait, et cette différence compte beaucoup. 5 mètres de différence comptent beaucoup.
C’est comme les nuages qui montent vers l’ouest, comme s’ils sont des bateaux, des jonques, au-dessus d’une vaste mer où nulle île ne s’impose à la fin des vagues qui traînent là où elles ne savent pas, là où personne ne sait.
*
On charge les compartiments de bagages. On les surcharge. Il n’y a pas assez d’espace pour nos vies. Peu importe. On voyage entourés de nos trucs, de nos déchets. Imaginons un monde où l’on embarque en bateaux, en trains, en avions, avec les habits qui nous habillent et rien d’autre. Même les pensées, on les dépose aux portails de la gare.
Je me décharge de cette langue. De l’autre côté de l’océan, je n’aurai plus envie de m’exprimer comme cela. Le contexte m’échappera. Là-bas, dans la ville, je serai partiellement effacé, cet aspect de ma vie sera comme une marque au crayon sur un feuillet qu’on ne peut plus lire cinq jours après. Là-bas, je me rendrai lisible au monde d’une manière différente, le contexte me règle toujours, je change sans avoir pris une décision, la langue s’impose à moi. Une langue que je n’ai pas choisie, mais qui m’a choisi, comme toute langue, à chaque fois.
Les rugissements de l’engin grandissent. Ils me choquent. On fuit. On fuit de cette réalité. On fuit au-dessus des océans.
*
Là-bas, j’étais entouré de bons esprits. Fortes personnalités. Des personnes de bonté et de bonne volonté. Avec une bonne humeur. Des personnes comme ceux qu’on veut rencontrer au monde. Des personnes qui voulaient vivre parmi l’humanité, même si elles étaient des solitaires, même si elles n’étaient pas, par revanche, des misanthropes.
C’est la même pour moi : solitaire, mais, j’espère, pas misanthrope, même si, de temps en temps, l’humanité me trouble, et il devient difficile de penser que c’est une espèce vraiment valable … même si je pense de temps en temps … j’aurais dû être un ver, creusant en roulette dans les sous-sols de la terre, pénétrant des régions inconnues, avec de si pénibles efforts, de vrais ouvriers, ces braves …
Ça n’a pris que des minutes pour voir la gentillesse de ces personnes. Je parlais avec une collègue en face de l’hôtel quand le formateur est venu se joindre à la conversation sans l’interrompre, sans imposition, sans introduction, comme si l’on était déjà amis. Ou, la première séance, la femme qui s’est déplacée pour rendre son siège à quelqu’un d’autre. La disponibilité d’être bienveillant, de s’occuper des autres, de poser des questions, d’interroger pour mieux comprendre. La volonté de vouloir comprendre. Qui est rare au monde. Ils étaient des étrangers, mais ils avaient de l’attention pour les autres, pour les détails, ce qui est rare.
Normalement, on vit dans des îlots. Un îlot pour chacun. Ou à l’intérieur des containers sur les bateaux de cargaison qui se croisent dans le noir des nuits orageuses.
*
De temps en temps, je pense que je ne suis pas bien élevé. Même si je suis poli, personne ne me dit impoli, même si je souris, même si je ris quand les autres rient, au moment approprié, quasiment spontanément, même si je feins, de temps en temps, quand je n’ai pas compris la blague, même si j’ai compris les mots, mais je ne comprends pas toujours pourquoi quelqu’un trouve une situation si drôle, si prête à se déclamer en anecdote. Je m’explique : c’est juste ça, la manière d’être parmi et pour les autres. D’être si attentif, tourné vers les autres. Que je ne comprends pas toujours cela.
Là-bas, il y avait des moments où je n’en pouvais plus. Être parmi. Être pour. Et, à ces occasions, sans avoir rien demandé à personne, je sautais de mon siège, je fuyais. Pendant que les autres se déplaçaient lentement vers le balcon pour fumer une autre cigarette et pour en causer un peu plus, je me suis lancé comme une baïonnette vers la porte. Je descendais l’escalier, je sortais de l’immeuble, je m’éloignais de cette scène. En me jetant dans la rue, je me promenais comme un dingue à pas légers, à foulées rapides, sans avoir d’autre but de sentir la vie réémerger dans mes jambes, dans mes muscles, d’oublier mon rôle toujours un peu mal joué, à cause de mon impolitesse, qui ne s’exprime pas mais qui existe, à cause de mon inconfort d’être humain.
*
Vers la fin du vol, je sens la lourdeur de la journée. Je suis fatigué. Jusqu’ici, le trajet m’a pris 18 heures.
J’enlève mes lunettes pour les poser sur mon crâne. C’était l’un de ces comportements que je reconnaissais, quand j’étais petit, comme un geste d’adulte. Puis, pendant des années, je refusais de le faire. Je ne peux plus refuser, je ne peux plus résister la mort. Je suis adulte. Oui, je suis adulte, même si je me sens toujours ado.
La lente descente commence. C’est un long processus. Le nivellement de l’air n’est pas évident pour les yeux, mais après que le pilote nous ait informé de notre approche de la ville, l’avion trébuche, trébuche, trébuche. Il y a là quelque chose qui n’est pas évident : les escaliers invisibles descendant des cieux, la lourdeur de l’air change. C’est le vent, qui marque les pays des cieux, des microclimats, des terrains, comme sur terre, ou la différence entre le côté est et le côté ouest d’une colline peut produire des vignobles tout à fait différents.
L’air circule dans l’avion. Il y a de petites tétines métalliques d’où il vient. Je porte un masque. J’éternue dans mon masque.
La descente est longue.
J’essaie de ne pas penser à chaque étape qui m’amène vers le futur. Mais la démarche prend du temps.
L’avion trébuche, trébuche, trébuche. Sur des obstacles invisibles.
On est assis en silence. On essaie de jouer nos rôles sans impatience.
On feint de ne rien sentir.
On lit les bouquins, on regarde la télé. On bâille.
5 décembre
La première chose que j’aperçois à mon retour à la ville, c’est le silence. Je traverse la rue sans problème, sans souci. Les écouteurs aux oreilles. C’est la légèreté qui vient de pouvoir renoncer au monde. J’entends des frivolités de la programmation de la radio que je préfère, une façon de ne pas penser … C’est mon biberon, maman, ne me prive pas de ça !
Dans la ville, tout est plus grand, plus répandu, même la distance entre les gens. On ne se bat plus, on ne se trébuche plus, on ne se heurte plus. Pas plus.
Ici, personne ne me touche.
À la maison, je suis enveloppé d’amour, on se touche tout le temps, on se pend comme des singes glorieux aux arbres. Mon corps ne m’est guère déchiffrable. Ces quatre corps qui se touchent, qui n’en sont qu’un.
Mais sur la rue, le régime de la différence s’impose.
J’entre dans le bureau du médecin, et la musique de la radio m’envahit, elle s’embrouille dans mon esprit. Des souvenirs s’ouvrent, bons et mauvais, la musique me réjouit, elle me déprime. Elle me pousse vers des endroits où je ne veux pas aller : le passé, la banalité, le mouvement général de l’humanité, les intempéries de ma vie, les blessures.
Et puis j’ai le sentiment que je gâche le temps. Qu’on gâche le temps. Le temps de nos vies. Sans un contact fort avec la vie, avec le vif, on gâche, on rate, on perd. On a déjà raté la vie en n’en profitant pas, en n’en profitant pas autant.
C’est la pression. C’est trop fort, ce sentiment qu’il nous faut toujours en profiter.
Profitez de Paris, de Palerme, de …
On essaie de profiter tout le temps, mais pour quelle fin ?
Moi, qui admets des moments de suspension et de faiblesse où je n’en peux plus. Où je lâche tout.
7 décembre
Je tousse. Mes filles toussent. Je dépasse des personnes qui toussent dans les rues. Dans la ville, la toux. Dans l’avion, la toux. À Palerme, la toux. La toux d’hiver nous unifie.
Il est 4 h 30 du matin. Je suis là.
Dans la rue, personne. Silence total. Ma fille de quatre ans dort sur le canapé. Elle s’endort dans la chambre qu’elle partage avec sa sœur, mais, presque toujours, elle vient dormir sur le canapé, toujours à une heure différente. Celle de huit ans dort tout au fond de l’appartement. Elle tousse, je l’entends depuis la cuisine. La moitié de son école maternelle est absente, un virus d’estomac circule. La maîtresse est absente. Mais ma fille, elle est soigneuse, elle porte toujours son masque dans la salle de classe. Je lui dis de temps en temps, «C’est pas nécessaire de porter ton masque ici … » Mais elle est une personne aussi. Elle prend ses décisions pour elle-même.
*
Parmi vous, il y a des personnes qui ne vivent qu’à 5 mètres de distance, l’une de l’autre. À Paris. Moi, je vis à l’écart. J’étais à la fac, je vivais avec une famille dans leur maison, j’avais une toilette dans mon placard, je souffrais, c’était pendant cette saison de ma vie que je me suis rendu compte du fait que j’aime vivre à l’écart, aux parages de la ville, à l’orée de la forêt, à la lisière du désert. Ça continue. Je n’aime pas que la vie soit trop centralisée. Qu’il n’y ait aucun arrière-plan, aucun hors-texte, des coins de rue, des allées, où la vie se traîne en silence, inaperçue, oubliée. Si je me sens abandonné par la foule, ce n’est pas un regret, je cherche inconsciemment cette condition. Et si je m’imagine tout seul, ce n’est pas vrai. Je vis en famille. Ma famille me protège, ma baraque est ma barricade.
C’est ce que je voulais vous expliquer.
C’était un vrai plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une très bonne saison de Noël. Et je vous dis au revoir, même si l’on ne se reverra jamais.
Matt Reeck
Remerciements à Khalid Lyamlahy pour sa lecture et son amitié.
site internet de Matt Reeck
////////////// Autres documents
Les morts solitaires de Mizoguchi Kenji
par Nathanaël
Faire le vide.
Si je m’arrête sur une seule phrase comme sur une image, en vidant la feuille des signes devenus soudain superflus, ou bien se propulsant comme un courant, en écartant le cadre justement d’une convention philosophique, ce qui m’est donné, à moi comme à d’aucuns, (…)
Traduction (soi-)disant : une expropriation d’intimités
par Nathanaël
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris