par Nathanaël
Ces jours-ci en relisant Ich und Du de Martin Buber – il ne s’agissait en fait pas d’une relecture à proprement parler car cela aurait entraîné l’effeuillage de la traduction vers l’anglais de Walter Kaufmann, I and Thou, alors que je lisais pour la première fois Je et Tu, traduit par G. Bianquis, actuellement onéreusement épuisé – et j’ajouterai que cette décision de lire l’allemand en français constitue déjà une forme d’infidélité puisqu’elle contrevient à une résolution assidue de lire au plus près de l’original, justifiant ainsi, étant donné la complicité antécédante des langues allemande et anglaise, une telle pratique, qui m’a parue subitement irresponsable cette année (et seulement dans le contexte très intime de mon rapport à ces langues, toutes trois, et pas du tout de façon généralisable), ce qui m’a poussée à dévier de cette norme, déroutant davantage les transferts entre les langues, et me disloquant qui plus est des textes et auteurs dont il est question, menant à la réalisation dont je me suis déjà multiplement égarée, qui est celle-ci : contrairement à l’habituelle, voire l’inhabituelle, proposition qui soutient que la traduction propose la lecture la plus attentive d’un texte, il se peut en effet que la traduction constitue, de façon irréconciliable, même contrariante, l’indication d’un défaut de réciprocité. J’essaierai, de façon sans doute dédaléenne, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’une simple redite de l’accusation, plus courante, et très sexuée, d’infidélité.
À cela j’ajouterai que cette décision indécidée, issue d’un malentendu, est reliée à plusieurs événements importants survenus au cours des dernières années, y compris un voyage en novembre et décembre 2009 en Allemagne et en Autriche, sur lequel je ne m’attarderai pas ici, mais dont je voudrais tout de même reconnaître le caractère déterminant, dans le sillon des (derniers) mois menant au voyage, pour le réaménagement, ou plus exactement la détérioration de mes géographies existantes, comme je m’en avais jusque-là pris l’habitude de les aborder, de les comprendre. De paire donc avec une compréhension du déchirement spatiotemporel, j’ajouterai à mon lexique le mot begreifen – c’est le seul mot allemand, je le promets, que je prononcerai mal aujourd’hui, heute (mot bachmannien par excellence) – begreifen, saisir, appréhender, comprendre. Je résumerai cette interjection en me rendant obstinément au unbegreifen ou à l’acatalepsie alors que la fange s’empare de ma pensée.
Mes géographies étant incrustées à mes langues et mon corps étant pris dans les deux à la fois, je me passerai de la tentation d’entériner le divis cartésien irrémédiablement établi, et emprunterai plutôt du vocabulaire architectural de Claude Parent et Paul Virilio, afin d’avancer la proposition suivante : celle de la traduction comme pratique relationnelle oblique, dont les intimités entraînent le frottement de textes à certains endroits et les désalignements béants à d’autres, la partition des corps de textes là précisément où ils se touchent, c’est-à-dire en traduction imparfaite, c’est-à-dire catastrophiquement désalignées. J’ajouterai à ceci un paradoxe étymologique opportun, soit que le verbe autoritaire intimer, dont le corollaire anglais to intimate, signifie à la fois la communication implicite (invertie) et explicite (extrovertie) d’une information, en même temps qu’une déclaration de guerre (son acception anglaise). En écrivant ceci, j’ai en tête une photo de Claude Cahun de 1928 intitulé Que me veux-tu ? dans laquelle, doublement exposée, elle se mire (elle se mirent ?) avec accusation, et plusieurs photographies de Paul Virilio des bunkers inclinés qui constituent l’Atlantikwall. Il s’agit, je le concède volontiers, d’une étrange architecture de corps, d’un paysage insolite à partir duquel réfléchir inversement la traduction.
C’est vrai, j’ai dit : inverti. C’était et ce n’était pas un lapsus. Ce qu’accomplit Claude Cahun dans cette photographie, dans laquelle elle se détourne, est, à mon avis, exemplaire des sortes d’expropriations à l’œuvre dans l’œuvre de l’(auto-)traduction ou de la traduction (soi-)disant. Toute traduction n’est pas de facto une traduction (soi-)disant et ne concerne pas catégoriquement la traduction de ses propres textes. Depuis 2006, je suis à la fois possédée par est dépossédée de Claude Cahun, deux photos en particulier, et l’exégèse de cette dépossession a donné plusieurs textes, chacun desquels remet en question la localisation – ainsi que la dislocation – de moi(s). Sien(ne)s, mien(ne)s. Cela est en partie redevable à la prolifération de je dans l’œuvre de Cahun, à nos ressemblances déroutantes, et auprès desquelles je me suis déjà longuement attardée(1), ainsi qu’aux impératifs historiques (éthiques) à l’œuvre dans son œuvre, et finalement à l’indécision linguistique qui agit sur cette pensée, dont le résultat a été un va-et-vient cahoteux entre l’anglais et le français, déclenchant d’autres incohérences (au-delà de celles qui distinguent chaque langue intérieurement), faisant de tout point un point mouvant, et faisant en sorte qu’aucun des délinquants ne soit répondable de son délit.
M’étant ailleurs réservé le droit à des infidélités de tous genres, et l’œuvre de Cahun étant exemplaire dans ce domaine, je m’incline (avec Virilio et Parent) vers une approche de la question de la méconduite de la traduction du point de vue de l’étrangement, ce qui m’a ostensiblement égarée dans un premier lieu. (L’égarement ayant quitté L’absence au lieu, pour arriver dans Absence Where As sous la forme d’estrangement, désalignant les versions, et non, et j’insiste là-dessus, les annulant, en sorte ici que l’encontre suggère et implique la coexistence littérale (et latérale) de versions, qui seraient ou ne seraient pas capables de s’adresser l’une à l’autre). C’est ici, sans doute, que la langue allemande intervient dans la très précaire équation interrogée : ç’en est une qui refuse l’équivalence et rebute la vérifiabilité. En posant l’allemand contre, c’est-à-dire en même temps que et en contradiction avec le français, non seulement plusieurs tremblements commencent-ils à déstabiliser les lieux à partir desquels j’ai l’habitude de travailler, mais il y a aussi la manifestation d’une élucidation concomitante de dis-temporalités. Les distinctions sont d’une telle évidence qu’il n’est pas possible de se laisser amadouer par des incitations à la mêmeté, une mêmeté qui n’est nulle part en évidence, même et surtout pas dans les sortes de proximités qui seraient présentes entre langues (soi-)disant romanes, celles-ci n’étant pas réductibles à des considérations d’accent ou d’allure.
Lorsque Kaufmann traduit cette phrase de Buber : it does not help you to survive, il dit autre chose que le il ne fait rien pour te conserver en vie de Bianquis. La force vitale littérale de cette phrase, la force derrière l’existence, se manifeste hiérarchiquement dans une version (sur-vie) ; dans l’autre il s’agit d’une prolongation latérale évocatrice des technologies modernes de support artificiel. Être conservé en vie serait vivre à la merci d’une opérative dominante. Survivre, c’est se tenir au-dessus de – une position contraire à la compréhension, en anglais la position est littéralisée par l’understanding, là où nous avons commencé, dans begreifen. Mais l’allemand de Buber ne m’étant pas intelligible, je m’arrêterai là, et porterai mes attentions avides sur une question corollaire, celle de l’hermaphrodisme.
C’est sans doute la preuve d’une irrégularité que d’être confronté à la fois à Buber et à l’hermaphrodisme en une seule et même phrase, mais je me désintéresse obstinément des capricieuses lois de la filiation intellectuelle. Buber demeure donc mon conduit à l’hermaphrodisme par le biais d’une disjonction linguistique – l’étonnant jumelage d’une langue saxonne et d’une langue romane à partir desquelles les irrégularités tactiles déploient éventuellement d’inhabituels plaisirs et tensions textuels. C’est ce it does not help you to survive accouplé au il ne fait rien pour te conserver en vie, cette infime différenciation qui fait faire au texte un glissement, tel que superposés, leur joncture aurait comme résultat un bredouillis, une double-prise, un bégaiement, un flou tribade.
Un flou est justement là où je risque de rencontrer l’hermaphrodisme, ou comme je l’ai autrement écrit : « Hermaphrodite est une parole désirée dans un corps inintelligible » – ici, l’anglais est incapable de signifier le dit incrusté au mot hermaphrodite. Je constate que j’aurais très bien pu me passer de l’exégèse et ne m’en tenir qu’à ce mot en le présentant avec ses contradictions constitutives, des contradictions qui ne sont pas automatiquement apparentes dans le couple herma et aphrodite ; cette contradiction est actuellement si coutumière qu’elle ne contrevient à aucune des lois régissant l’accouplement, elle consolide regrettablement un binarisme typique. Non, ce n’est pas en cela que m’enchante l’hermaphrodite, qui appelle un défaut de réciprocité, mais son inintelligibilité incommunicable. Ce qu’il dit, dirait, dans une langue, et non pas dans une autre.
Sur le plan syntactique, le sexe de la phrase n’est pas (forcément) transférable. Un corps ainsi déstabilisé perd de vue son référent en (se) transversant dans une autre langue. La préoccupation pronominale de l’anglais, par exemple, isole le genre du sujet grammatical, qui se trouve à être dispersé dans la phrase de langue française. Là où l’un profite de l’ambiguïté, l’autre tombe dans la normalité. Afin de disloquer la mainmise du français, l’on doit s’évertuer au désaccord, la mésentente grammaticale, au lieu de la malfaisance émasculante de l’anglais.
On est du jamais vu et inappelé… ée. L’hermaphrodisme serait cela, une plongée dans le corps désirant loin des préoccupations nominales. Masculin et féminin ou aucun, c’est-à-dire ailleurs, ce qui pour moi est acte de présence : là. Loin des formes décidées, d’un discours politique arrêté mais : en face. Être pris au dépourvu c’est quand même se donner à l’instant. L’instant dans sa durée.
Le défaut de réciprocité est ici la gageure de la réciprocité. Le vigile dans l’absence l’un de l’autre, deux textes (au moins) collatéraux, (se) disant l’insistance plurielle de Buber qui veut que – « Tu ne puisses t’entendre à son sujet avec personne ». C’est ce malentendu, cette mésentente – l’impossibilité de réciprocité qui enflamme la prise du désir. Dire « tu » en texte crève la veine pronominale, rend fidèle cette infidélité.
N.
Chicago, avril 2010
——
(1) L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert), Québec, Nota Bene, coll. « Nouveaux essais Spirale », 2007 ; Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book), New York, Nightboat Books, 2009 ; Vigilous, Reel : Desire (a)s accusation, San Francisco, Albion Books, 2010 ; etc.
——
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.
——-
Liste non exhaustive des publications de Nathanaël
Sisyphus, Outdone. Theatres of the Catastrophal (Nightboat Books, 2012)
Carnet de somme (Le Quartanier, 2012)
Carnet de délibérations (Le Quartanier, 2011)
We Press Ourselves Plainly (Nightboat Books, 2010)
Vigilous, Reel: Desire (a)s accusation (Albion Books, 2010)
Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book) (Nightboat Books, 2009)
Carnet de désaccords (Le Quartanier, 2009)
At Alberta (BookThug, 2008)
The Sorrow And The Fast Of It (Nightboat Books, 2007)
…s’arrête? Je (L’Hexagone, 2007)
L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert) (Nota Bene, 2007)
Touch to Affliction (Coach House, 2006)
Je Nathanaël (BookThug, 2006)
L’INJURE (L’Hexagone, 2004)
Paper City (Coach House, 2003)
Je Nathanaël (L’Hexagone, 2003)



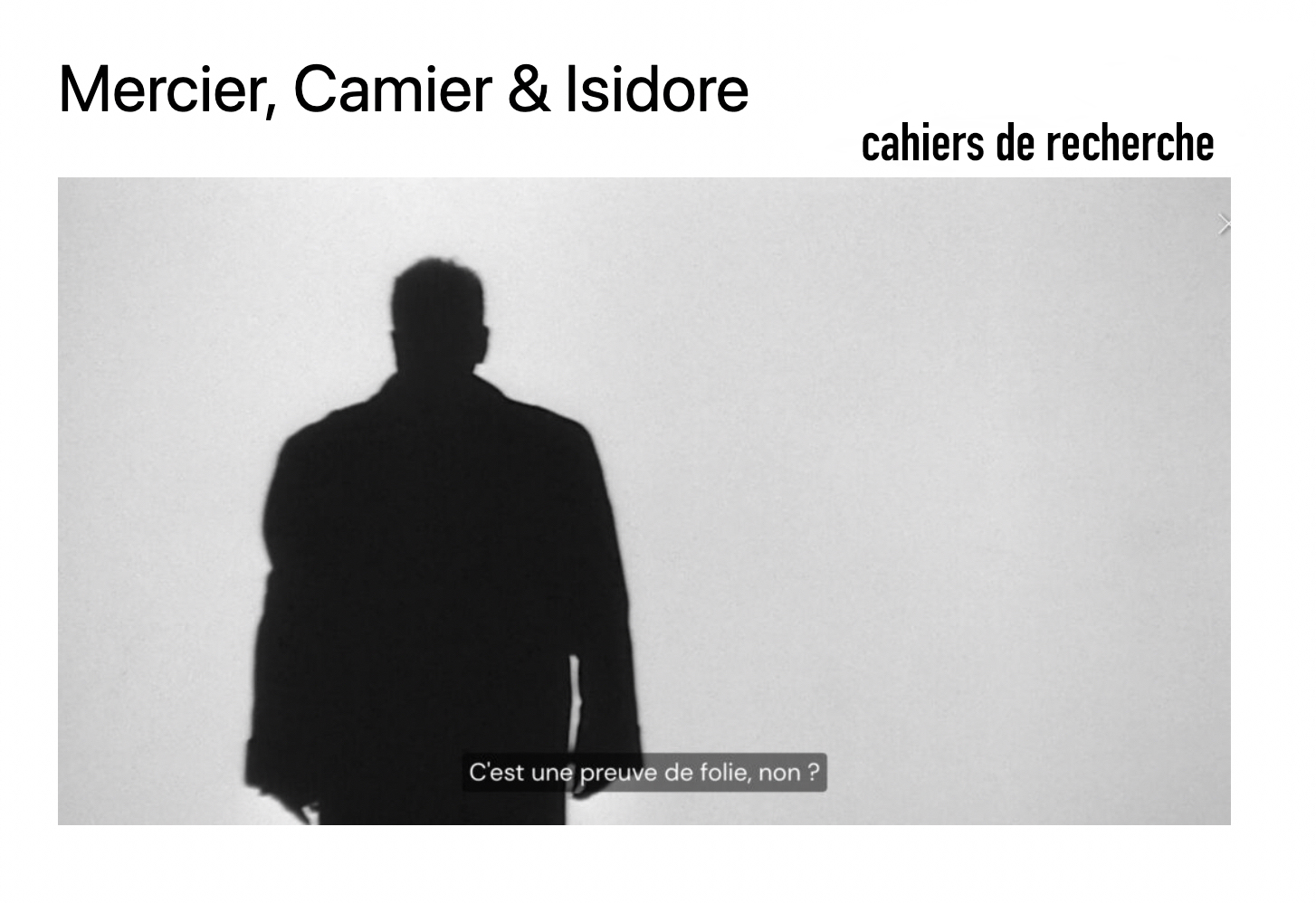




Traduction (soi-)disant : une expropriation d’intimités
par Nathanaël
Ces jours-ci en relisant Ich und Du de Martin Buber – il ne s’agissait en fait pas d’une relecture à proprement parler car cela aurait entraîné l’effeuillage de la traduction vers l’anglais de Walter Kaufmann, I and Thou, alors que je lisais pour la première fois Je et Tu, traduit par G. Bianquis, actuellement onéreusement épuisé – et j’ajouterai que cette décision de lire l’allemand en français constitue déjà une forme d’infidélité puisqu’elle contrevient à une résolution assidue de lire au plus près de l’original, justifiant ainsi, étant donné la complicité antécédante des langues allemande et anglaise, une telle pratique, qui m’a parue subitement irresponsable cette année (et seulement dans le contexte très intime de mon rapport à ces langues, toutes trois, et pas du tout de façon généralisable), ce qui m’a poussée à dévier de cette norme, déroutant davantage les transferts entre les langues, et me disloquant qui plus est des textes et auteurs dont il est question, menant à la réalisation dont je me suis déjà multiplement égarée, qui est celle-ci : contrairement à l’habituelle, voire l’inhabituelle, proposition qui soutient que la traduction propose la lecture la plus attentive d’un texte, il se peut en effet que la traduction constitue, de façon irréconciliable, même contrariante, l’indication d’un défaut de réciprocité. J’essaierai, de façon sans doute dédaléenne, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’une simple redite de l’accusation, plus courante, et très sexuée, d’infidélité.
À cela j’ajouterai que cette décision indécidée, issue d’un malentendu, est reliée à plusieurs événements importants survenus au cours des dernières années, y compris un voyage en novembre et décembre 2009 en Allemagne et en Autriche, sur lequel je ne m’attarderai pas ici, mais dont je voudrais tout de même reconnaître le caractère déterminant, dans le sillon des (derniers) mois menant au voyage, pour le réaménagement, ou plus exactement la détérioration de mes géographies existantes, comme je m’en avais jusque-là pris l’habitude de les aborder, de les comprendre. De paire donc avec une compréhension du déchirement spatiotemporel, j’ajouterai à mon lexique le mot begreifen – c’est le seul mot allemand, je le promets, que je prononcerai mal aujourd’hui, heute (mot bachmannien par excellence) – begreifen, saisir, appréhender, comprendre. Je résumerai cette interjection en me rendant obstinément au unbegreifen ou à l’acatalepsie alors que la fange s’empare de ma pensée.
Mes géographies étant incrustées à mes langues et mon corps étant pris dans les deux à la fois, je me passerai de la tentation d’entériner le divis cartésien irrémédiablement établi, et emprunterai plutôt du vocabulaire architectural de Claude Parent et Paul Virilio, afin d’avancer la proposition suivante : celle de la traduction comme pratique relationnelle oblique, dont les intimités entraînent le frottement de textes à certains endroits et les désalignements béants à d’autres, la partition des corps de textes là précisément où ils se touchent, c’est-à-dire en traduction imparfaite, c’est-à-dire catastrophiquement désalignées. J’ajouterai à ceci un paradoxe étymologique opportun, soit que le verbe autoritaire intimer, dont le corollaire anglais to intimate, signifie à la fois la communication implicite (invertie) et explicite (extrovertie) d’une information, en même temps qu’une déclaration de guerre (son acception anglaise). En écrivant ceci, j’ai en tête une photo de Claude Cahun de 1928 intitulé Que me veux-tu ? dans laquelle, doublement exposée, elle se mire (elle se mirent ?) avec accusation, et plusieurs photographies de Paul Virilio des bunkers inclinés qui constituent l’Atlantikwall. Il s’agit, je le concède volontiers, d’une étrange architecture de corps, d’un paysage insolite à partir duquel réfléchir inversement la traduction.
C’est vrai, j’ai dit : inverti. C’était et ce n’était pas un lapsus. Ce qu’accomplit Claude Cahun dans cette photographie, dans laquelle elle se détourne, est, à mon avis, exemplaire des sortes d’expropriations à l’œuvre dans l’œuvre de l’(auto-)traduction ou de la traduction (soi-)disant. Toute traduction n’est pas de facto une traduction (soi-)disant et ne concerne pas catégoriquement la traduction de ses propres textes. Depuis 2006, je suis à la fois possédée par est dépossédée de Claude Cahun, deux photos en particulier, et l’exégèse de cette dépossession a donné plusieurs textes, chacun desquels remet en question la localisation – ainsi que la dislocation – de moi(s). Sien(ne)s, mien(ne)s. Cela est en partie redevable à la prolifération de je dans l’œuvre de Cahun, à nos ressemblances déroutantes, et auprès desquelles je me suis déjà longuement attardée(1), ainsi qu’aux impératifs historiques (éthiques) à l’œuvre dans son œuvre, et finalement à l’indécision linguistique qui agit sur cette pensée, dont le résultat a été un va-et-vient cahoteux entre l’anglais et le français, déclenchant d’autres incohérences (au-delà de celles qui distinguent chaque langue intérieurement), faisant de tout point un point mouvant, et faisant en sorte qu’aucun des délinquants ne soit répondable de son délit.
M’étant ailleurs réservé le droit à des infidélités de tous genres, et l’œuvre de Cahun étant exemplaire dans ce domaine, je m’incline (avec Virilio et Parent) vers une approche de la question de la méconduite de la traduction du point de vue de l’étrangement, ce qui m’a ostensiblement égarée dans un premier lieu. (L’égarement ayant quitté L’absence au lieu, pour arriver dans Absence Where As sous la forme d’estrangement, désalignant les versions, et non, et j’insiste là-dessus, les annulant, en sorte ici que l’encontre suggère et implique la coexistence littérale (et latérale) de versions, qui seraient ou ne seraient pas capables de s’adresser l’une à l’autre). C’est ici, sans doute, que la langue allemande intervient dans la très précaire équation interrogée : ç’en est une qui refuse l’équivalence et rebute la vérifiabilité. En posant l’allemand contre, c’est-à-dire en même temps que et en contradiction avec le français, non seulement plusieurs tremblements commencent-ils à déstabiliser les lieux à partir desquels j’ai l’habitude de travailler, mais il y a aussi la manifestation d’une élucidation concomitante de dis-temporalités. Les distinctions sont d’une telle évidence qu’il n’est pas possible de se laisser amadouer par des incitations à la mêmeté, une mêmeté qui n’est nulle part en évidence, même et surtout pas dans les sortes de proximités qui seraient présentes entre langues (soi-)disant romanes, celles-ci n’étant pas réductibles à des considérations d’accent ou d’allure.
Lorsque Kaufmann traduit cette phrase de Buber : it does not help you to survive, il dit autre chose que le il ne fait rien pour te conserver en vie de Bianquis. La force vitale littérale de cette phrase, la force derrière l’existence, se manifeste hiérarchiquement dans une version (sur-vie) ; dans l’autre il s’agit d’une prolongation latérale évocatrice des technologies modernes de support artificiel. Être conservé en vie serait vivre à la merci d’une opérative dominante. Survivre, c’est se tenir au-dessus de – une position contraire à la compréhension, en anglais la position est littéralisée par l’understanding, là où nous avons commencé, dans begreifen. Mais l’allemand de Buber ne m’étant pas intelligible, je m’arrêterai là, et porterai mes attentions avides sur une question corollaire, celle de l’hermaphrodisme.
C’est sans doute la preuve d’une irrégularité que d’être confronté à la fois à Buber et à l’hermaphrodisme en une seule et même phrase, mais je me désintéresse obstinément des capricieuses lois de la filiation intellectuelle. Buber demeure donc mon conduit à l’hermaphrodisme par le biais d’une disjonction linguistique – l’étonnant jumelage d’une langue saxonne et d’une langue romane à partir desquelles les irrégularités tactiles déploient éventuellement d’inhabituels plaisirs et tensions textuels. C’est ce it does not help you to survive accouplé au il ne fait rien pour te conserver en vie, cette infime différenciation qui fait faire au texte un glissement, tel que superposés, leur joncture aurait comme résultat un bredouillis, une double-prise, un bégaiement, un flou tribade.
Un flou est justement là où je risque de rencontrer l’hermaphrodisme, ou comme je l’ai autrement écrit : « Hermaphrodite est une parole désirée dans un corps inintelligible » – ici, l’anglais est incapable de signifier le dit incrusté au mot hermaphrodite. Je constate que j’aurais très bien pu me passer de l’exégèse et ne m’en tenir qu’à ce mot en le présentant avec ses contradictions constitutives, des contradictions qui ne sont pas automatiquement apparentes dans le couple herma et aphrodite ; cette contradiction est actuellement si coutumière qu’elle ne contrevient à aucune des lois régissant l’accouplement, elle consolide regrettablement un binarisme typique. Non, ce n’est pas en cela que m’enchante l’hermaphrodite, qui appelle un défaut de réciprocité, mais son inintelligibilité incommunicable. Ce qu’il dit, dirait, dans une langue, et non pas dans une autre.
Sur le plan syntactique, le sexe de la phrase n’est pas (forcément) transférable. Un corps ainsi déstabilisé perd de vue son référent en (se) transversant dans une autre langue. La préoccupation pronominale de l’anglais, par exemple, isole le genre du sujet grammatical, qui se trouve à être dispersé dans la phrase de langue française. Là où l’un profite de l’ambiguïté, l’autre tombe dans la normalité. Afin de disloquer la mainmise du français, l’on doit s’évertuer au désaccord, la mésentente grammaticale, au lieu de la malfaisance émasculante de l’anglais.
On est du jamais vu et inappelé… ée. L’hermaphrodisme serait cela, une plongée dans le corps désirant loin des préoccupations nominales. Masculin et féminin ou aucun, c’est-à-dire ailleurs, ce qui pour moi est acte de présence : là. Loin des formes décidées, d’un discours politique arrêté mais : en face. Être pris au dépourvu c’est quand même se donner à l’instant. L’instant dans sa durée.
Le défaut de réciprocité est ici la gageure de la réciprocité. Le vigile dans l’absence l’un de l’autre, deux textes (au moins) collatéraux, (se) disant l’insistance plurielle de Buber qui veut que – « Tu ne puisses t’entendre à son sujet avec personne ». C’est ce malentendu, cette mésentente – l’impossibilité de réciprocité qui enflamme la prise du désir. Dire « tu » en texte crève la veine pronominale, rend fidèle cette infidélité.
N.
Chicago, avril 2010
——
(1) L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert), Québec, Nota Bene, coll. « Nouveaux essais Spirale », 2007 ; Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book), New York, Nightboat Books, 2009 ; Vigilous, Reel : Desire (a)s accusation, San Francisco, Albion Books, 2010 ; etc.
——
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.
——-
Liste non exhaustive des publications de Nathanaël
Sisyphus, Outdone. Theatres of the Catastrophal (Nightboat Books, 2012)
Carnet de somme (Le Quartanier, 2012)
Carnet de délibérations (Le Quartanier, 2011)
We Press Ourselves Plainly (Nightboat Books, 2010)
Vigilous, Reel: Desire (a)s accusation (Albion Books, 2010)
Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book) (Nightboat Books, 2009)
Carnet de désaccords (Le Quartanier, 2009)
At Alberta (BookThug, 2008)
The Sorrow And The Fast Of It (Nightboat Books, 2007)
…s’arrête? Je (L’Hexagone, 2007)
L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert) (Nota Bene, 2007)
Touch to Affliction (Coach House, 2006)
Je Nathanaël (BookThug, 2006)
L’INJURE (L’Hexagone, 2004)
Paper City (Coach House, 2003)
Je Nathanaël (L’Hexagone, 2003)
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris