Faire le vide.
Si je m’arrête sur une seule phrase comme sur une image, en vidant la feuille des signes devenus soudain superflus, ou bien se propulsant comme un courant, en écartant le cadre justement d’une convention philosophique, ce qui m’est donné, à moi comme à d’aucuns, et ce qui, de toute façon m’aiguille et m’aimante, à la façon d’un rêve, parfois d’épouvante, et survenu dans un film, où en tant qu’unique spectateur, c’est-à-dire démultiplié, je me fais le témoin mutique, sans le vouloir, donc incidemment, et du coup par accident, et de bobine en bobine, des morts solitaires de Mizoguchi telles qu’elles adviennent à la pensée de Gilles Deleuze, suspendue entre les flots sinon de rhétorique qui saisiraient du mouvement sa temporalité, alors qu’il n’appartient à aucun langage finalement qui voudrait le dire, ni le nom du cinéaste, ce sont ces mots mêmes qui se détachent de la densité de la ciné-philosophie¹, comme une vérité non-vérifiable, c’est-à-dire profonde et profondément émue de ce qu’elle s’est fait voir, sans justement le désirer, et en marge de ses propres limites. « Les morts solitaires » de Mizoguchi sont des femmes, toutes, et sans aucun doute, il ne suffit de les énumérer, ni d’en faire un catalogage, des films de Mizoguchi Kenji, rescapés de l’histoire du cinéma ainsi que les naufragés dont ne subsiste que le titre, chacun son tombeau, de film en feu le cinéma, à commencer par l’insolite image après-guerre déjà tant commentée, d’une impotente déesse de la chrétienté, abandonnée à sa honte, et surplombant de sa tour de pierres au cœur de l’église en ruines et par l’éclat estompé de son vitrail dévitrifié, le square où les femmes de la nuit se ruent les unes sur les autres, a posteriori, sous une icône sans voix et donc sans promesse sinon syphilitique, qui dit non pas la prière occidentale implantée à Osaka, son outrecuidante compassion, mais la matière humaine réduite à sa volumineuse poussière.² Si, comme l’affirme le cinéaste dans ses notes de travail, « il faut de l’émotion, non pas un commentaire, »³ il est à s’interroger sur la justesse d’un débit dont l’intention serait de cerner l’appareil qui fait fuir, jusque dans les rets du langage, le sens dont il est question, le plan-séquence d’une pensée à peine car réduite au silence dont elle voudrait se défaire. Ce silence, au pluriel, aurait nom de ville et corps de quartier, de Kyōtō à Ōsaka, et de Gion à Shinsekai, en feuilletant les ères comme les époques, du Heian à Showa, en s’attardant longuement sur l’ère Meiji. Les « morts solitaires » de Mizoguchi sont des femmes, toutes, et dont chacune meurt dans l’œil du cinéma, sous les mains invisibles des conventions, et dans les feux de l’amour trahi par son armature, c’est-à-dire le regard sensible du cinéaste, retourné sous sa fragile paupière, les embruns de la pellicule embuée. Les cercles concentriques descendant, infernaux, de bassesse en bassesse, s’effacent aussi assidûment qu’ils se produisent, le corps autant que le visage, abandonnés au grincement de la ville ou au chant déporté d’une mère ou d’un amant. Autant ces noms se vouent posthumes à l’écran scandant leur esseulement, autant les sujets individuels des récits cinématiques s’avèrent être isolés à l’intérieur de la houle historienne dans laquelle ils sont inexorablement entraînés et à laquelle ils s’assujettissent. Car la mort à tous les coups, est une espèce de meurtre, décantée dans le temps, avec comme écran la seule permanence dévastée (celle de la guerre et de la prostitution, conjugale ou illicite). Le regard final porté dans les roseaux sur la mort d’Oyū-sama4 intentée contre sa propre personne dit la limite absolue d’une subjectivité qui se révèle être absence de limite possible, et renoncement à la succession, à tout lien d’inimité avec le monde ainsi tel qu’il lui est refusé. Monde sans je auquel le cinéaste se voue en aparté à l’approche du philosophe, et qui fait résonner les vers de Sōseki Natsume lorsqu’à la mort d’une amie, il écrit
Tous les chrysanthèmes
Que vous trouvez, jetez-les
Au creux du cercueil5
Il n’y a pas, dans Mizoguchi, de cercueil, mais un monde en creux, dédoublé sur les berges du fleuve, à l’extrémité d’une île sans fond, ou sur un bord de route sans traversée, et même là où s’étire, sous une monticule funèbre, le regard par-delà un mensonge avoué, le corps, alourdi, en perd le visage et le présent ne peut que se résorber dans le temps. Surtout lorsque le dernier plan rejoint le premier, jusqu’à en être méconnaissable, car n’étant pas le même.6 L’horizon ainsi fait est une douleur, et le vertige appelle l’inaboutissement de la verticalité, chute libre d’une vision statufiée,7 ou les mains dans l’eau, les hiérarchies entêtées jusqu’à leur tranchement.8
*
Lors d’un entretien accordé après la mort du cinéaste, Yoda Yoshikata commente une calligraphie inscrite de la main du cinéaste : « Vous voyez, ce tense (calligraphie) comporte quatre caractères, dont le dernier est tout simplement le dessin d’un œil. Les quatre ensemble signifient ‘À chaque nouveau regard, il faut se laver les yeux.’ … »9
À la mort de Mizoguchi Kenji, il a été fait don à Henri Langlois de son masque mortuaire, et celui-ci fait aujourd’hui partie des archives de la Cinémathèque française à Bercy. Le masque, peau figée, non seulement du visage du cinéaste, mais effigie de sa propre « mort solitaire », consolide l’enchaînement de trépas qui se fondent à ses films, jusque dans le muet engloutissement d’Anju,10 tue afin de sauver son frère Zushio, pour y échouer, là justement où l’attend la voix éteinte du philosophe. Car en quoi le regard assume-t-il la forme de ce qu’il (se) voit et de ce qui, éventuellement, le dévoie. Si toutes ces morts dites solitaires, captées ensuite évacuées, s’avouent et s’échouent chacune et individuellement dans un corps de femme sans monde véritable, c’est à croire, avec Mizoguchi, placé sous l’œil de Deleuze, à leur déclinaison en tout temps, au féminin. D’où l’impossible du voir et le renversement du savoir sur lequel il s’appuie. Les « morts solitaires » de Mizoguchi Kenji sous l’enseigne de Gilles Deleuze ne sont autre que l’appel sans je au monde transgenre échappé au corps ainsi désigné.
Nathanaël
Chicago, 2017
1. Gilles Deleuze. L’image-mouvement. Minuit. Paris, 1983 (265).
2. Yoru no onna tachi—Les femmes de la nuit, 1948.
3. Yoda Yoshikata, Souvenirs de Kenji Mizoguchi, tr. Koichi Yamada, et al. Cahiers du Cinéma. Paris, 1997 (107).
4. Oyū-sama, Miss Oyu, 1951.
5. Sōseki Natsume. À travers la vitre, tr René de Ceccatty et Ryōji Nakamura. Payot & Rivages. Paris, 2001 (89). Ces vers sont dédiés à la poète Ōtsuka Kusuo (1875-1910).
6. Ugetsu monogatarai Contes de la lune vague après la pluie, 1953.
7. Yōkihi, L’impératrice Yang Kwang-Fei, 1955.
8. Tōkyō kōshinkyoku, La marche de Tokyo, 1929.
9. « Mizoguchi », Cahiers du cinéma, hors série, septembre 1978 (22).
10. Sanshō Dayū, L’intendant Sansho, 1954.
Nathanaël est l’auteure d’une trentaine de livres publiés aux États-Unis, au Québec et en France, dont notamment, N’existe (2017), Feder : a scenario (2016) et L’heure limicole (2016). Elle a traduit en anglais Édouard Glissant, Danielle Collobert, Hilda Hilst et Hervé Guibert, et en français, Reginald Gibbons, John Keene et Trish Salah. Nathanaël vit à Chicago.
Ouvrages de Nathanaël (liste sélective)
D’un geste décidé. Fidel Anthelme x, 2018.
La mort de ma sœur. Dernier Télégramme, 2018.
Pasolini’s Our. Nightboat Books, 2018.
Le cri du chrysanthème. Le Quartanier, 2018.
N’existe. Le Quartanier, 2017.
Laisse (rejet apparent). Mémoire d’encrier, 2016.
Feder : a scenario. Nightboat Books, 2016.
L’heure limicole. Fidel Anthelme x, 2016.
The Horses That Comes Out of Our Heads. O’Clock Press, 2016.
Asclepias : The Milkweeds. Nightboat Books, 2015.
The Middle Notebookes. Nightboat Books, 2015.
Sotto l’immagine. Mémoire d’encrier, 2014.
Sispyhus, Outdone. Theatres of the Catastrophal. Nightboat Books, 2012.
Carnet de somme. Le Quartanier, 2012.
Carnet de délibérations. Le Quartanier, 2011.
We Press Ourselves Plainly. Nightboat Books, 2010.
Carnet de désaccords. Le Quartanier, 2009.
Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book). Nightboat Books, 2009.
At Alberta. BookThug, 2008.
L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert). Nota Bene, 2007.
etc.
—————————————–
Pour la littérature et la radio. Pour le financement d’une revue en ligne qui donne à lire des textes de facture littéraire et donne à entendre des émissions radiophoniques. Pour le financement d’un journal papier qui donne à lire le présent par la littérature.
—————————————–
//////////////// Autres documents
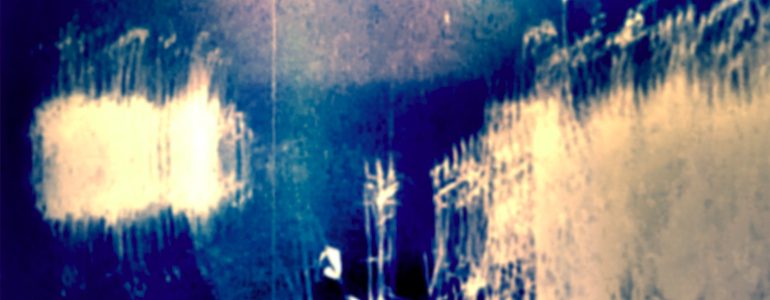
Amandine André invite Liliane Giraudon & Nathanaël
Discussions et lectures, archive décembre 2013, Manifesten, Marseille.
Sommaire de la discussion >> deux écritures peuplées de fantômes – la correspondance – la consolation – la violence de la langue – la différence entre le Français et l’Anglais – le corps de la langue, l’incorporation – que peut la littérature ? – le rapport à la lecture – se faire un corps, le corps étendu des œuvres – le genre dans la langue du Français à l’Anglais, de l’Anglais au Français – la morale sexuelle des surréalistes

« Il y a eu des pages en trop, des pages venues après les Carnets, des annotations, des désistements parfois, une douleur qui se rapprochait déjà ; s’agissait-il de la même douleur. Elle portait déjà un chiffre, il a été nécessaire de remonter les années de refus, non pas pour les compter, mais afin, peut-être, d’en saisir l’ampleur, et la vigueur. Le non m’aura longtemps fait marcher. »
Nathanaël
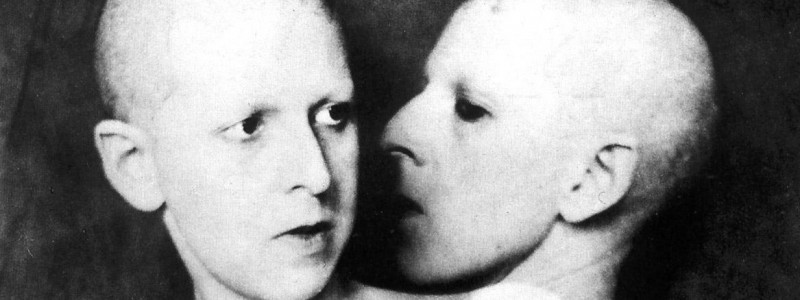
par Nathanaël
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.



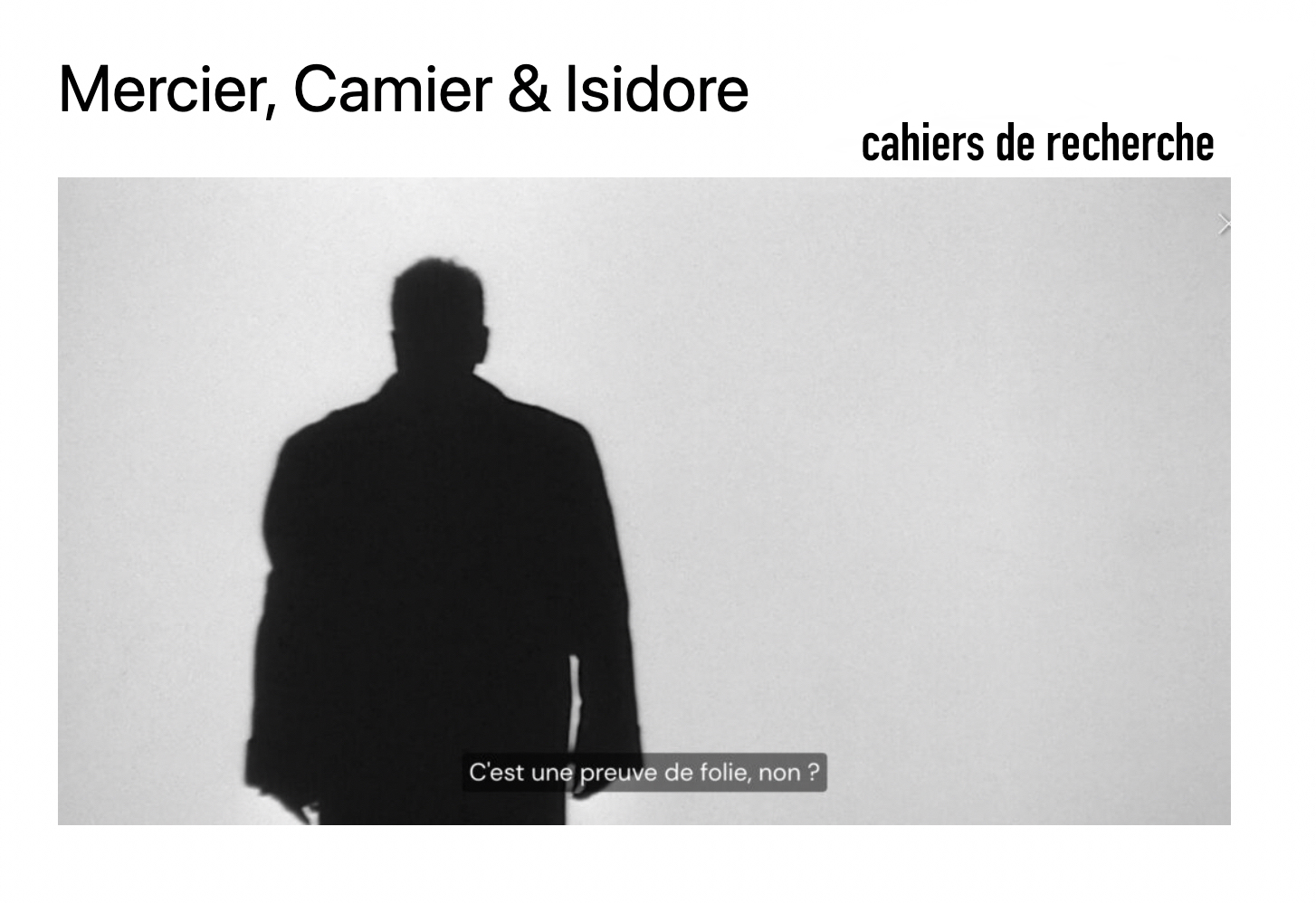




Les morts solitaires de Mizoguchi Kenji
Faire le vide.
Si je m’arrête sur une seule phrase comme sur une image, en vidant la feuille des signes devenus soudain superflus, ou bien se propulsant comme un courant, en écartant le cadre justement d’une convention philosophique, ce qui m’est donné, à moi comme à d’aucuns, et ce qui, de toute façon m’aiguille et m’aimante, à la façon d’un rêve, parfois d’épouvante, et survenu dans un film, où en tant qu’unique spectateur, c’est-à-dire démultiplié, je me fais le témoin mutique, sans le vouloir, donc incidemment, et du coup par accident, et de bobine en bobine, des morts solitaires de Mizoguchi telles qu’elles adviennent à la pensée de Gilles Deleuze, suspendue entre les flots sinon de rhétorique qui saisiraient du mouvement sa temporalité, alors qu’il n’appartient à aucun langage finalement qui voudrait le dire, ni le nom du cinéaste, ce sont ces mots mêmes qui se détachent de la densité de la ciné-philosophie¹, comme une vérité non-vérifiable, c’est-à-dire profonde et profondément émue de ce qu’elle s’est fait voir, sans justement le désirer, et en marge de ses propres limites. « Les morts solitaires » de Mizoguchi sont des femmes, toutes, et sans aucun doute, il ne suffit de les énumérer, ni d’en faire un catalogage, des films de Mizoguchi Kenji, rescapés de l’histoire du cinéma ainsi que les naufragés dont ne subsiste que le titre, chacun son tombeau, de film en feu le cinéma, à commencer par l’insolite image après-guerre déjà tant commentée, d’une impotente déesse de la chrétienté, abandonnée à sa honte, et surplombant de sa tour de pierres au cœur de l’église en ruines et par l’éclat estompé de son vitrail dévitrifié, le square où les femmes de la nuit se ruent les unes sur les autres, a posteriori, sous une icône sans voix et donc sans promesse sinon syphilitique, qui dit non pas la prière occidentale implantée à Osaka, son outrecuidante compassion, mais la matière humaine réduite à sa volumineuse poussière.² Si, comme l’affirme le cinéaste dans ses notes de travail, « il faut de l’émotion, non pas un commentaire, »³ il est à s’interroger sur la justesse d’un débit dont l’intention serait de cerner l’appareil qui fait fuir, jusque dans les rets du langage, le sens dont il est question, le plan-séquence d’une pensée à peine car réduite au silence dont elle voudrait se défaire. Ce silence, au pluriel, aurait nom de ville et corps de quartier, de Kyōtō à Ōsaka, et de Gion à Shinsekai, en feuilletant les ères comme les époques, du Heian à Showa, en s’attardant longuement sur l’ère Meiji. Les « morts solitaires » de Mizoguchi sont des femmes, toutes, et dont chacune meurt dans l’œil du cinéma, sous les mains invisibles des conventions, et dans les feux de l’amour trahi par son armature, c’est-à-dire le regard sensible du cinéaste, retourné sous sa fragile paupière, les embruns de la pellicule embuée. Les cercles concentriques descendant, infernaux, de bassesse en bassesse, s’effacent aussi assidûment qu’ils se produisent, le corps autant que le visage, abandonnés au grincement de la ville ou au chant déporté d’une mère ou d’un amant. Autant ces noms se vouent posthumes à l’écran scandant leur esseulement, autant les sujets individuels des récits cinématiques s’avèrent être isolés à l’intérieur de la houle historienne dans laquelle ils sont inexorablement entraînés et à laquelle ils s’assujettissent. Car la mort à tous les coups, est une espèce de meurtre, décantée dans le temps, avec comme écran la seule permanence dévastée (celle de la guerre et de la prostitution, conjugale ou illicite). Le regard final porté dans les roseaux sur la mort d’Oyū-sama4 intentée contre sa propre personne dit la limite absolue d’une subjectivité qui se révèle être absence de limite possible, et renoncement à la succession, à tout lien d’inimité avec le monde ainsi tel qu’il lui est refusé. Monde sans je auquel le cinéaste se voue en aparté à l’approche du philosophe, et qui fait résonner les vers de Sōseki Natsume lorsqu’à la mort d’une amie, il écrit
Tous les chrysanthèmes
Que vous trouvez, jetez-les
Au creux du cercueil5
Il n’y a pas, dans Mizoguchi, de cercueil, mais un monde en creux, dédoublé sur les berges du fleuve, à l’extrémité d’une île sans fond, ou sur un bord de route sans traversée, et même là où s’étire, sous une monticule funèbre, le regard par-delà un mensonge avoué, le corps, alourdi, en perd le visage et le présent ne peut que se résorber dans le temps. Surtout lorsque le dernier plan rejoint le premier, jusqu’à en être méconnaissable, car n’étant pas le même.6 L’horizon ainsi fait est une douleur, et le vertige appelle l’inaboutissement de la verticalité, chute libre d’une vision statufiée,7 ou les mains dans l’eau, les hiérarchies entêtées jusqu’à leur tranchement.8
*
Lors d’un entretien accordé après la mort du cinéaste, Yoda Yoshikata commente une calligraphie inscrite de la main du cinéaste : « Vous voyez, ce tense (calligraphie) comporte quatre caractères, dont le dernier est tout simplement le dessin d’un œil. Les quatre ensemble signifient ‘À chaque nouveau regard, il faut se laver les yeux.’ … »9
À la mort de Mizoguchi Kenji, il a été fait don à Henri Langlois de son masque mortuaire, et celui-ci fait aujourd’hui partie des archives de la Cinémathèque française à Bercy. Le masque, peau figée, non seulement du visage du cinéaste, mais effigie de sa propre « mort solitaire », consolide l’enchaînement de trépas qui se fondent à ses films, jusque dans le muet engloutissement d’Anju,10 tue afin de sauver son frère Zushio, pour y échouer, là justement où l’attend la voix éteinte du philosophe. Car en quoi le regard assume-t-il la forme de ce qu’il (se) voit et de ce qui, éventuellement, le dévoie. Si toutes ces morts dites solitaires, captées ensuite évacuées, s’avouent et s’échouent chacune et individuellement dans un corps de femme sans monde véritable, c’est à croire, avec Mizoguchi, placé sous l’œil de Deleuze, à leur déclinaison en tout temps, au féminin. D’où l’impossible du voir et le renversement du savoir sur lequel il s’appuie. Les « morts solitaires » de Mizoguchi Kenji sous l’enseigne de Gilles Deleuze ne sont autre que l’appel sans je au monde transgenre échappé au corps ainsi désigné.
Nathanaël
Chicago, 2017
1. Gilles Deleuze. L’image-mouvement. Minuit. Paris, 1983 (265).
2. Yoru no onna tachi—Les femmes de la nuit, 1948.
3. Yoda Yoshikata, Souvenirs de Kenji Mizoguchi, tr. Koichi Yamada, et al. Cahiers du Cinéma. Paris, 1997 (107).
4. Oyū-sama, Miss Oyu, 1951.
5. Sōseki Natsume. À travers la vitre, tr René de Ceccatty et Ryōji Nakamura. Payot & Rivages. Paris, 2001 (89). Ces vers sont dédiés à la poète Ōtsuka Kusuo (1875-1910).
6. Ugetsu monogatarai Contes de la lune vague après la pluie, 1953.
7. Yōkihi, L’impératrice Yang Kwang-Fei, 1955.
8. Tōkyō kōshinkyoku, La marche de Tokyo, 1929.
9. « Mizoguchi », Cahiers du cinéma, hors série, septembre 1978 (22).
10. Sanshō Dayū, L’intendant Sansho, 1954.
Nathanaël est l’auteure d’une trentaine de livres publiés aux États-Unis, au Québec et en France, dont notamment, N’existe (2017), Feder : a scenario (2016) et L’heure limicole (2016). Elle a traduit en anglais Édouard Glissant, Danielle Collobert, Hilda Hilst et Hervé Guibert, et en français, Reginald Gibbons, John Keene et Trish Salah. Nathanaël vit à Chicago.
Ouvrages de Nathanaël (liste sélective)
D’un geste décidé. Fidel Anthelme x, 2018.
La mort de ma sœur. Dernier Télégramme, 2018.
Pasolini’s Our. Nightboat Books, 2018.
Le cri du chrysanthème. Le Quartanier, 2018.
N’existe. Le Quartanier, 2017.
Laisse (rejet apparent). Mémoire d’encrier, 2016.
Feder : a scenario. Nightboat Books, 2016.
L’heure limicole. Fidel Anthelme x, 2016.
The Horses That Comes Out of Our Heads. O’Clock Press, 2016.
Asclepias : The Milkweeds. Nightboat Books, 2015.
The Middle Notebookes. Nightboat Books, 2015.
Sotto l’immagine. Mémoire d’encrier, 2014.
Sispyhus, Outdone. Theatres of the Catastrophal. Nightboat Books, 2012.
Carnet de somme. Le Quartanier, 2012.
Carnet de délibérations. Le Quartanier, 2011.
We Press Ourselves Plainly. Nightboat Books, 2010.
Carnet de désaccords. Le Quartanier, 2009.
Absence Where As (Claude Cahun and the Unopened Book). Nightboat Books, 2009.
At Alberta. BookThug, 2008.
L’absence au lieu (Claude Cahun et le livre inouvert). Nota Bene, 2007.
etc.
—————————————–
Soutenez La vie manifeste, soutenez Hector. Versez un don à la cagnotte en suivant ce lien.
Pour la littérature et la radio. Pour le financement d’une revue en ligne qui donne à lire des textes de facture littéraire et donne à entendre des émissions radiophoniques. Pour le financement d’un journal papier qui donne à lire le présent par la littérature.
—————————————–
//////////////// Autres documents
Correspondances fantômes
Amandine André invite Liliane Giraudon & Nathanaël
Discussions et lectures, archive décembre 2013, Manifesten, Marseille.
Sommaire de la discussion >> deux écritures peuplées de fantômes – la correspondance – la consolation – la violence de la langue – la différence entre le Français et l’Anglais – le corps de la langue, l’incorporation – que peut la littérature ? – le rapport à la lecture – se faire un corps, le corps étendu des œuvres – le genre dans la langue du Français à l’Anglais, de l’Anglais au Français – la morale sexuelle des surréalistes
Pages enlevées
« Il y a eu des pages en trop, des pages venues après les Carnets, des annotations, des désistements parfois, une douleur qui se rapprochait déjà ; s’agissait-il de la même douleur. Elle portait déjà un chiffre, il a été nécessaire de remonter les années de refus, non pas pour les compter, mais afin, peut-être, d’en saisir l’ampleur, et la vigueur. Le non m’aura longtemps fait marcher. »
Nathanaël
Traduction (soi-)disant : une expropriation d’intimités
par Nathanaël
Le texte que voici a été prononcé le 14 avril 2011, au Centre d’études poétiques, ÉNS-Lyon, lors d’une journée d’études transdisciplinaires organisée par Myriam Suchet. Nathanaël est l’auteure d’une vingtaine de livres, dont le triptyque de carnets, Carnet de désaccords, Carnet de délibérations et Carnet de somme. Ses traductions comprennent des ouvrages d’Édouard Glissant, de Danielle Collobert, de Catherine Mavrikakis, de Hilda Hilst, et d’Hervé Guibert. Elle vit à Chicago.
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris