Madison, mars 2018
Lettre adressée à Amandine André
au sujet d’une performance
de Yoko Ono
Chère Amandine,
Tu m’as demandé si j’accepterais d’écrire quelque chose au sujet d’une performance de Yoko Ono, Cut Piece, qui a eu lieu pour la première fois en 1964. Tu m’as envoyé un lien permettant d’assister à plus de neuf minutes de cette performance, telle que Yoko Ono l’a reprise en 19651 : on peut voir l’artiste presqu’immobile, impassible, tandis que les membres du public, un par un, sont autorisés à couper et emporter une partie de ses vêtements. Pour le coup, j’accepte volontiers d’essayer d’écrire quelque chose à propos de cette performance, car je me demande bien ce qu’il s’agit de couper et d’emporter, de prendre – ou de donner.
Prendre, donner, je crois qu’il s’agit de cela dans cette performance, et je voudrais rendre visible cette matrice symbolique, et j’emploie le terme de matrice à dessein puisque ce qui s’impose, d’abord, au vu de l’enregistrement que tu m’as envoyé, relève – à première vue – d’une violence faite à une femme. Violence de l’objet à partir duquel la transaction s’effectue entre Yoko Ono et les spectateurs, ou disons les actants (ce n’est pas que j’aime ce terme, mais en l’occurrence il convient plutôt bien) : une paire de ciseaux. Car l’action, ici, c’est prendre. Et c’est prendre sur, prendre à, par violence faite sur le vêtement, qui est mis en pièces. Des pièces sont donc coupées, et elles sont coupées non pas sur une étoffe quelconque, matériaux bruts d’un vêtement en préparation, elles sont prises sur une totalité déjà constituée, un être vivant, même s’il est passif. Voilà que des trous apparaissent, et comme tu vas pouvoir le voir, le lire, c’est quelque chose sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises.
Donc, une violence est faite et elle est faite, dans les archives qu’il m’a été donné de consulter, quant au corps féminin, et l’on trouvera aisément sur internet des analyses qui vont insister sur ce que cette performance nous montre de l’agression sexuelle permanente faite aux femmes2. Cette interprétation n’est pas nouvelle, on en trouve trace dans des catalogues ou des émissions télévisées des années 1990 mais, point sur lequel je voudrais aussi revenir, elle n’était pas obvie dans les années 1960 et 1970 ! Toujours est-il que le contexte dans lequel je t’écris cette lettre, celui de « #MeToo » et « balance ton porc », n’est pas sans influencer la manière que j’ai de regarder cette performance – mais justement, quelle est cette influence ?
Je dois te dire que mon but n’est certainement pas d’analyser la performance de Yoko Ono avec « #MeToo » ; c’est plutôt le contraire qui m’intéresse, qui devrait, je crois, nous intéresser : analyser « #MeToo » à partir de la performance. Pourquoi ? Et en quel sens le passé nous importe ? Je ne suis pas un juge, je ne suis pas là pour condamner à perpétuité ce qui a lieu, je suis là pour aller susciter dans le passé la justice qui n’a pas eu lieu, c’est-à-dire chercher à ressusciter les puissances de justice endormies, ou non-reconnues, ou empêchées d’être. Mieux vaut à ce titre révéler, inventer un Freud féministe que passer son temps à dénoncer les rapports de Freud avec sa fille. Mieux vaut ce Freud contre lui-même que pas de Freud du tout. Mais il vrai qu’aujourd’hui l’idée même d’inconscient est un délit : dans un monde unidimensionnel, hyper-connecté, phobique de la séparation, l’idée même qu’il puisse exister une forme artistique non réductible à l’agent de chair et de sang qui l’a produite est potentiellement criminelle. C’est en effet que quand tout est dit relié, rien ne peut se réserver du monde, personne ne peut prétendre à quelque zone de non-su, sauf à être considéré comme méditant quelque malversation. Je crois que la pulsion de condamnation rétroactive tient à cette vision unilatérale du monde et de l’histoire, celle-ci devenant l’illustration ratée de ce que nous saurons refaire, en mieux, en plus sain, en plus moral, aujourd’hui.
C’est aussi ce type de problèmes, de questions, que me pose l’idée d’un racisme ou d’un sexisme structurel. Ce qui est utile, et nécessaire dans cette idée, est d’éviter de parler en termes d’individus, qui seraient des cas uniques, qui devraient être traités psychologiquement et dont on pourrait expliquer les actions – sexistes, racistes – à partir de circonstances spécifiques. Contre l’idée de monstres isolés, ou de troubles psychiques invoqués pour expliquer quelque crime raciste ou sexiste, c’est bien un système sexiste, un sexisme d’État institué par voie administrative, qu’il faut désigner en tant qu’il est aussi à l’œuvre dans l’esprit des administrés que nous sommes. Le phallocentrisme est véhiculé par tout porteur de phallus, supposé mâle ou lesbienne (je me réfère ici à un texte crucial de Judith Butler sur le « phallus lesbien ») – de cela, je ne doute pas. Le problème, c’est quand le sexisme structurel nous fait passer de l’individu d’exception à la norme muette que chacun serait censé exprimer : en passant de l’individu psychologiquement déterminé à la structure de déterminations sociale, on est passé d’une erreur à une autre, et on a maintenu la même pensée carcérale. Comment en effet répondre de la structure, avant même de pouvoir s’opposer à ce qu’elle provoque, si ce n’est précisément en s’exposant comme non totalement structuré par elle, ou comme capable de montrer notre capacité à ne pas répondre de cette structure ? N’est-ce pas, d’une certaine manière, ce que Yoko Ono performe dans Cut Piece ? La liberté consiste dans notre capacité à montrer que la norme ne marche pas, jamais, sauf à en répondre, et cette réponse est déjà la contre-prise. Être libre c’est dévier de façon créatrice, en laissant la structure s’effondrer au milieu du malstrom que notre subjectivation vive, sauvage, aura créé. Avec « #MeToo » et « balance ton porc », c’est la monstruosité qui devient la structure elle-même.
Mon but n’est pas de dire que ce mouvement est sans raison sociale, c’est le contraire : il est complètement fondé socialement ! Il est sans écart, sans trou. Je pense qu’il correspond à une abréaction sociale et je trouve cette abréaction légitime, il s’agit au sens propre d’une vengeance, c’est-à-dire d’un acte de justice quand la justice est impossible, qu’elle n’a pas été – précisément – rendue, et Lauren Berlant a écrit des choses intéressantes sur ce point, en regard de certaines critiques queer3. Tu sais, j’ai eu la chance d’écouter Silvia Federici à Madison le mois dernier, elle disait qu’elle trouvait ça très bien que des hommes soient jugés pour des délits envers des femmes, mais qu’elle trouvait ça intenable qu’on puisse croire que l’appareil juridique soit en mesure de résoudre le problème de la violence faite aux femmes, alors qu’il y a largement contribué ! Pendant la conférence qu’elle a donnée, et ensuite en réponse à des questions, elle a clairement expliqué que pour elle les réponses ne peuvent pas venir d’abord de l’État, ou d’une institution, mais des formes de vie commune et de solidarité qui rendent impossibles l’horreur des violences faites aux femmes.
Donc, oui, l’appel à la vengeance me semble parfaitement justifié dans certaines circonstance, je pense par exemple aux appels à la vengeance de Louise Michel, attend laisse-moi trouver des citations, voilà : « la fortune est capricieuse », rappelle-t-elle aux vainqueurs qui la jugent, « je confie à l’avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance » et aussi, pour ceux qui indexeraient seulement la Commune au futur : « La Commune, ne l’oublions pas non plus, nous qui avons reçu charge de la mémoire et de la vengeance des assassinés, c’est aussi la revanche »4. Louise Michel parlait de la manière dont le futur devait prendre en charge collectivement l’iniquité du passé, là où « me too » ne pose le problème qu’individu par individu, et au présent. On dira alors que chaque déclaration d’une nouvelle victime augmente le nombre et montre que le problème est massivement systémique ! C’est vrai, mais le système ne peut être combattu que par un passage à l’infini où la somme des cas décrits devient celle de sujets qui ne parlent pas seulement au nom d’elles-mêmes et d’eux-mêmes. Il n’y a pas de politique quand il n’y a que du moi, il y a politique quand on accueille la cause de l’autre, dit Jacques Rancière, quand on se dés-identifie à cause de l’autre, de ce qu’il ou elle m’oblige à prendre en considération et qui n’est pas identique à la situation que je vis. Là encore, on dira – au mieux – que c’est dans le défaut de cet accueil que « #MeToo » apparaît, ça je peux complètement l’admettre. Mais cela ne change pas l’extrême pauvreté politique d’une revendication n’ayant que le moi pour centre.
Alors, quand j’ai vu cette performance de Yoko Ono, quand j’ai vu ces trous, cette prise en corps par pièces, ces prises qui lacèrent non pas en objets mais en déchets ou en déjets, j’ai soudain pensé à ce que trouer, faire trou, peut signifier, et j’ai vu s’écrire « ( )Too », c’est-à-dire une absence à la place de « moi », pour que l’autre, tous, puisse y apparaître. Seulement, en quoi la violence faite au corps de Yoko Ono peut-elle être convertie en quelque chose qui serait de l’ordre d’une positive absence ? Tout d’abord, il faut savoir que Yoko Ono a pu présenter sa performance comme « une manière de donner, de donner et de prendre. C’était une sorte de critique contre les artistes, qui donnent toujours ce qu’ils veulent donner. Je voulais que les gens prennent ce qu’ils voulaient, alors il était très important de leur dire qu’ils pouvaient couper où ils voulaient. C’est une forme de don qui a beaucoup à voir avec le bouddhisme… Une forme de don total par opposition au don raisonnable ».5 Yoko Ono parlera même de « sacrifice » … On est loin semble-t-il de tout féminisme, et il arrivera même à Yoko Ono de répondre, en 1994, à une question relative à ce qu’aurait été son éventuel « proto-féminisme » des années 1960 : « je n’avais aucune notion de féminisme »6…
On dira que cela ne change rien au problème, que ce n’est pas parce que Yoko Ono n’était pas capable de voir en quoi sa performance était relative à la violence faire aux femmes (j’ai entendu dire que John Lennon était peut-être pour la paix mondiale, mais pas forcément envers sa femme) que ce n’était pas le cas. Après tout, elle aussi, dira-t-on, reproduisait le sexisme structurel, la culture du viol. Je ne pense pas du tout que cela soit faux, je me demande seulement si on rend justice à la performance en disant cela. D’une part, on trouve au moins dès 1971 une déclaration de Yoko Ono à propos de Cut Piece disant que « le performeur, cependant, ne doit pas forcément être une femme » et en effet, dès 1966, on a des traces de performeurs masculins, à Central Park, pour Cut Piece7. D’autre part, c’était l’artiste et non même la femme ou l’homme qui était l’objet de la performance de Yoko Ono, l’artiste et son ego, l’artiste qui généralement décide de ce qu’il donne à voir, de ce qu’il présente sans se risquer dans ce qu’il présente. Ce que la performance de Yoko Ono renverse, c’est la structure de la prise, la prise est mise, littéralement, entre les mains des spectateurs devenus sécateurs ! L’artiste perd au change, apparemment.
Apparemment, car il nous faut aller plus loin. Je crois qu’il faut prendre Yoko Ono aux mots quand elle dit, à propos de sa performance : « j’ai toujours voulu produire une œuvre dépourvue d’ego. Je pensais à ce motif de plus en plus, et le résultat de cela fût Cut Piece »8. Et puis maintenant que je cherche à prouver ce que j’avance, je vois des trous partout, forcément… Je vois ainsi le nom de l’artiste plein de trous : yOkO OnO ! Tu vois, il y a bien plus de zéros, d’ensembles vides, dans Yoko Ono que dans le Too de MeToo… Or ces trous, on ne peut pas les mesurer exactement : ce qui est pris met à nu bien plus que ce qui est pris. Ce qui est révélé dépasse toute prise. En donnant, la prise de celui qui coupe est déprise de sa puissance. Bien entendu, il y a cet homme dans la vidéo qui tente de prendre beaucoup, beaucoup trop, il tente de prendre ce qui couvre la poitrine de Yoko Ono, il croit que sa force est une puissance, il n’est pas à même de comprendre que sa force lui vient du dispositif scénique inventé par Yoko Ono ! Il est pourtant vrai qu’hors de la scène de la performance, il y a des coups de force et des prises violentes, réelles, et sans protection scénique. Comment pourtant parvenir à dire que ces coups de force sont misérables au sens où ils révèlent que la force est une impuissance, que la culture du viol n’identifie pas des porcs, animaux élevés pour être mangés, animaux que je comprends toujours à partir d’une chanson de Robert Wyatt (« Pigs… (In There) »), pas même des prédateurs dont ils n’ont pas la carrure, mais des égos qui bouchent le trou percé qui leur sert d’esprit.
Ceci étant, tout ce que je tente de dire ainsi peut être facilement réfuté : faire l’apologie de l’ensemble vide, c’est peut-être seulement renchérir sur le déni du féminin, et conforter le déni de cet Autre de l’Autre, « ce sexe qui n’en est pas un », pour reprendre les termes de Luce Irigaray. Et je ne vais certainement pas moi-même réfuter cet argument, et c’est précisément pour cela que j’écris ces quelques remarques sous la forme d’une lettre qui t’est adressée. Contre la machine unidirectionnelle, contre la phobie de la séparation et le monde plat qu’elle produit, il faut rouvrir des écarts, de la dialectique, mais une dialectique à l’autre, là où ça ne sait pas, là où c’est troué précisément. Adressée à toi, femme en l’occurrence supposée, c’est dire qu’il est hors de question qu’une position théorique vis-à-vis du féminisme, ou des femmes, puisse être posée d’un point assuré du masculin, qui serait dès lors, et nécessairement, un point plein de bêtise. Par toutes les formes d’adresses, l’espace évidé entre les parenthèses – ( ) – accueille ce qui est nombreux, le nombre débordant même les parenthèses du « tout ». Et c’est en définitive cela que je retiens de Cut Piece : ce qui est donné par Yoko Ono est bien plus qu’elle-même ; ce qui sera pris sera dès lors bien moins qu’elle-même. Nous devons apprendre à être inaccessibles.
Frédéric Neyrat
1. Ici : https://vimeo.com/106706806
2. Par exemple : http://womenartandculture.blogspot.com/2012/05/yoko-ono-cut-piece-analysis.html
3. Sur l’idée de vengeance, de « vengeance réflexive », cf. Lauren Berlant, « The Predator and the Jokester » in The New Inquiry, 13 Décembre 2027 (https://thenewinquiry.com/the-predator-and-the-jokester/)
4. Louise Michel, La Commune. Histoire et souvenirs, La Découverte/Poche, 275, 362.
5. Yoko Ono, quoted in Kevin Concannon, “Yoko Ono’s CUT PIECE: From Text to Performance and Back Again,” Imagine Peace (http://imaginepeace.com/archives/2680).
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.



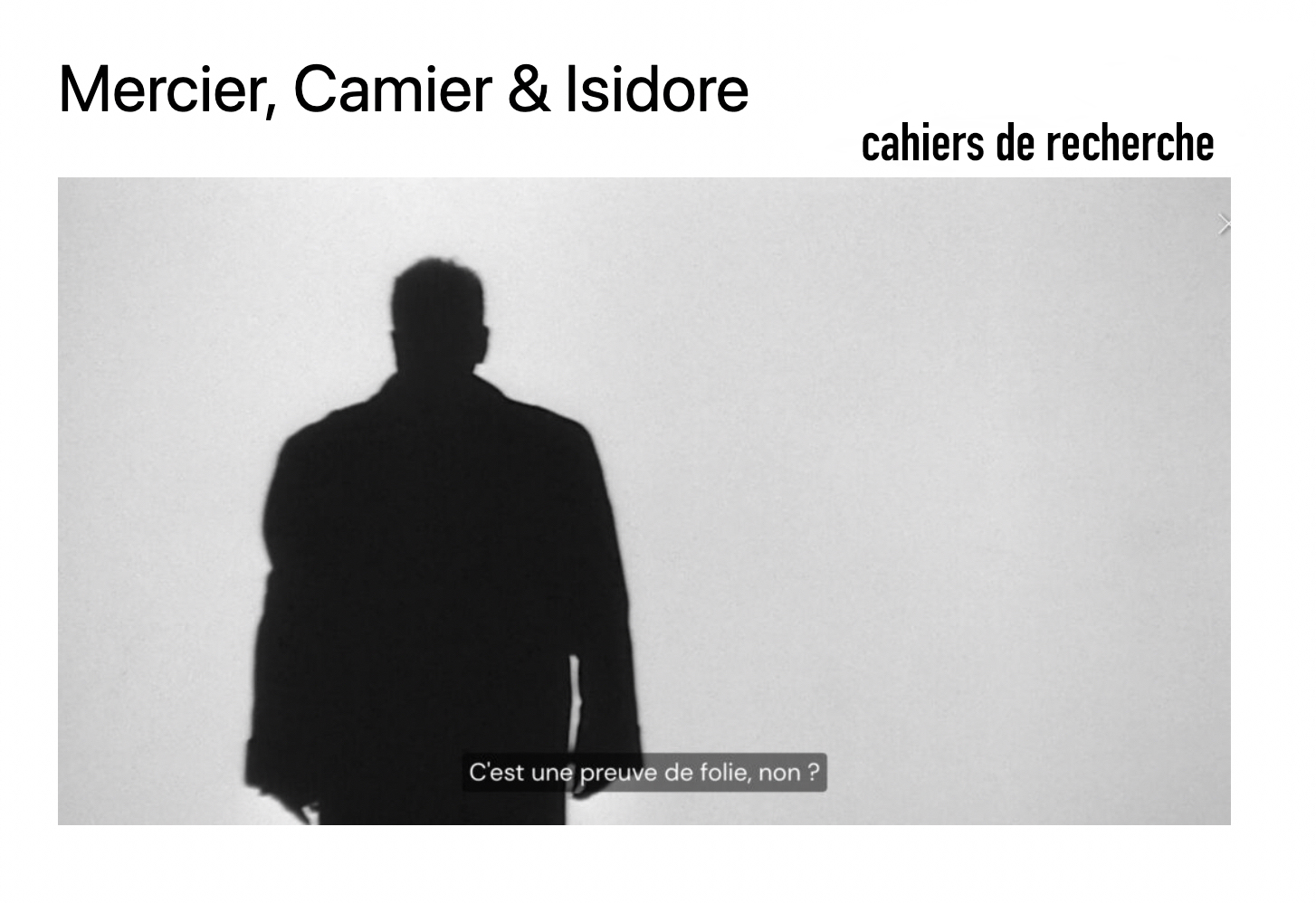




( )TOO
Madison, mars 2018
Lettre adressée à Amandine André
au sujet d’une performance
de Yoko Ono
Chère Amandine,
Tu m’as demandé si j’accepterais d’écrire quelque chose au sujet d’une performance de Yoko Ono, Cut Piece, qui a eu lieu pour la première fois en 1964. Tu m’as envoyé un lien permettant d’assister à plus de neuf minutes de cette performance, telle que Yoko Ono l’a reprise en 19651 : on peut voir l’artiste presqu’immobile, impassible, tandis que les membres du public, un par un, sont autorisés à couper et emporter une partie de ses vêtements. Pour le coup, j’accepte volontiers d’essayer d’écrire quelque chose à propos de cette performance, car je me demande bien ce qu’il s’agit de couper et d’emporter, de prendre – ou de donner.
Prendre, donner, je crois qu’il s’agit de cela dans cette performance, et je voudrais rendre visible cette matrice symbolique, et j’emploie le terme de matrice à dessein puisque ce qui s’impose, d’abord, au vu de l’enregistrement que tu m’as envoyé, relève – à première vue – d’une violence faite à une femme. Violence de l’objet à partir duquel la transaction s’effectue entre Yoko Ono et les spectateurs, ou disons les actants (ce n’est pas que j’aime ce terme, mais en l’occurrence il convient plutôt bien) : une paire de ciseaux. Car l’action, ici, c’est prendre. Et c’est prendre sur, prendre à, par violence faite sur le vêtement, qui est mis en pièces. Des pièces sont donc coupées, et elles sont coupées non pas sur une étoffe quelconque, matériaux bruts d’un vêtement en préparation, elles sont prises sur une totalité déjà constituée, un être vivant, même s’il est passif. Voilà que des trous apparaissent, et comme tu vas pouvoir le voir, le lire, c’est quelque chose sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises.
Donc, une violence est faite et elle est faite, dans les archives qu’il m’a été donné de consulter, quant au corps féminin, et l’on trouvera aisément sur internet des analyses qui vont insister sur ce que cette performance nous montre de l’agression sexuelle permanente faite aux femmes2. Cette interprétation n’est pas nouvelle, on en trouve trace dans des catalogues ou des émissions télévisées des années 1990 mais, point sur lequel je voudrais aussi revenir, elle n’était pas obvie dans les années 1960 et 1970 ! Toujours est-il que le contexte dans lequel je t’écris cette lettre, celui de « #MeToo » et « balance ton porc », n’est pas sans influencer la manière que j’ai de regarder cette performance – mais justement, quelle est cette influence ?
Je dois te dire que mon but n’est certainement pas d’analyser la performance de Yoko Ono avec « #MeToo » ; c’est plutôt le contraire qui m’intéresse, qui devrait, je crois, nous intéresser : analyser « #MeToo » à partir de la performance. Pourquoi ? Et en quel sens le passé nous importe ? Je ne suis pas un juge, je ne suis pas là pour condamner à perpétuité ce qui a lieu, je suis là pour aller susciter dans le passé la justice qui n’a pas eu lieu, c’est-à-dire chercher à ressusciter les puissances de justice endormies, ou non-reconnues, ou empêchées d’être. Mieux vaut à ce titre révéler, inventer un Freud féministe que passer son temps à dénoncer les rapports de Freud avec sa fille. Mieux vaut ce Freud contre lui-même que pas de Freud du tout. Mais il vrai qu’aujourd’hui l’idée même d’inconscient est un délit : dans un monde unidimensionnel, hyper-connecté, phobique de la séparation, l’idée même qu’il puisse exister une forme artistique non réductible à l’agent de chair et de sang qui l’a produite est potentiellement criminelle. C’est en effet que quand tout est dit relié, rien ne peut se réserver du monde, personne ne peut prétendre à quelque zone de non-su, sauf à être considéré comme méditant quelque malversation. Je crois que la pulsion de condamnation rétroactive tient à cette vision unilatérale du monde et de l’histoire, celle-ci devenant l’illustration ratée de ce que nous saurons refaire, en mieux, en plus sain, en plus moral, aujourd’hui.
C’est aussi ce type de problèmes, de questions, que me pose l’idée d’un racisme ou d’un sexisme structurel. Ce qui est utile, et nécessaire dans cette idée, est d’éviter de parler en termes d’individus, qui seraient des cas uniques, qui devraient être traités psychologiquement et dont on pourrait expliquer les actions – sexistes, racistes – à partir de circonstances spécifiques. Contre l’idée de monstres isolés, ou de troubles psychiques invoqués pour expliquer quelque crime raciste ou sexiste, c’est bien un système sexiste, un sexisme d’État institué par voie administrative, qu’il faut désigner en tant qu’il est aussi à l’œuvre dans l’esprit des administrés que nous sommes. Le phallocentrisme est véhiculé par tout porteur de phallus, supposé mâle ou lesbienne (je me réfère ici à un texte crucial de Judith Butler sur le « phallus lesbien ») – de cela, je ne doute pas. Le problème, c’est quand le sexisme structurel nous fait passer de l’individu d’exception à la norme muette que chacun serait censé exprimer : en passant de l’individu psychologiquement déterminé à la structure de déterminations sociale, on est passé d’une erreur à une autre, et on a maintenu la même pensée carcérale. Comment en effet répondre de la structure, avant même de pouvoir s’opposer à ce qu’elle provoque, si ce n’est précisément en s’exposant comme non totalement structuré par elle, ou comme capable de montrer notre capacité à ne pas répondre de cette structure ? N’est-ce pas, d’une certaine manière, ce que Yoko Ono performe dans Cut Piece ? La liberté consiste dans notre capacité à montrer que la norme ne marche pas, jamais, sauf à en répondre, et cette réponse est déjà la contre-prise. Être libre c’est dévier de façon créatrice, en laissant la structure s’effondrer au milieu du malstrom que notre subjectivation vive, sauvage, aura créé. Avec « #MeToo » et « balance ton porc », c’est la monstruosité qui devient la structure elle-même.
Mon but n’est pas de dire que ce mouvement est sans raison sociale, c’est le contraire : il est complètement fondé socialement ! Il est sans écart, sans trou. Je pense qu’il correspond à une abréaction sociale et je trouve cette abréaction légitime, il s’agit au sens propre d’une vengeance, c’est-à-dire d’un acte de justice quand la justice est impossible, qu’elle n’a pas été – précisément – rendue, et Lauren Berlant a écrit des choses intéressantes sur ce point, en regard de certaines critiques queer3. Tu sais, j’ai eu la chance d’écouter Silvia Federici à Madison le mois dernier, elle disait qu’elle trouvait ça très bien que des hommes soient jugés pour des délits envers des femmes, mais qu’elle trouvait ça intenable qu’on puisse croire que l’appareil juridique soit en mesure de résoudre le problème de la violence faite aux femmes, alors qu’il y a largement contribué ! Pendant la conférence qu’elle a donnée, et ensuite en réponse à des questions, elle a clairement expliqué que pour elle les réponses ne peuvent pas venir d’abord de l’État, ou d’une institution, mais des formes de vie commune et de solidarité qui rendent impossibles l’horreur des violences faites aux femmes.
Donc, oui, l’appel à la vengeance me semble parfaitement justifié dans certaines circonstance, je pense par exemple aux appels à la vengeance de Louise Michel, attend laisse-moi trouver des citations, voilà : « la fortune est capricieuse », rappelle-t-elle aux vainqueurs qui la jugent, « je confie à l’avenir le soin de ma mémoire et de ma vengeance » et aussi, pour ceux qui indexeraient seulement la Commune au futur : « La Commune, ne l’oublions pas non plus, nous qui avons reçu charge de la mémoire et de la vengeance des assassinés, c’est aussi la revanche »4. Louise Michel parlait de la manière dont le futur devait prendre en charge collectivement l’iniquité du passé, là où « me too » ne pose le problème qu’individu par individu, et au présent. On dira alors que chaque déclaration d’une nouvelle victime augmente le nombre et montre que le problème est massivement systémique ! C’est vrai, mais le système ne peut être combattu que par un passage à l’infini où la somme des cas décrits devient celle de sujets qui ne parlent pas seulement au nom d’elles-mêmes et d’eux-mêmes. Il n’y a pas de politique quand il n’y a que du moi, il y a politique quand on accueille la cause de l’autre, dit Jacques Rancière, quand on se dés-identifie à cause de l’autre, de ce qu’il ou elle m’oblige à prendre en considération et qui n’est pas identique à la situation que je vis. Là encore, on dira – au mieux – que c’est dans le défaut de cet accueil que « #MeToo » apparaît, ça je peux complètement l’admettre. Mais cela ne change pas l’extrême pauvreté politique d’une revendication n’ayant que le moi pour centre.
Alors, quand j’ai vu cette performance de Yoko Ono, quand j’ai vu ces trous, cette prise en corps par pièces, ces prises qui lacèrent non pas en objets mais en déchets ou en déjets, j’ai soudain pensé à ce que trouer, faire trou, peut signifier, et j’ai vu s’écrire « ( )Too », c’est-à-dire une absence à la place de « moi », pour que l’autre, tous, puisse y apparaître. Seulement, en quoi la violence faite au corps de Yoko Ono peut-elle être convertie en quelque chose qui serait de l’ordre d’une positive absence ? Tout d’abord, il faut savoir que Yoko Ono a pu présenter sa performance comme « une manière de donner, de donner et de prendre. C’était une sorte de critique contre les artistes, qui donnent toujours ce qu’ils veulent donner. Je voulais que les gens prennent ce qu’ils voulaient, alors il était très important de leur dire qu’ils pouvaient couper où ils voulaient. C’est une forme de don qui a beaucoup à voir avec le bouddhisme… Une forme de don total par opposition au don raisonnable ».5 Yoko Ono parlera même de « sacrifice » … On est loin semble-t-il de tout féminisme, et il arrivera même à Yoko Ono de répondre, en 1994, à une question relative à ce qu’aurait été son éventuel « proto-féminisme » des années 1960 : « je n’avais aucune notion de féminisme »6…
On dira que cela ne change rien au problème, que ce n’est pas parce que Yoko Ono n’était pas capable de voir en quoi sa performance était relative à la violence faire aux femmes (j’ai entendu dire que John Lennon était peut-être pour la paix mondiale, mais pas forcément envers sa femme) que ce n’était pas le cas. Après tout, elle aussi, dira-t-on, reproduisait le sexisme structurel, la culture du viol. Je ne pense pas du tout que cela soit faux, je me demande seulement si on rend justice à la performance en disant cela. D’une part, on trouve au moins dès 1971 une déclaration de Yoko Ono à propos de Cut Piece disant que « le performeur, cependant, ne doit pas forcément être une femme » et en effet, dès 1966, on a des traces de performeurs masculins, à Central Park, pour Cut Piece7. D’autre part, c’était l’artiste et non même la femme ou l’homme qui était l’objet de la performance de Yoko Ono, l’artiste et son ego, l’artiste qui généralement décide de ce qu’il donne à voir, de ce qu’il présente sans se risquer dans ce qu’il présente. Ce que la performance de Yoko Ono renverse, c’est la structure de la prise, la prise est mise, littéralement, entre les mains des spectateurs devenus sécateurs ! L’artiste perd au change, apparemment.
Apparemment, car il nous faut aller plus loin. Je crois qu’il faut prendre Yoko Ono aux mots quand elle dit, à propos de sa performance : « j’ai toujours voulu produire une œuvre dépourvue d’ego. Je pensais à ce motif de plus en plus, et le résultat de cela fût Cut Piece »8. Et puis maintenant que je cherche à prouver ce que j’avance, je vois des trous partout, forcément… Je vois ainsi le nom de l’artiste plein de trous : yOkO OnO ! Tu vois, il y a bien plus de zéros, d’ensembles vides, dans Yoko Ono que dans le Too de MeToo… Or ces trous, on ne peut pas les mesurer exactement : ce qui est pris met à nu bien plus que ce qui est pris. Ce qui est révélé dépasse toute prise. En donnant, la prise de celui qui coupe est déprise de sa puissance. Bien entendu, il y a cet homme dans la vidéo qui tente de prendre beaucoup, beaucoup trop, il tente de prendre ce qui couvre la poitrine de Yoko Ono, il croit que sa force est une puissance, il n’est pas à même de comprendre que sa force lui vient du dispositif scénique inventé par Yoko Ono ! Il est pourtant vrai qu’hors de la scène de la performance, il y a des coups de force et des prises violentes, réelles, et sans protection scénique. Comment pourtant parvenir à dire que ces coups de force sont misérables au sens où ils révèlent que la force est une impuissance, que la culture du viol n’identifie pas des porcs, animaux élevés pour être mangés, animaux que je comprends toujours à partir d’une chanson de Robert Wyatt (« Pigs… (In There) »), pas même des prédateurs dont ils n’ont pas la carrure, mais des égos qui bouchent le trou percé qui leur sert d’esprit.
Ceci étant, tout ce que je tente de dire ainsi peut être facilement réfuté : faire l’apologie de l’ensemble vide, c’est peut-être seulement renchérir sur le déni du féminin, et conforter le déni de cet Autre de l’Autre, « ce sexe qui n’en est pas un », pour reprendre les termes de Luce Irigaray. Et je ne vais certainement pas moi-même réfuter cet argument, et c’est précisément pour cela que j’écris ces quelques remarques sous la forme d’une lettre qui t’est adressée. Contre la machine unidirectionnelle, contre la phobie de la séparation et le monde plat qu’elle produit, il faut rouvrir des écarts, de la dialectique, mais une dialectique à l’autre, là où ça ne sait pas, là où c’est troué précisément. Adressée à toi, femme en l’occurrence supposée, c’est dire qu’il est hors de question qu’une position théorique vis-à-vis du féminisme, ou des femmes, puisse être posée d’un point assuré du masculin, qui serait dès lors, et nécessairement, un point plein de bêtise. Par toutes les formes d’adresses, l’espace évidé entre les parenthèses – ( ) – accueille ce qui est nombreux, le nombre débordant même les parenthèses du « tout ». Et c’est en définitive cela que je retiens de Cut Piece : ce qui est donné par Yoko Ono est bien plus qu’elle-même ; ce qui sera pris sera dès lors bien moins qu’elle-même. Nous devons apprendre à être inaccessibles.
Frédéric Neyrat
1. Ici : https://vimeo.com/106706806
2. Par exemple : http://womenartandculture.blogspot.com/2012/05/yoko-ono-cut-piece-analysis.html
3. Sur l’idée de vengeance, de « vengeance réflexive », cf. Lauren Berlant, « The Predator and the Jokester » in The New Inquiry, 13 Décembre 2027 (https://thenewinquiry.com/the-predator-and-the-jokester/)
4. Louise Michel, La Commune. Histoire et souvenirs, La Découverte/Poche, 275, 362.
5. Yoko Ono, quoted in Kevin Concannon, “Yoko Ono’s CUT PIECE: From Text to Performance and Back Again,” Imagine Peace (http://imaginepeace.com/archives/2680).
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris