par Vivian Petit
A propos de Mon corps, ce désir, cette loi. Réflexions sur la politique de
la sexualité, Geoffroy de Lagasnerie, éditions Fayard, 2021.
Nous avons souhaité proposer à Vivian Petit une lecture de l’ouvrage Mon corps, ce désir, cette loi. Réflexions sur la politique de la sexualité de Geoffroy de Lagasnerie, publié aux éditions Fayard en octobre 2021. Cette recension initialement prévue pour le projet éditorial Pneûma &ligature qui malheureusement n’a pu voir le jour, trouve naturellement sa place dans les pages de La vie manifeste. L’occasion pour nous de lui renouveler nos remerciements pour cette lecture qui vient enrichir le livre de Geoffroy de Lagasnerie et apporter quelques éléments critiques quant à la visée politique dans laquelle s’inscrit la contribution de Geoffroy de Lagasnerie aux débats sur la sexualité et les politiques d’émancipations.
Vivian Petit contribue à plusieurs revues, notamment Lundimatin et Harz-Labour. Parmi ses articles publiés dans Lundimatin on peut lire Hocquenghem, réflexions sur la défaite homosexuelle ; Le système de l’enfance, Lectures de Guy Hocquenghem et René Schérer ; Les messes noires de Michel Foucault, le bullshit de Guy Sorman (co-écrits avec Quentin Dubois), Lire Matzneff (co-écrit avec Antoine Mazot-Oudin). Il travaille actuellement à l’écriture d’un ouvrage autour de la figure de Rimbaud. Il a également effectué deux voyages en Palestine : le premier en Cisjordanie et à Jérusalem, en avril 2009, le second à Gaza, de février à avril 2013, période durant laquelle il a travaillé comme enseignant au Département de français de l’université Al-Aqsa. De ces deux séjours il a publié Retours sur une saison à Gaza (éditions scribest 2017).
Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Ses travaux portent sur l’art, la culture et les intellectuels, sur la philosophie sociale et politique ou encore sur la théorie critique. Il est notamment l’auteur de Juger. L’État pénal face à la sociologie, (Fayard, 2016) ; Penser dans un monde mauvais (PUF 2017) ; Le Combat Adama, avec Assa Traoré (Stock, 2019) ; La Conscience politique (Fayard, 2019). Il dirige la collection «à venir» aux éditions Fayard.Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Ses travaux portent sur l’art, la culture et les intellectuels, sur la philosophie sociale et politique ou encore sur la théorie critique. Il est notamment l’auteur de Juger. L’État pénal face à la sociologie, (Fayard, 2016) ; Penser dans un monde mauvais (PUF 2017) ; Le Combat Adama, avec Assa Traoré (Stock, 2019) ; La Conscience politique (Fayard, 2019). Il dirige la collection «à venir» aux éditions Fayard.
Mon corps, ce désir, cette loi est un livre qui s’inscrit dans la pensée critique de l’abolitionnisme pénal et dresse les apories discursives auxquelles ne cesse de se heurter la politique de la sexualité autour de la question du désir et de la conscience, de la liberté et de l’emprise. Si l’exploitation, la brutalisation du corps, la violence corporelle sont des réalités objectivables dans le cas du travail, l’auteur refuse cette objectivation aux relations sexuelles consenties. Celles-ci se développent à l’intérieur d’une «zone grise» qui résiste à l’objectivation. Et c’est le concept même de domination que l’auteur veut suspendre pour rendre compte des relations sexuelles consenties, car le désir ne se retrouve pas annulé dans la saisie d’un tel concept. Lorsque la sexualité se trouve mêlée à des rapports de hiérarchie, est-ce la sexualité ou la hiérarchie qui pose problème ? N’est-ce pas les rapports de hiérarchies qui posent problème à la possibilité de relations sexuelles et non l’inverse ? Pourtant, bien souvent, dans les discours qui font usage du concept de domination et d’emprise, c’est le désir qui se retrouve sacrifié sur l’autel de la hiérarchie.
politique(s) de la sexualité – Vivian Petit
À l’automne dernier, Geoffroy de Lagasnerie a fait paraître Mon corps, ce désir, cette loi, ouvrage dans lequel il propose de repenser la politique relative aux violences sexuelles afin d’analyser leurs causes structurelles plutôt que de focaliser sur les seules responsabilités individuelles. Ainsi, Lagasnerie, qui s’inspire des travaux visant à l’abolitionnisme pénal et à l’émergence d’une justice réparatrice et transformatrice, critique la focalisation d’une partie des discours féministes contemporains sur la dimension pénale et punitive de la lutte contre les violences sexuelles.
Si ce livre est courageux, c‘est notamment parce qu’il entend échapper aux fausses dichotomies établies dans le contexte post #Metoo. En effet, les histoires du féminisme, du mouvement gay, et celle des luttes contre les violences sexuelles sont traversées par des débats et des tendances diverses depuis des décennies. Aussi, comme l’écrit Lagasnerie, « le champ de la politique de la sexualité » est « un espace où s’opposent des épistémologies différentes du traumatisme et de la répression, des conceptions de l’agression sexuelle et de ce que veut dire être victime et être coupable, de la répression et de la vengeance, du bonheur et du malheur, de la norme et du désir »[1]. Par conséquent, précise Lagasnerie, il serait erroné de réduire les réflexions à propos des violences sexuelles (notamment sur les façons de les définir, de les reconnaître ou de les empêcher), à une opposition entre un mouvement féministe soutenant les victimes face à leurs agresseurs d’une part, et des personnes résistant à ce mouvement d’autre part.
Geoffroy de Lagasnerie entend prolonger l’histoire du mouvement gay, dont il espère que les luttes contre les violences sexuelles s’inspireront. Dans les premières pages de son livre, avant d’entrer dans la discussion et d’interroger des points précis de certains discours féministes contemporains, il précise d’emblée qu’il partage « les mêmes constats et les mêmes objectifs qui constituent ce que l’on pourrait appeler le socle politique du féminisme », à savoir « la nécessité de lutter contre la violence, les agression, les multiples formes de domination que subissent les femmes et les minorités sexuelles dans toutes les sphères de la vie sociale, professionnelle, domestique ». Et il précise : « l’espace des interrogations que je veux rouvrir suppose la reconnaissance de ce socle et son acceptation comme une évidence ».[2]
Tout en se situant à gauche et en partageant les objectifs affichés de lutte contre la domination masculine, le livre de Lagasnerie se distingue de la masse des écrits sur les violences sexuelles en plusieurs points. D’abord, Lagasnerie ne considère pas qu’il existerait une seule ‘‘parole des victimes’’ qui se ‘‘libérerait’’. Il pointe au contraire une opération politique dans la mise en avant de certaines paroles de victimes – souvent celles qui affirment le caractère irréparable du traumatisme et la nécessité de punir – aux dépens d’autres expressions. Ensuite, Lagasnerie refuse de célébrer le durcissement des lois sanctionnant les infractions sexuelles, notamment la répression grandissante des rapports entre majeurs et mineurs, comme un progrès ou un nouveau pas effectué dans la grande marche vers l’égalité. Il critique un « exceptionnalisme sexuel », et constate que des organisations et des militant(e)s « progressistes », d’ordinaire critiques du populisme pénal et généralement enclins à mettre en avant les causes des violences plutôt que les seules responsabilités individuelles, rompent subitement avec leurs principes dès lors qu’il s’agit de faire condamner des auteurs d’infractions sexuelles. Cette observation sur la singularisation des violences sexuelles vis-à-vis d’autres formes de violences pousse Lagasnerie à interroger la place de la sexualité dans les représentations et les discours contemporains. Sa réflexion sur la sexualité, le conduit à inviter à ne pas surestimer l’influence des actes sexuels dans le développement psychique, dès lors qu’ils ne sont pas imposés, et à considérer les violences sexuelles au même titre que d’autres violences physiques. En désacralisant la sexualité, en considérant que le consentement ou la violence doit être le critère principal pour juger une relation, Lagasnerie appelle aussi à se méfier de la notion d’« emprise », qui invaliderait le désir dès lors que celui-ci serait développé dans un contexte inégalitaire et, surtout, qui présuppose selon l’auteur une norme de ce que devrait être une relation ‘‘normale’’ ou un désir « non vicié ». Enfin, puisque tout désir est par définition socialement construit au sein d’un ordre social inégalitaire, mais que ce désir peut tout de même nous structurer et nous émanciper, l’auteur se demande s’il ne faudrait pas délaisser le concept de ‘‘domination’’ pour analyser des relations sexuelles consenties. Lagasnerie, nous y reviendrons, et nous discuterons ce point, appelle à une « dépolitisation du désir ».
Si les différents énoncés de Geoffroy de Lagasnerie doivent pouvoir être prolongés, discutés, interrogés, critiqués, nous devons reconnaître qu’il a le mérite d’assumer le débat, fût-il polémique, sur un sujet à propos duquel il est de bon ton de louer une supposée ‘‘libération de la parole’’, en prenant soin, le plus souvent, de ne pas analyser ni interroger le contenu de ladite parole. L’auteur semble situer son travail dans ce que Foucault nommait la «criticabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours »[3]. Lagasnerie étudie des régimes de discours et des normes régissant des pratiques, et il tient à rappeler que ce sont à chaque fois, autant d’autres pratiques et d’autres discours, réels ou potentiels, qui sont occultés.
Des paroles qui en censurent d’autres.
Si le régime d’énonciation en vigueur est aujourd’hui qualifié de ‘‘libération de la parole’’, Geoffroy de Lagasnerie le rappelle, tout discours répond à des normes, et toute mise en avant de certaines prises de parole en invisibilise d’autres. Ainsi, à la suite de Bourdieu et Eribon, Lagasnerie appelle à se demander, lors de chaque mobilisation collective « Qui n’est pas là ? Qui ne parle pas ? Qui sont les voix absentes ? »[4]
Dans le cas des victimes de violences sexuelles, la réponse apportée par Lagasnerie se trouve au début du livre. La parole invisibilisée est celle de victimes qui décryptent les logiques de l’agression sexuelle mais critiquent « la logique pénale » et « des formes publiques de la vengeance collective ».[5] Parmi ces discours « raréfiés et invisibilisés », Lagasnerie situe en bonne place celui de Samantha Geimer, citée par Edouard Louis comme l’une des femmes les plus inspirantes pour lui [6]. L’actrice, violée par Roman Polanski lorsqu’elle avait 13 ans et qui, après avoir échangé avec le réalisateur, déclarait lui avoir pardonné, était allée jusqu’à affirmer que les actions du procureur ou des militantes féministes instrumentalisant son cas avaient été plus traumatisantes que les actes de Polanski lui-même. S’il n’est pas question, ni dans le livre de Geoffroy de Lagasnerie, ni dans cet article, de dicter une attitude à adopter aux personnes qui ont été victimes de viol, il convient de noter, comme l’observe Lagasnerie, que le ‘‘soutien aux victimes’’ qui s’est exprimé dans le cadre de ce qu’on appelle désormais l’affaire Polanski, n’accordait plus aucune écoute à celle qui avait été victime dès lors qu’elle dérogeait à ce qui était attendu d’elle.
Ainsi, en 2019, peu avant les protestations organisées dans le cadre de la cérémonie des Césars, Samantha Geimer, opposée par principe aux sanctions à perpétuité et refusant d’être figée éternellement dans une identité de victime, demandait aux militantes de ne pas mentionner son nom ou son histoire pour défendre des positions qui n’étaient pas les siennes. Cela n’empêchait pas plusieurs d’entre elles d’afficher peu après « Samantha : 13 ans » sur les murs de Paris, alors que l’intéressée déclarait que « demander à toutes les femmes de supporter le poids de leur agression, mais aussi de l’indignation de tout le monde pour l’éternité » relevait d’un « besoin égoïste de haine et de punition ». Au même moment, Adèle Haenel, dont la voix fut bien plus écoutée et relayée que celle de Samantha Geimer, déclarait en porte-parole autoproclamée des victimes de Polanski que le « distinguer c’est cracher au visage de toutes les victimes : ça veut dire ‘ce n’est pas si grave de violer des femmes’. »[7] Ainsi, comme l’analyse Lagasnerie, des groupes militants reproduisent parfois une volonté de punition et une dépossession des victimes dans la prise en charge des violences subies, autant de caractéristiques d’ordinaire imputées à la justice pénale et invoquées pour expliquer le faible nombre de dénonciation de viols, en comparaison du caractère massif du phénomène.[8]
Cette ignorance des demandes de Samantha Geimer, au nom de l’affirmation du besoin de punir, semble pourtant tourner le dos à de nombreux principes ‘‘progressistes’’. Aussi, l’indépendance des lieux culturels vis-à-vis de l’État, et la critique des peines à perpétuité ont historiquement fait partie de l’ADN des mouvements de gauche. Pourtant, les semaines précédant la cérémonie des Césars, les appels à la déprogrammation du film de Polanski, via des demandes d’intervention des élus, comme l’opposition à la prescription ou la défense d’un bannissement à vie, étaient apparus médiatiquement comme la seule position féministe audible.
Les questionnements sur le financement et la production des œuvres sont évidemment légitimes, et il convient de noter que des choix sont faits, que des propositions sont préférées à d’autres, et que de nombreux projets ne voient jamais le jour. Réaliser un film et être financé pour cela n’est donc pas un « droit ». Pour autant, nous observons que les interventions visant à empêcher les projections du film de Roman Polanski une fois réalisé et diffusé ne ciblaient pas Gaumont, producteur et diffuseur du film, mais le plus souvent des cinémas publics ou associatifs. Pour un certain nombre d’entre eux, tout en diffusant le film, les animateurs de ces lieux interrogeaient le lien entre la réception d’une œuvre et les considérations sur la biographie de l’artiste. Plusieurs d’entre eux organisaient aussi, suite aux projections, des discussions sur les violences sexuelles et le sexisme dans le milieu du cinéma. Là aussi, une position féministe en recouvrait une autre, et le fait de préciser les enjeux pour ne pas céder trop rapidement à l’envie de censure ou au désir de punir était soit ignoré soit amalgamé injustement à un soutien aux actes imputés au réalisateur.
Si nombre de médias se sont interrogés sur le désir de censure visant le film de Roman Polanski, peu ont questionné leur propre ignorance des autres positions féministes qui existaient. Ils ne se sont pas non plus appesantis sur le refus de prendre en compte la parole de Samantha Geimer, qui relève elle-aussi de l’effet de censure, au sens de Jacques Derrida : le fait qu’une instance, étatique ou non, rende difficile voire impossible qu’un discours soit mentionné ou discuté dans l’espace public.
Quand le procès de Mai 68 gagne la gauche.
Parmi les nombreux signes de la diabolisation de positions émancipatrices qui semblent avoir gagné la gauche ces dernières années dans le cadre de sa surenchère punitive contre les violences sexuelles, Geoffroy de Lagasnerie cite notamment la lecture rétrospective des discussions qui ont eu cours dans les années 70, et des positions exprimées dans la signature en 1977, par de nombreux écrivains, penseurs, artistes, médecins, ou militantes féministes, d’une « Lettre ouverte à la Commission de révision du Code pénal pour la révision de certains textes régissant les rapports entre adultes et mineurs ». Ce texte, comme le résume Lagasnerie, « proposait d’interroger un ensemble de délits qui encadraient alors la sexualité des mineurs et affirmait que ‘‘l’entière liberté des partenaires d’une relation sexuelle’’ devrait apparaître comme ‘‘la condition nécessaire et suffisante de la licéité de cette relation’’ »[9]
Comme l’évoque Lagasnerie, et comme nous étions quelques-uns à le rappeler quelques mois plus tôt lorsque Guy Hocquenghem et les militants du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) étaient décrits de façon anachronique comme des « apologistes de la pédocriminalité »[10], ces prises de position s’inscrivaient à la fois dans le contexte des mobilisations lycéennes de l’époque, dans celui de la lutte contre la répression des homosexuels (dont tout rapport d’un majeur avec un mineur de moins de 18 ans était illégal, alors même que la majorité sexuelle était de 15 ans), dans la critique de la psychiatrisation du désir, mais aussi dans les réflexions féministes critiquant l’autorité familiale sur les enfants et les adolescents. La lettre ouverte en question était notamment signée par Simone de Beauvoir, Christine Rochefort, Françoise d’Eaubonne, Hélène Cixous, et soutenue par des médecins liés au Planning familial.
Aujourd’hui, dans le contexte du durcissement des lois régissant les rapports entre majeurs et mineurs, et d’une proximité grandissante entre certaines organisations féministes et des associations de protection de l’enfance, pour certaines situées très à droite [11], Lagasnerie explique que ces positions exprimées dans les années 70 sont interprétées selon « un schéma fascisant de l’élite culturelle comme groupe dégénéré, sans morale et aux mœurs dépravées » qui « a façonné nombre de discours ces dernières années, à droite comme à gauche – si tant est que ce soit alors encore la gauche ».[12]
Pourtant, poursuit Geoffroy de Lagasnerie, les expressions des années 70, qui visaient à libérer les mineurs des surveillances familiales et institutionnelles, ne sont probablement pas moins féministes que les positions de celles qui aujourd’hui appellerait à envoyer Brigitte Macron en prison pour sa relation avec l’un de ses lycéens qui deviendra président de la République. Les militantes des années 70, qui soutenaient Gabrielle Russier, jeune professeure libertaire incarcérée pour avoir entretenu en mai 68 une relation avec l’un de ses élèves âgé de 16 ans, n’étaient pas non plus moins féministes que celles des militantes d’aujourd’hui, qui qualifieraient la professeure de ‘‘pédocriminelle’’ et se situeraient du côté des magistrats et des psychiatres dont les décisions ont fini par la pousser au suicide.[13]
Les propos réactionnaires tenus sous couvert de protection de l’enfance et de lutte contre les violences sexuelles sont nombreux. Lagasnerie cite notamment la signature par une élue EELV d’une « pétition qui mettait en question l’issue judiciaire de l’affaire d’Outreau (où treize accusés à la suite de dénonciations fantaisistes ont été innocentés de viols sur enfants après des années de prison et dont le sort avait suscité à juste titre une énorme indignation publique) en affirmant qu’elle avait favorisé l’impunité des pédo-criminels, comme s’il était possible de regretter que des innocents soient acquittés parce qu’une telle décision enverrait un mauvais signal à de futures victimes potentielles », ou encore le slogan du groupe Paris Queer Antifa, qui lors de la dernière marche des fiertés appelait à « brûler violeurs et assassins », ce « qui ressemble tout de même plus à un slogan d’extrême-droite qu’à une démarche animée par les valeurs de l’antifascisme et l’éthique queer… » [14]
À ces exemples de rhétorique réactionnaire qui infuse à gauche sous couvert de lutte contre les violences sexuelles, nous pourrions ajouter les discours qui, plutôt que de chercher à penser structurellement la question des violences (notamment sexuelles) faites aux enfants (qui sont le plus souvent exercées par des membres de la famille ou des proches), propagent les fantasmes complotistes autour d’une élite pédocriminelle hors sol, dépravée et malfaisante. Ce discours est par exemple présent dans la tribune écrite par Virginie Despentes louant la réaction d’Adèle Haenel lors de la cérémonie des Césars, qui fustigeait « les plus riches » et « leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu’ils violent » [15].
Nous pouvons aussi mentionner la façon dont Rokhaya Diallo a récemment emboîté le pas à Karl Zéro, pourtant connu pour ses documentaires et ses revues complotistes à propos des attentats du 11 septembre 2001 selon lui organisés par la CIA, ou sur les tueurs et violeurs en série qui ne seraient que des exécutants chargés d’enlever des enfants pour le bénéfice des différentes familles royales et autres puissants de ce monde [16]. Sur le plateau de Balance Ton Post, la militante féministe et antiraciste affirmait notamment face au réalisateur venu présenter son film sur les « réseaux pédocriminels » (notamment francs-maçons) que la pédophilie était dans notre société « une norme sociale très très importante » avant de remercier Karl Zéro d’avoir « bien montré (…) la proximité de certaines personnes impliquées dans des viols d’enfants avec le Conseil constitutionnel » [17].
Alors qu’il serait souhaitable de prolonger les réflexions portant sur la domination des enfants par les adultes, d’analyser les représentations des enfants comme êtres faibles et obéissants qui favorisent leur fétichisation, mais aussi de réfléchir aux formes de reconnaissance des torts causés ou aux manières d’aider à la guérison des traumatismes, certaines figures médiatiques de la gauche préfèrent, quand elles ne se bornent pas à appeler à la vengeance, se vautrer dans le complotisme bas de gamme.
Et comme s’il fallait confirmer le regard porté par Lagasnerie dans Mon corps, ce désir, cette loi sur l’incapacité d’une partie de la gauche à remettre en cause le primat punitif et vengeur dès qu’il est question des violences sexuelles, notons la réaction de Judith Duportail, journaliste et animatrice d’un podcast intitulé On peut plus rien dire, se donnant pour but « de débattre autrement. Sans clashs, sans caricatures et sans pensées toutes faites ». Récemment, semblant oublier les principes fièrement affichés, la journaliste réagissait sur Instagram au livre de Lagasnerie en tentant, à partir de quelques citations tronquées et de commentaires les extrapolant, de faire croire que son auteur y tenait un discours masculiniste, qu’il légitimait le harcèlement sexuel ou minimisait le viol. En conclusion, dans une envolée plus proche du discours de campagne d’un(e) candidat(e) de droite que des principes portés par les mouvements d’émancipation dont elle se réclame, Judith Duportail assénait que le discours de Lagasnerie était l’incarnation « des discours post soixante-huitards qu’on s’échine à dénoncer » …
Quelques centaines de retweets plus tard, Daniel Schneidermann, journaliste d’habitude plus enclin à déceler les emballements et à pointer le manque de rigueur de ses confrères, bâclait pour Libération un article ne citant que les extraits de l’ouvrage diffusés les jours précédents sur les réseaux sociaux, avant de se demander si l’on ne pouvait pas déceler « dans [l]a prise de position [de Geoffroy de Lagasnerie] des relents de la permissivité soixante-huitarde en matière de pédocriminalité, aujourd’hui unanimement rejetée dans l’enfer de Mai 68. » [18]
En 1986, dans les dernières pages de leur ouvrage intitulé L’Âme atomique [19], René Schérer et Guy Hocquenghem notaient déjà que le faux souvenir d’une libération sexuelle supposément totale et sans limite, qui aurait eu lieu pendant et après mai 68, était l’un des éléments du discours réactionnaire. Ils considéraient que le développement de ce mythe était à la fois favorisé par le reflux des mouvements d’émancipation dans les années 80 et par la constitution de la sexualité comme danger. La gauche s’est historiquement distinguée par sa défense de l’héritage de mai 68, et notamment la façon dont il fut possible à la suite de ce mouvement, de mettre à jour les différents systèmes de domination. Elle s’est aussi souvent fait remarquer par sa critique des discours sécuritaires, par son rejet du populisme pénal et ses appels à la nuance. Cependant, plusieurs décennies de procès en laxisme, conjugués à diverses paniques morales et à une représentation tronquée des violences sexuelles faites aux enfants (la contrainte découlant, rappelons-le, bien plus de l’autorité excessive exercée dans les familles, dans les églises ou dans les écoles que d’une trop grande liberté accordée aux enfants ou aux adolescents), semblent avoir, au moins pour une partie d’entre elles, aujourd’hui eu raison de ses principes.
Le désir de punir.
Alors que l’analyse des inégalités et des causes des violences sexistes et sexuelles nous aide à comprendre les structures sociales et les responsabilités collectives, le corollaire du désir de punir qui s’exprime face aux actes répréhensibles est la focalisation sur les seuls individus coupables, ce qui, comme le note Geoffroy de Lagasnerie, nous place face à un paradoxe. D’une part, « le discours sur les violences sexuelles s’articule de plus en plus à une sociologie des structures qui favorisent ou organisent le viol ou l’agression sexuelle, ce qui conduit au développement de notions comme celles de ‘‘culture du viol’’ ou de ‘‘féminicide’’ qui permettent d’objectiver à la fois les causes de la violence sexiste ou sexuelle et ses effets sur les femmes ou les minorités sexuelles en termes de subjectivation dans leur rapport à l’espace public domestique, professionnel … », d’autre part, « la réponse aux phénomènes ainsi objectivés et même en fait leur simple caractérisation s’opèrent à travers des catégories pénales, psychologiques ou individualisantes qui sont en inadéquation avec ce paradigme. La sociologie est utilisée pour penser les rapports de domination mais complètement oubliée lorsqu’il s’agit d’appréhender les actes et les subjectivités que produisent ces rapports de domination ». [20]
Dans ce cadre, si Lagasnerie considère comme tout à fait compréhensible qu’une partie des personnes victimes de violences sexuelles ressentent spontanément, à titre individuel, des envies de punition, il considère comme intellectuellement et politiquement inopérante (voire tout bonnement réactionnaire) la solution qui consiste à collectivement formuler des revendications qui induisent le renforcement de l’état pénal et la construction de nouvelles prisons. Il situe ainsi ses pas dans ceux des théoriciens de l’abolitionnisme pénal, qui, comme J.M Moore aux Etats-Unis, ou la sociologue et militante féministe anticarcérale Gwenola Ricordeau en France [21], critiquent le fait que la majorité des ressources aujourd’hui dépensées dans la lutte contre les violences sexuelles visent à infliger des souffrances aux coupables plutôt qu’à soulager celles des victimes ou à mettre en place des politiques sociales et d’éducation visant l’égalité et la fin des violences de genre [22].
Aussi, Lagasnerie fait référence à la Ligue du droit des femmes, de Simone de Beauvoir, qui écrivait dans son manifeste que « l’emprisonnement de l’agresseur (…) permet sans doute à notre société de se débarrasser d’un problème qu’elle a créé elle-même en fabriquant des violeurs mais il ne s’agit que d’un leurre. Si les femmes exigent que le viol soit dénoncé publiquement en tant que crime, c’est parce qu’elles souhaitent que tous, hommes et femmes, prennent conscience de la violence sexiste dans notre société. Elles ne veulent plus apparaître comme des victimes, c’est-à-dire comme des sujets passifs, mais comme des êtres ayant une dignité sexuelle et qu’elles entendent faire respecter et exprimer clairement en renonçant à toute vengeance inutile et notamment à l’emprisonnement ». Pour faire valoir ce principe, les militantes étaient allées jusqu’à manifester dans les tribunaux lors de procès pour viol en criant « La prison n’est pas la solution ! » ou encore « Libérez l’accusé ! » [23]
En outre, Lagasnerie se demande si l’articulation d’« une politique de la sexualité à une dénonciation des structures sociales qui façonnent les subjectivés violentes » est compatible avec « l’appareil moral que tend à former le journalisme contemporain à travers la publication d’enquêtes ciblées sur des noms propres ».[24] En complément de son propos, nous pouvons ajouter que la focalisation sur les noms propres dans les discours médiatiques, en plus de détourner de l’analyse des causes en créant des monstres qu’il est possible de mettre à distance, va parfois même jusqu’à produire, dans l’esprit du public, un oubli ou une méconnaissance des faits dont les personnes sont accusées. Ces faits, qui vont du viol à la blague déplacée, peuvent avoir le même effet sur une réputation dès lors qu’un nom est mentionné dans un certain contexte.
Récemment, un collectif de femmes liées au milieu musical punk-métal a analysé d’un point de vue féministe la façon dont des accusations de sexisme furent alignées, sans nuance ni graduation, dans un article publié par Médiapart [25], ainsi que les effets délétères d’une telle publication. Dans une longue tribune écrite collectivement [26], elles y dénoncent notamment « la mort sociale des individus visés (perte d’emploi, exclusion de la communauté, du cercle social et familial, dépression) » et constatent que « cette exclusion opère bien souvent sans distinction de degrés quant à la gravité des accusations. »
Aussi, écrivent-elles à propos de la publication de Mediapart, « cet article tend plutôt à confondre différents niveaux de gravité, mettant sur le même plan viol, agressions sexuelles, relations affectives et/ou sexuelles complexes, paroles sexistes, entre-soi masculin. (…) On n’est pas là ou le même à 15 ans, à 25 ans ou à 40 ans. Et on n’a pas la même sexualité non plus. Tous les enjeux précédemment évoqués peuvent nous amener à revisiter, parfois a posteriori, une expérience affective ou sexuelle, et à y repérer des relations complexes, des vécus douloureux, des pratiques non désirées, des contraintes, des déceptions. Pour autant cela ne veut pas dire que là ou le partenaire était intentionnellement malveillant·e, ou qu’iel cherchait à heurter. En dehors du cadre des violences définies par la loi, la sexualité peut impliquer des mauvaises expériences, des ratés, des regrets, des conflits, des blessures ».
Il y a peu de doute sur l’injustice vécue par certains des accusés comme sur le caractère éthiquement discutable d’un processus qui consiste à aligner les noms de personnes qu’il s’agit de diaboliser, sans établir des niveaux de gravités dans les actes reprochés. Aussi, la tribune mentionne la perte de confiance de plusieurs des personnes qui ont témoigné et n’ont pas reconnu leurs propos dans l’article.
Enfin, les rédactrices de la tribune font remarquer que la création de boucs-émissaires et l’injonction à prendre position pour sauver sa réputation sont absolument contre-productives si l’on considère qu’il est nécessaire d’entamer une réflexion collective sur les rapports de pouvoir : « le positionnement des groupes ou des individu·e·s nous a questionnées sur les intentions de fond de chacun·e. Des dizaines voire des centaines de personnes, plus ou moins proches de notre courant musical et/ou d’individu·e·s en faisant partie, ont relayé l’article de Mediapart sur les réseaux, avouant parfois ne pas l’avoir lu. Quand on interroge certain·e·s à ce sujet, iels expliquent qu’iels s’y sont senti·e·s obligé·e·s, afin de ne pas être assimilé·e·s aux faits évoqués dans l’article. René Girard évoque ce phénomène collectif récurrent dans sa théorie du bouc émissaire : on en jette un en pâture, afin qu’il paye pour tout le monde, que les projecteurs soient fixés sur lui et que son sacrifice lave les péchés de tous, la question de la véracité de sa culpabilité semblant presque secondaire. Par là même, on cultive une atmosphère lourde et délétère avec la menace : « attention, préparez-vous, il y aura d’autres accusés ! ». Cela a également permis à certains groupes ou individu·e·s de se positionner et de se rendre visibles dans un mécanisme d’autopromotion ou de dédouanement, sans remise en question de leur propre comportement. »
Par ailleurs, des enquêtes médiatiques portant sur des personnes accusées dans des affaires de viol ou d’agression sexuelle peuvent compiler et amalgamer des faits disparates, allant de graves accusations à des faits qui seraient vus comme anecdotiques s’ils concernaient une autre personne. Marine Turchi, journaliste au pôle enquêtes de Mediapart, et autrice de nombreux papiers mettant en cause des personnalités publiques pour leur comportement vis-à-vis des femmes, expliquait récemment dans une émission d’Arrêts sur images qu’il s’agit souvent, en compilant des faits disparates, de citer « plein de témoignages » « qui se recoupent » et permettraient de faire apparaître « un mode opératoire ». [27]
Pourtant, comme le rappelle Geoffroy de Lagasnerie, l’essentialisme est critiqué de longue date par nombre d’avocats pénalistes, qui mettent en cause, y compris dans le cas des tueurs en série, des « constructions symboliques des relations ontologiques entre une personne et son comportement » [28]. En plus de noter dans les propos de Marine Turchi la réalisation d’enquêtes à charge, on peut se demander si cette façon de relier entre eux des faits qui ont lieu à des années voire des décennies d’écart, et qui sont recomposés et réinterprétés à la lumière d’une accusation récente, permet réellement de dresser le portrait psychologique d’une personne.
Le risque de ces interprétations est de se situer à la frontière de l’anthropologie négative du libéralisme, décrivant l’être humain comme cohérent, calculateur, poursuivant son intérêt et toujours conscient de ses actes, et de la psychiatrie qui s’exprime dans les tribunaux et essentialise des individus pour mieux les mettre à distance. Cela conduit le plus souvent à finalement ne rien comprendre des psychologies des personnes, et surtout de ce qui les produit.
De plus, amalgamer les différents actes des personnes mises en cause, dont certains n’ont que peu de rapports avec des fait répréhensibles, fait courir le risque de passer de la dénonciation de rapports contraints, établis ou à prouver, à la constitution, par l’insinuation et la description d’une ambiance, d’un nouvel ordre moral. Parfois, dans ces articles, la frontière entre la lutte contre les violences sexuelles et la police des mœurs peut devenir poreuse. Mediapart a par exemple publié un article intitulé Violences sexuelles : révélations sur le comportement de Juan Branco [29] après l’ouverture d’une enquête pour viol le visant [30]. Dans cet article, censé ajouter d’autres accusations contre Juan Branco, était décrit un geste déplacé qui pourrait recevoir la qualification d’agression sexuelle, geste que l’intéressé nie avoir commis, mais aussi des fantasmes exprimés dans une correspondance privée dans le cadre d’une relation consentie, ou le fait d’avoir reçu des messages d’étudiantes encore admiratives de celui qui avait été leur professeur de Terminale. En outre, la journaliste citait les propos d’une femme de la haute bourgeoisie qui désapprouvait la relation entretenue par sa fille avec celui qui est connu comme l’ancien avocat de Jean-Luc Mélenchon et un militant proche des Gilets jaunes …
Quelques mois plus tôt, Mediapart titrait Affaire Duhamel : d’autres éléments pourraient intéresser la justice. [31] Aux faits d’inceste dénoncés par Camille Kouchner et qui seront plus tard reconnus par Olivier Duhamel, étaient amalgamés, sans qu’on perçoive très bien en quoi de tels actes seraient répréhensibles, l’invitation faite aux enfants à discuter politique avec les adultes de la famille, ou encore le fait que les enfants pouvaient avoir connaissance de la multiplicité des amours de leurs parents…
Plutôt que de focaliser sur le viol, ou de chercher à analyser les structures sociales qui le rendent possible, Médiapart et une partie de la gauche préfèrent souvent décrire des ambiances ou insister sur le danger inhérent à tel ou tel individu. L’émergence de la figure de l’individu dangereux, et par ricochet le risque que les violences sexuelles ne soient plus abordées comme des faits précis mais que leur évocation pousse à considérer le sexe comme un danger qui rôde, était déjà notée en 1978 par Michel Foucault. Dans le cadre d’un entretien donné à France Culture [32], il expliquait que cette représentation du danger véhiculée par les médias avait notamment été développée dans les tribunaux par les discours des experts psychiatres : « Autrefois, les lois interdisaient un certain nombre d’actes, actes d’ailleurs d’autant plus nombreux qu’on n’arrivait pas très bien à savoir ce qu’ils étaient, mais enfin c’était bien à des actes que la loi s’en prenait. On condamnait des formes de conduite. Maintenant, ce qu’on est en train de définir, et ce qui, par conséquent, va se trouver fondé par l’intervention et de la loi, et du juge, et du médecin, ce sont des individus dangereux. On va avoir une société de dangers, avec, d’un côté, ceux qui sont mis en danger et, d’un autre côté, ceux qui sont porteurs de danger. Et la sexualité ne sera plus une conduite avec certaines interdictions précises ; mais la sexualité, ça va devenir une espèce de danger qui rôde, une sorte de fantôme omniprésent, fantôme qui va se jouer entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, et éventuellement entre adultes entre eux, etc. »
Du lynchage en milieu militant.
De cette représentation du danger, et du caractère toujours plus vague des accusations, découlent évidemment de nombreuses rumeurs, lesquelles ne visent pas seulement des personnalités publiques. Nous avons mentionné plus haut les logiques de boucs-émissaires qui ont fait suite à la publication de l’article de Mediapart à propos des violences sexistes et sexuelles dans le milieu punk-métal. Cette sphère n’est évidemment pas la seule à être concernée par de telles logiques. Comme de nombreuses personnes, j’ai par exemple pu assister ou me faire raconter divers moments de justice populaire organisés dans des milieux militants dits « anticapitalistes », « libertaires » ou « autonomes », qui servaient souvent de prétexte à des règlements de compte entre groupuscules.
Là non plus, la gradation dans les actes reprochés n’était pas toujours présente (des listes d’« agresseurs » pouvaient circuler, alignant parfois sans plus de précision, les noms d’un militant accusé de viol et d’un autre à qui il était reproché, sur un mode vague, d’avoir manqué d’empathie lors d’un rapport consenti). Souvent, au nom de la protection des victimes, la personne mise en cause n’était pas informée de ce dont elle était accusée, et il arrivait même que ceux qui œuvraient au bannissement ne le sachent pas eux-mêmes, et qu’ils se basent sur la seule rumeur publique. Plusieurs d’entre nous ont aussi eu l’occasion d’entendre le même récit, agrémenté des mêmes détails à propos de deux personnes différentes, ou d’entendre des « victimes » désignées témoigner en faveur de leur « agresseur » supposé pour démentir les rumeurs. À chaque fois que j’ai évoqué ces faits auprès d’amis vivant dans d’autres villes ou fréquentant d’autres milieux, ils m’ont fait part de cas similaires. Enfin, plusieurs de mes amies me parlant d’un viol ou d’une agression subie m’ont dit être inquiètes à l’idée que leur histoire puisse être connue et instrumentalisée. Afin de ne pas se retrouver figées dans le statut de victime passive par des groupes militants instrumentalisant cette figure, j’ai fréquemment entendu des femmes dire qu’elles se refusaient à parler publiquement de leur vécu.
Il y a un an et demi, à Lyon, face à l’inflation de ces pratiques, un rassemblement de collectifs divers, regroupant les animateurs d’une caisse de solidarité permettant de payer des frais de justices, des responsables d’une permanence d’accueil des personnes sans papiers, des militantes féministes ou anti-autoritaires ou encore les gérants de bars associatifs, LGBT friendly et féministes, s’est constitué pour critiquer ces comportements. Ils y écrivent notamment : « Nous voyons aujourd’hui des personnes pratiquer au sein de nos luttes diverses formes de harcèlement (téléphonique, tags nominatifs, agressions physiques et verbales, menaces de mort, attaques de lieux…), fichage de personnes (photos, films, « blacklists »…) se fondant sur des histoires déformées, manipulées, ou complètement inventées ; cet acharnement cinglant pousse à l’isolement et à l’ostracisation. » [33]
Et puisqu’il ne s’agit pas seulement de dénoncer ces pratiques, mais, lorsque les faits sont avérés, de penser les formes de la reconnaissance des actes, de leur réparation et du changement de leurs auteurs, les signataires précisent qu’ils dénoncent aussi ces pratiques parce qu’elles empêchent toute forme de réparation : « Si les personnes tentent des excuses c’est de la mauvaise foi, si elles ne disent rien c’est reconnaître leurs actes et si elles se font aider, leurs soutiens deviennent complices ou coupables. (…) Pour nous, la dénonciation publique peut permettre de libérer la parole de victimes dont les voix portent moins que celle de leurs agresseur.euse.s. En revanche, nous ne pouvons la voir que comme une étape et nous refusons catégoriquement que ces dénonciations deviennent le point de départ d’une justice punitive d’abattage, dont l’efficacité dépend forcément d’un rapport de pouvoir favorable, ou encore un moyen de discréditer des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. »
« On te croit ».
Parmi les dogmes militants, l’interdiction de remettre en cause ce qui est désigné comme la « parole des victimes », c’est-à-dire en pratique l’obligation de croire absolument toute accusation, figure en bonne place. Nous avons pourtant vu, par exemple dans le cas de Samantha Geimer, que la parole d’une femme qui a été victime peut être rapidement ignorée dès lors qu’elle ne correspond plus aux attendus. Mais c’est aussi ce dogme en tant que tel qui devrait être interrogé.
Les militant(e)s défendant le fait de considérer chaque accusation comme absolument vraie, et se targuant d’accéder aux demandes de la personne qui la formule (par exemple de relais public et nominatif d’une accusation, ou d’exclusion de l’accusé de tous les espaces publics où ils pourront le croiser), le font au nom du fait qu’une personne se déclarant victime n’aurait « aucun intérêt à mentir ». C’est par exemple ce qui est exprimé par Adèle Haenel dans le New York Times : « On doit croire toutes les femmes qui parlent. (…) On n’a rien à gagner à se dire victime et les conséquences sur la vie privée sont très négatives ». [34]
La parole doit évidemment être écoutée avec sérieux et bienveillance, et les mis en cause doivent être confrontés aux accusations qui les visent. Il m’est arrivé de participer à de tels processus. Aussi, lorsque les personnes sont amenées à fréquenter les mêmes espaces, des solutions doivent être trouvées pour éviter que, comme cela est trop souvent le cas, ce soient les plaignantes qui quittent les lieux ou les structures qu’elles fréquentent.
Cependant, le principe de « croire toutes les femmes qui parlent », au nom du fait qu’elles n’auraient pas d’intérêt à mentir, est évidemment paradoxal, dans la mesure où il crée, de fait, un intérêt à se dire victime pour être écoutée. Ce paradoxe est accentué lorsque certains collectifs militants défendent le principe d’accéder à toutes les demandes de qui se dit victime, indépendamment de la gravité des faits reprochés ou et sans tenter de vérifier les accusations.
Ces dernières années, nombre de publications ont par exemple évoqué les personnes qui se sont frauduleusement fait passer pour des victimes des attentats du Bataclan, soit par intérêt financier, soit simplement pour rejoindre une communauté ou bénéficier d’un espace d’écoute. Il semble difficile d’imaginer que la possibilité du mensonge s’arrête aux frontières des relations sentimentales et sexuelles. Aussi, nous prenons peu de risque à supposer que ces personnes se tourneront plus facilement vers des groupes précisant qu’ils « croient toujours » ceux qui se disent victimes ou, pour reprendre les mots d’Adèle Haenel, « toutes les femmes qui parlent ».
Les comportements minoritaires de dénonciation d’agressions imaginaires, parfois définis comme pathologiques et la plupart du temps signes d’une souffrance, peuvent d’ailleurs être vus comme des occasions de développer notre empathie et d’aménager des espaces de parole. Il s’agit cependant de ne pas amalgamer écoute et prise en compte de la souffrance d’une part, créance totale dans chaque énoncé et désignation d’un coupable d’autre part.
Récemment, une tribune liée au #Metoopolitique affirmait : « si les revendications et témoignages des différents mouvements #MeToo étaient entendus (…) On cesserait de remettre en doute notre parole alors que dans les faits les fausses accusations représentent 2 % à 10 % des cas». [35] Les signataires revendiquant la mise à l’écart de tous les mis en cause, on peut s’étonner d’un argument se basant sur le pourcentage d’injustice que l’on serait prêt à tolérer. Aussi, il convient de remarquer que tout en dénonçant une institution judiciaire à qui il est reproché de « remettre en doute la parole » des plaignantes, les signataires citent à l’appui de leur démonstration les chiffres fournis par cette même institution. La signification de ces chiffres est cependant extrapolée. Cette statistique ne signifie pas qu’entre 90 et 98 % des dénonciations seraient en tout point véridiques, mais que, dans les cas où des plaintes ont été déposées, il a été démontré dans 2 à 10 % des cas que l’accusation reposait sur un mensonge.Dans la majorité des situations, deux versions s’affrontent et il est impossible pour l’institution judiciaire de trancher avec certitude.
Dans la plupart des cas, les infractions sexuelles étant commises en l’absence de témoins et laissant peu de preuves matérielles, il est compréhensible que, dans le cadre de la justice pénale, le doute profite aux accusés. A l’inverse, dans un système qui ne serait pas centré sur la sanction du coupable mais qui reposerait sur la reconnaissance, la réparation des torts causés, l’aide à la reconstruction des victimes et le changement des auteurs de violence, l’accusé aurait probablement plus intérêt à s’exprimer et reconnaître ses torts.
Par ailleurs, si les fausses accusations consciemment élaborées dans le seul but de nuire sont rares, un phénomène plus courant, la réinterprétation par des individus du consentement donné précédemment, doit pouvoir être pris en compte. Nous avons cité précédemment le texte écrit par des femmes liées à la scène punk-métal qui, à la suite de l’article de Mediapart amalgamant des situations très différentes, mentionnaient la distinction à établir entre la gêne ou la souffrance ressentie et le fait que notre partenaire serait objectivement auteur d’une agression.
Dans son ouvrage Geoffroy de Lagasnerie insiste sur la complexité des interactions sexuelles et des situations « qui peuvent aller du malentendu à l’auto-contrainte, qui peuvent naviguer entre la violence et l’habitude, le oui et le non, le dit et le non-dit, le plaisir et l’ennui » [36]. La notion de zone grise peut nous servir à appréhender ces situations, à reconnaître la gêne et la souffrance sans désigner un coupable ou réifier un acte dans la catégorie de l’agression ou de l’abus. Il faut cependant savoir accueillir toutes les implications de cette notion. : « Le caractère problématique et inquiétant que peut prendre la politique de la sexualité quand elle s’inscrit dans un doublet sociologico-répressif apparaît (…) lorsqu’elle développe un usage descriptif d’une notion comme celle de zone grise mais qu’au lieu d’aller au bout de sa signification éthique elle ressaisit les actions qui s’y sont produites à travers une optique de l’extension de la logique de la punition individuelle et de l’identification d’un responsable – contre laquelle cette notion a pourtant été forgée … – en recodant tout un ensemble d’interactions protéiformes inscrites dans la logique de la pratique au prisme d’une catégorie comme celle d’abus (avec un abuseur et un abusé). » [37]
Par ailleurs, pour aider à penser la façon dont on peut réinterpréter une relation et se vivre comme victime d’un abus en y étant encouragé par certain cadres contemporains, Geoffroy de Lagasnerie mentionne sa rencontre avec Didier Eribon, de vingt-huit ans son aîné, et la façon dont il aurait pu réécrire ses souvenirs si la relation n’avait pas duré. [38] : « Alors que se multiplient aujourd’hui des prises de parole sur l’emprise, la différence d’âge et de statut dans les relations, l’abus, je voudrais conclure en racontant ce qui s’est passé lors de la naissance de la relation qui me lie avec Didier Eribon depuis plus de vingt ans : lorsque j’ai rencontré Didier, j’étais très jeune, nous avions une grande différence d’âge – nous l’avons toujours puisque cela ne change pas avec le temps – et il est certain que mon désir pour lui, le désir de coucher avec lui et d’avoir une relation avec lui, s’enracinait aussi dans le fait qu’il était ce qu’il était : son statut, la découverte à travers lui de la vie culturelle et intellectuelle, sa renommée, la fascination qu’exerçait sur moi la figure de l’auteur qui publie. Sa beauté et son attraction sexuelle étaient liées, comme dit Deleuze, à tout le monde qu’il portait en lui et qui se dépliait à travers lui. Lorsque ma mère a découvert cette relation, une crise violente a éclaté, avec des cris, des insultes (c’est aujourd’hui heureusement totalement apaisé) et, si j’avais eu deux ans de moins, si j’avais été mineur, elle aurait très certainement porté plainte. Ce que ma mère percevait à ce moment-là comme une emprise, je l’ai vécu comme un contre-pouvoir libérateur contre la famille, l’école, l’université – tous ces cadres qui exercent aussi leur emprise sans qu’on les mette jamais en question – et je crois que, grâce à la relation avec Didier, j’ai eu la chance d’avoir une vie beaucoup plus libre que celle que j’aurais eue si je ne l’avais pas rencontré.
Didier et moi sommes toujours amoureux et en couple. Mais les choses auraient pu se passer autrement. La vie pourrait avoir été différente. Didier aurait très bien pu me quitter, cesser d’être amoureux de moi ou rencontrer un autre garçon. Et peut-être aurais-je pu alors, quelques années plus tard, à cause de certains cadres contemporains, reconfigurer mon expérience, réécrire mon âme comme dit Ian Hacking et dénoncer Didier en disant que je me rends compte désormais qu’il a utilisé son prestige et son pouvoir pour me séduire et abuser de moi. J’aurais pu publier un tweet en disant : je me rends compte aujourd’hui que j’ai été abusé. Ou même : je me rends compte aujourd’hui que j’ai été violé. Et le pire est que j’aurais probablement été cru, que certains auraient pu m’écrire « je te crois » au point que j’aurais fini par y croire moi-même, et que Didier aurait alors été maltraité sur les réseaux voire publiquement dénoncé, que peut-être il aurait dû déménager, n’aurait plus été publié ou invité aux Etats-Unis. Peut-être y aurait-il eu des manifestants devant chez lui, des affiches collées pour le dénoncer.
Cette simple éventualité montre le caractère problématique de certaines formes de prises de parole contemporaines sur la sexualité qui tendent de plus en plus à être soumises à des opérations subjectives et rétrospectives d’interprétation, de reconstruction a posteriori de ressenti.
Nous pouvons tous faire des choses que nous regrettons au cours de nos vies, nous changeons d’avis, d’impression, de préférence … (…) Un problème politique apparaît lorsque cette reconstruction a posteriori a tendance à être promue comme étant non pas une interprétation a posteriori du passé mais comme une expression de la vérité du moment passé, dont c’est l’expérience alors ressentie qui aurait été mensongère » [39].
Outre la réflexion sur la façon dont deux vérités, celle du moment vécu et celle de l’analyse a posteriori peuvent soit se compléter soit s’opposer, l’intérêt de ce passage se situe notamment dans la description de réactions militantes bassement vengeresses. Selon ce qui est ici décrit par Lagasnerie, et fait écho à plusieurs affaires récentes [40], plus d’énergie semble dépensée pour harceler un coupable désigné que pour soutenir une personne en souffrance.
Aussi, souvent, dans les discours militants, les personnes qui ont subi des violences (ou qui se déclarent victimes en réinterprétant une relation passée) ne sont plus définies que par un statut de victime, et poussées à se percevoir uniquement par des événements subis. Cette essentialisation, à laquelle s’ajoute le fait de voir son destin relié éternellement à son agresseur réel ou supposé par les appels à la vengeance, ne fait qu’accroître le mal-être.
En outre, lorsqu’elles prennent la parole publiquement, certaines personnes se déclarant victimes reçoivent des centaines de messages leur rappelant leur traumatisme ou les appelant à porter sur leurs épaules le poids de l’ensemble des autres violences sexuelles. Ces comportements, favorisés par la distance liée à la numérisation des échanges, ignorent la violence produite par la rencontre entre les centaines de messages reçus, et la solitude éprouvée dans une chambre étudiante. Lorsqu’à cela s‘ajoutent des difficultés familiales, économiques, universitaires ou liées aux confinements successifs, nous l’avons malheureusement constaté, la souffrance peut conduire au suicide.
Dans ce cas, plutôt que de reproduire les mêmes mécanismes en appelant au lynchage des coupables désignés, le devoir des milieux militants devrait être d’entamer une réflexion sur la façon d’accueillir les paroles souffrantes sans accentuer les douleurs, et sans chercher automatiquement des monstres à châtier.
Exceptionnalisme sexuel, emprise et (dé)politisation du désir.
Geoffroy de Lagasnerie se méfie de la notion d’ « emprise ». En effet, si nous vivons dans un monde social fait d’inégalités et de différences de pouvoir, il est logique de constater que le désir est construit dans et par ce cadre. Il note toutefois, comme sur d’autre sujets, un paradoxe entre d’une part le recours à la sociologie pour constater les inégalités et analyser des structures, et d’autre part l’usage de la notion d’« emprise », qui soumet les rapports sociaux à « une analyse internaliste et individualisante ».[41]
Lagasnerie insiste sur la difficulté d’évaluer le consentement autrement que minimalement, au présent, en tant qu’absence de contrainte. On peut en effet, à l’appui de son propos, affirmer qu’aucune relation n’est exempte de rapports de pouvoir, et que cela ne nous permet pas pour autant de réinterpréter toutes nos interactions comme une ‘‘emprise’’, des ‘‘abus’’, voire des ‘‘viols’’. Cependant, pour nuancer, précisons que la contrainte n’est pas seulement physique ou liée à une menace, et qu’elle peut relever de la prise de pouvoir globale d’un individu sur un autre, favorisée par un rapport social inégalitaire. On pourrait aussi se demander, dans ces cas limites, par exemple la relation avec Gabriel Matzneff décrite par Vanessa Springora dans Le Consentement [42], où est la frontière, parfois poreuse, entre le simple changement de regard sur son vécu, et la mise à jour objective d’un système de contrainte.
À la suite de la publication de l’ouvrage de Vanessa Springora, la réaction principale a consisté à affirmer sur tous les tons qu’on ne peut pas être consentant à une relation avec un majeur avant d’avoir atteint 15 ans. Le propos de Springora est cependant plus précis et subtile, puisqu’elle se demande au contraire « comment admettre qu’on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant ». Aussi, Springora ne généralise pas ses observations à toutes les relations que des adolescent(e)s ont pu entretenir avec des adultes. Elle écrit au contraire de la façon la plus explicite qui soit qu’elle est prête à considérer qu’il peut exister une relation exceptionnelle entre un adolescent(e) et une personne plus âgée [43]. A propos de son histoire, elle décrit, dans un cadre donné, de façon précise et nuancée, sans généraliser ni réifier des catégories d’âge, des mécanismes de pouvoir, qui recoupent d’ailleurs ceux décrits par Matzneff lui-même dans ses ouvrages.[44]
On pourrait objecter à Geoffroy de Lagasnerie, qui fait du consentement et de l’absence de contrainte la clé de voûte de son analyse, que le consentement est une notion contractuelle et que, dans un cadre inégalitaire, le contrat peut aussi être ce qui entérine les inégalités. Il suffit par exemple d’avoir signé un contrat de travail, défini comme un lien de subordination, pour s’en apercevoir. Cependant, Lagasnerie remet préventivement en cause cette analogie. En effet, alors que dans le cas du travail, l’activité peut être vécue avec plaisir tout en relevant objectivement de l’exploitation et de la violence infligée aux corps, sans que les travailleurs en aient toujours conscience, dans le cas de la sexualité, écrit-il, la prise de conscience est inversée. C’est le fait de vivre subjectivement la violence, la conscience subjective de la contrainte, ou alors la réinterprétation d’une situation, qui produit le traumatisme.[45] Selon lui il n’y a donc pas, dans le cadre de la sexualité, hors situation d’amnésie, de violence objective qui ne soit pas éprouvée par le sujet. Il déduit de cela la nécessité de se borner à l’évaluation du consentement, au présent, et de se méfier des formes de violence que l’individu peut s’infliger à lui-même en réinterprétant ses souvenirs. [46]
La reconstruction a posteriori d’un souvenir ou la réinterprétation d’une situation, écrit-il, n’est ni totalement fausse, ni totalement vraie, et si elle possède à l’évidence une part de vérité, c’est aussi en tant qu’interprétation, et non comme simple vérité du moment.[47] Par ailleurs, si Lagasnerie va jusqu’à affirmer que la domination n’est pas objectivable dans des relations consenties [48], et s’il se méfie des réinterprétations a posteriori de notre vécu, ou des jugements extérieurs affirmant qu’une personne qui désire une relation serait cependant abusée car en position dominée (il va jusqu’à écrire que la réinterprétation du consentement au prisme des logiques de domination relève d’un « projet réactionnaire »), c’est notamment parce qu’une telle considération présuppose toujours une idée de ce que serait une relation ‘‘normale’’ : « Affirmer que quelqu’un a éprouvé du désir pour quelqu’un d’autre à cause d’une situation de domination et que son désir serait vicié car il a été façonné par l’histoire et la société ou « sous emprise » n’annule pas la réalité du désir et ne permet pas d’établir un « dommage ». Penser que la reconstruction sociologique de la naissance du désir vaut annulation du désir est aussi dénué de sens qu’affirmer qu’un phénomène est construit socialement voudrait dire qu’il n’existe pas. (…) Pour pouvoir mettre en cause un désir ou un fantasme en invoquant sa fabrication historique ou sa signification politique, il faut nécessairement supposer une norme de ce qu’aurait été un désir neutre, « non façonné » par la société et qui renvoie toujours implicitement à la figure de relations entre personnes d’âge, de classe, de groupe et de race homogènes et identiques… » [49]
Aussi, critique de la loi votée au début de l’année 2021 qui considère comme viol tout rapport sexuel entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur (dès lors que le majeur a cinq ans de plus), Lagasnerie rappelle la position du Planning familial qui, quelques années auparavant, face à un projet de loi analogue, s’alarmait que la sexualité des adolescents devienne « encore plus taboue et cachée », ce qui ne pourrait que contribuer à éloigner les mineurs des espaces de parole et des structures de soin. Lagasnerie critique aussi le renforcement du pouvoir des parents induit par une telle évolution législative, et notamment les possibilités d’intervention familiale pour empêcher une relation homosexuelle ou avec une personne dont l’origine déplaît à la famille.[50]
Geoffroy de Lagasnerie, tout en étant prêt à accepter l’idée d’une présomption de non-consentement des mineurs de moins de quinze ans avec des majeurs, défend la nécessité de juger les situations dans leurs singularités, et la possibilité de prouver que certaines de ces relations sont consenties. Il cite Edouard Louis et Rachid O, qui ont raconté une expérience érotique (dans le cas d’Edouard Louis) et des relations sexuelles (pour Rachid O) vécues à l’adolescence avec des hommes bien plus âgés, et la façon dont ces relations les ont émancipés de la violence qui s’exerçait dans les cadres scolaires et familiaux. Tout en précisant qu’il n’appelle pas à prendre ces exemples en modèle, il rappelle que de telles expériences existent, et qu’elles prouvent la nécessité de juger les situations au cas par cas.[51]
Lagasnerie semble s’inspirer de penseurs qui, dans les années 70, avaient défendu le fait que la pénalisation du viol ne devait pas se faire en fonction d’une barrière d’âge fixe et inamovible, mais de l’identification, par la jurisprudence, de ce que Michel Foucault nommait des « systèmes de contrainte ». En 1977, face à la commission de révision du code pénal, Foucault déclarait à propos des rapports entre majeurs et mineurs, qu’en dépit des « incertitudes du consentement », il préférait « un arbitraire décidé par le juge à un arbitraire décidé par la loi » [52].
Aussi, comme le rappelle Lagasnerie, Foucault avait proposé, dans le cadre d’une réflexion visant à émanciper la sexualité des tutelles de l’État, de « dé-sexualiser et dé-psychologiser le droit , par exemple en abordant le viol comme une violence physique – comme une agression – en abolissant la référence à la sexualité. Cette idée rejoint certains slogans prononcés par des activistes qui affirment, je crois à juste titre, que le viol n’est pas affaire de sexualité mais de violence. » [53]
Lagasnerie fait aussi remarquer que dans les cas de harcèlement sexuel à l’université ou au travail, c’est le plus souvent la connotation sexuelle des remarques ou des échanges qui est considérée comme le danger par la justice ou les médias, alors que le problème réside en réalité dans l’existence d’un rapport hiérarchique : « La focalisation sur les propos ou les gestes jugés offensants ou déplacés dans le cadre du travail, et la codification de ceux-ci comme relevant d’un problème de ‘‘harcèlement sexuel répréhensible’’ pourraient fonctionner comme une opération de stabilisation voire de renforcement de tout un ensemble de hiérarchies instituées. (…) Une moindre focalisation dramatisante sur la sexualité aurait pu amener à la construction d’une autre analytique, au sein de laquelle il pourrait sembler tout à fait normal voire sain qu’il y ait dans l’espace du travail des propositions, des incitations, des blagues, des relations … et qui seraient susceptibles d’être l’objet de réponses simples et libres si les hiérarchies et les rapports de pouvoir étaient transformés dans un sens égalitaire. » [54] En conclusion de son ouvrage, pour développer un rapport à la sexualité apaisé et non dramatique, l’auteur appelle à la fois à « désexualiser la sexualité [55] et la lutte contre les violences sexuelles », et à appuyer la critique des normes culturelles sur autre chose que des procédures pénales.[56]
En guise de conclusion …
Dans les réactions hostiles déclenchées par le livre sur les réseaux sociaux, les passages constatant l’existence d’un exceptionnalisme sexuel sont ceux qui ont fait le plus réagir. Lagasnerie y fut accusé, sur la base de citations opportunément tronquées, de légitimer le harcèlement sexuel ou de minimiser l’impact psychologique du viol. Parfois, il lui fut reproché, en tant qu’homme qui s’exprime sur ces sujets, de faire du « mansplaining », voir d’exprimer une position « masculiniste ». On pourrait se borner à ironiser sur l’absurdité d’un tel argument, qui présuppose que l’exceptionnalisme sexuel et le féminisme carcéral sont le seul point de vue féministe existant, lequel serait attaqué par Lagasnerie « en tant qu’homme », alors même que les mouvements féministes ont toujours été traversés par ces débats. On pourrait en outre faire remarquer qu’il est incohérent de demander à un auteur opposé par principe à la prison et critique de la justice pénale d’arrêter sa réflexion à la frontière des infractions sexuelles, alors même qu’il s’appuie sur la lecture de penseurs qui ont critiqué la sexualisation du droit. Mais on peut aussi profiter de l’occasion pour faire quelques observations sur les références intellectuelles qui sont celles de Lagasnerie.
D’une part, nous l’avons spécifié, Geoffroy de Lagasnerie se réfère à sa propre expérience, ou à d’autres expériences homosexuelles, en même temps qu’il entend prolonger les réflexions du mouvement gay. Il mentionne dans une interview récente pour le magazine Têtu la façon dont ce mouvement a fait baisser les violences homophobes par un combat culturel, sans demander plus de répression [57]. On peut aussi déceler dans son livre la méfiance du mouvement gay vis-à-vis de toute prise en charge de la sexualité par l’État, et son rejet de la définition par le pouvoir politique d’une norme relationnelle trop rigide.
D’autre part, son affirmation selon laquelle la violence sexuelle est bien plus une affaire de violence que de sexe rejoint celle des féministes dites pro-sexe qui se sont exprimées dans les années 80, dans le contexte de ce qu’il est convenu d’appeler les sex wars. Alors que des féministes radicales comme Catharine MacKinnon (à l’origine de la définition du harcèlement sexuel dans la loi américaine) et Andrea Dworkin (qui fut l’initiatrice de campagnes contre la pornographie et la prostitution) assumaient une critique de la sexualité, qu’elles amalgamaient à la violence de genre, d’autres féministes, comme Gayle Rubin, dites pro-sexe, ont tenu à effectuer cette séparation entre sexualité et violence de genre.[58] Pour les féministes pro-sexe, la violence sexuelle est plus liée à un ordre social (qui peut par ailleurs diaboliser les sexualités minoritaires) qu’à la dimension strictement sexuelle de l’interaction.[59]
Lagasnerie prolonge cette réflexion, et semble voir dans la focalisation sur la dimension spécifiquement sexuelle de ces violences, l’origine des réflexes punitifs à gauche. Au début de son ouvrage, il écrit notamment : « Il existe dans nos sociétés quelque chose comme une sorte d’exceptionnalisme sexuel. Cet exceptionnalisme sexuel apparaît notamment dans le fait que, sur ce sujet, la gauche semble oublier ses principes et inverse ses analyses. Alors que la critique de la prison, de l’individualisation de la responsabilité, de l’approche répressive occupe une place d’ordinaire essentielle dans les mouvements progressistes, la mobilisation contre les violences sexuelles prend presque toujours la forme d’un appel à renforcer l’action répressive et punitive : critique de la justice pour ne pas assez punir les violeurs ou les agresseurs sexuels, appel à augmenter l’âge du consentement, mise en question des règles de la prescription voire son principe même, revendication permanente d’une aggravation des peines et invention de nouveaux délits, de nouveaux crimes ou de nouveaux critères d’incrimination, refus de la possibilité de la réhabilitation, de l’oubli, du pardon. (…) La sexualité est aujourd’hui l’un des seuls domaines qui engendre des logiques de bannissement. Pour des révélations d’attitudes ou de comportements qui sont parfois seulement décrits comme inappropriés ou offensants, certains perdent leur travail et toute possibilité de retrouver un travail dans le secteur culturel – alors que la gauche n’a cessé de se battre pour l’idée de réhabilitation. Comment expliquer par exemple que, à la suite du témoignage d’Adèle Haenel dans Mediapart en 2019, il semble inconcevable que Christophe Ruggia, qu’elle accusait de caresses et de désirs déplacés, refasse un film alors que dans le même temps et heureusement d’ailleurs, des rappeurs, des cinéastes, d’anciens braqueurs ou brigades rouges peuvent continuer à tourner, chanter ou publier y compris lorsqu’ils ont été condamnés pour enlèvement, séquestration, appartenance à une bande armée … ? »
Cette affirmation de l’existence d’un exceptionnalisme sexuel « dans nos sociétés » mériterait probablement d’être nuancée. On peut d’une part observer que dans certains discours de droite [60], c’est au contraire dans les seuls cas d’accusations de violence sexuelle que l’on peut entendre la dénonciation d’une justice expéditive ou d’un tribunal médiatique, autant de précautions qui ne sont pas prises lorsque, par exemple, un rappeur ou un humoriste est désigné comme islamiste à longueur de colonnes. D’autre part, la focalisation à gauche sur des cas individuels et la défense d’un populisme pénal ne concernent pas que les cas de violences sexuelles. Ainsi, alors qu’animer des ateliers en prison et ‘‘œuvrer à la réinsertion’’ sont pourtant perçus de façon positive dans le milieu de la culture, de nombreuses voix s’élèvent à chaque fois que Bertrand Cantat, qui a pourtant fini de purger sa peine en 2010, envisage de se produire sur scène. Aussi, et Geoffroy de Lagasnerie l’a plusieurs fois mentionné, de nombreuses enquêtes journalistiques portant sur les violences policières, le harcèlement au travail ou la fraude fiscale, se bornent à pointer des actes présentés comme de simples dysfonctionnements, des fautes individuelles, et masquent ainsi les structures sociales, les mécanismes d’exploitation et de répression.[61] C’est donc logiquement que, de cette focalisation sur les responsabilités individuelles, peuvent découler chez de nombreux activistes la jubilation face à l’incarcération de Claude Guéant et Patrick Balkany, ainsi que la dénonciation du ‘‘laxisme’’ qui caractériserait le traitement de Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy ou Alexandre Benalla.
Lagasnerie a cependant raison de constater que « la sexualité n’est pas un sujet de réflexion comme les autres. Il est chargé d’une intensité émotionnelle particulière qui rend parfois impossible la discussion. (…) La sexualité est un domaine à propos duquel les prises de position sont souvent marquées par une forme d’irrationalité parce que beaucoup y réfléchissent en ayant en tête des images de telle ou telle pratique ou de tel ou tel type de relation qui provoquent chez eux des dégoûts, ce qui empêche alors toute forme de raisonnement apaisé.
D’ordinaire, la pluralité des points de vue sur une question est appréhendée comme un point de départ que la discussion a pour fonction de conjurer et de réduire au minimum possible. Mais sur la question sexuelle, il est sans doute beaucoup plus pertinent de considérer la diversité des investissements et des sensibilités comme une donnée irréductible et un indépassable. »[62]
Cependant, à l’inverse des féministes pro-sexe ou des penseurs queers, si Lagasnerie critique la focalisation étatique et médiatique sur la dimension sexuelle des abus, et s’il constate la spécificité des débats relatifs à la sexualité, ce n’est pas, il me semble, pour accorder une autre place au désir dans la politique, ni pour analyser les différences entre les relations. Judith Butler a insisté sur le fait que la sexualité peut reproduire des normes de genre, mais qu’elle peut aussi les subvertir.[63] Précédemment, Foucault avait décrit les modes de vie homosexuels dans ce qu’ils avaient de spécifique, et avait vu leur existence comme une opportunité de réinventer les relations.[64] Hocquenghem et le FHAR avaient quant à eux défendu une homosexualité révolutionnaire remettant en cause des attendus liés à la préservation de l’ordre social, telles que la fixité du partenaire, la centralité de la reproduction ou l’existence de relations entre personnes de même âge, de même origine et de même classe sociale. Des visions de l’homosexualité comme défense d’une communauté et de formes de vie minoritaires sont encore aujourd’hui présentes, par exemple, dans les écrits de Didier Lestrade [65] ou Alain Naze [66].
Au contraire, je crois, Geoffroy de Lagasnerie, qui considère que le rapport à l’esthétique n’est pas politique [67], semble avoir le même point de vue à propos du désir. En citant la façon dont le désir sexuel est décrit par Edouard Louis dans ses récits, Lagasnerie l’associe essentiellement à une action du corps, plus qu’à un imaginaire ou à des représentations symboliques qu’il s’agirait d’analyser. Il aborde aussi l’homosexualité, et semble-t-il le désir en général, comme un simple « choix d’objet ». Il l’explique dans son entretien pour Têtu : « Toute forme de critique sociale du désir suppose une norme implicite et souvent réactionnaire de ce qu’aurait dû être un désir non vicié. On va essayer d’expliquer le désir pour une personne avec un âge différent, une classe différente, une origine différente … Quand l’âge ou le milieu sont identiques, on ne remet jamais en question ce désir, on le présuppose comme évident, contrairement à ceux qui seraient liés à un phénomène de domination. On ratifie donc l’idée qu’il y aurait des choix d’objets légitimes … Je pense qu’il faut réaffirmer une forme d’autonomie de la sexualité et du désir par rapport à la politique. On peut très bien fantasmer de coucher avec quelqu’un qui se déguise en policier et qui menotte, insulte ou frappe, et lutter contre les violences policières. Foucault, par exemple, aimait les rapports SM, il n’avait pas pour autant envie de se faire taper dans la rue. » [68]
Dans ses textes critiques de la psychanalyse, Didier Eribon a aussi insisté sur le danger à établir des jugements sur le désir ou sur les relations sentimentales et sexuelles.[69] L’évaluation du désir ou d’une relation présuppose toujours une norme et il est légitime de refuser les polices des mœurs. On peut cependant se demander si, au nom du refus de penser à partir d’une norme, Lagasnerie et Eribon ne s’interdisent pas parfois d’analyser l’imaginaire et les symboles qui structurent les désirs.
En outre, la situation décrite par Lagasnerie comme exemple d’un désir dépolitisé n’est pas autant exempte de politique qu’elle en a l’air. En effet, le fantasme d’être dominé par un homme déguisé en policier (voire par un vrai agent de police), ou le fait de prendre plaisir d’une mise en scène de violence policière, comporte une distance critique vis-à-vis du pouvoir. Le masochisme, expliquait Deleuze, est une ironie sur le pouvoir, qui vise à le détourner de son objet pour en prendre plaisir.[70]
Il y a quelques années, dans un article à propos du BDSM publié dans Harz-Labour [71], publication rennaise distribuée au cœur des luttes, j’avais tenté d’expliquer que « dans ces relations, plutôt que de nier l’existence du pouvoir qui nous traverse et nous produit, le but est d’œuvrer à sa circulation, à son détournement ou à son retournement, et d’en tirer plaisir. Certes, nous connaissons les discours de ceux qui affirment que les adeptes du BDSM seraient, malgré certaines transgressions, extrêmement respectueux de la dichotomie domination / soumission. Pourtant, le fait de tirer plaisir des pratiques de domination et de soumission, souvent lié à la conscience du caractère arbitraire de cette pantomime, constitue un trouble dans les rapports de pouvoir. »
Contrairement à Geoffroy de Lagasnerie, je ne considère pas que le rapport de Foucault au SM soit à dissocier de sa réflexion sur les rapports de pouvoir et la subjectivation qui en découle. Aussi, quand Foucault aborde la question de la désexualisation de la sexualité (il signifie par là la défense d’une érotique polymorphique, la rupture de la sexualité avec un ensemble de normes, dont le caractère central accordé à la génitalité), cela est à mettre en lien avec sa « politique de l’amitié » associée au mouvement gay, et l’invention de nouveaux rapports et de nouveaux modes de vie.
Par ailleurs, Lagasnerie, semble se distancier d’une approche révolutionnaire de l’homosexualité, qui ne la définissait pas comme un « choix d’objet », une attirance pour le même sexe, mais comme une subjectivation, liée, entre autres, à un rapport à la nuit, à la communauté, à l’altérité, à la provocation, etc. Cette vision était tellement présente que Deleuze, qui n’était pas homosexuel, a pu s’y reconnaître. Dans le même temps, Guy Hocquenghem et Hervé Guibert ont pu imaginer, dans des romans autofictionnels, la relation de leur alter-ego avec une femme.
La prétention révolutionnaire d’une partie du mouvement homosexuelle était notamment détaillée par Quentin Dubois l’été dernier, lors d’une présentation de l’œuvre de Guy Hocquenghem et de l’histoire du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire que nous avions effectuée ensemble : « Cette prétention révolutionnaire [celle du FHAR] fit éviter des écueils politiques de taille (la reterritorialisation dans l’identité, les supplications d’être reconnus comme respectables, mais aussi de défendre l’homosexualité comme un choix d’objet ou une préférence, un amour du même, un « amour entre un homme qui aime un homme »). Il s’agissait donc de tenir ensemble économie politique et économie libidinale, et de produire une politique révolutionnaire fondée sur l’auto-affirmation d’un pouvoir d’inquiéter l’hétérosexualité prenant pour cible le cabinet psy, la famille et l’école. » [72]
Geoffroy de Lagasnerie ne centre pas son approche politique sur les analyses du désir ou des relations, ni sur des considérations esthétiques ou l’attention au déploiement d’une puissance communautaire. Il ne semble pas reconnaître de fonction autotélique à la politique, mais simplement l’aborder en fonction de la nécessité d’exprimer des revendications pour faire reculer les inégalités et accroître la liberté des individus. Il s’écarte là de nombre de pensées émancipatrices qui, après mai 68, n’ont pas pris pour point de départ un apport rationaliste et utilitariste à la politique (comme revendication vis-à-vis des institutions), mais plutôt ce que René Schérer nommait dans un entretien récent « les incursions de la pensée désirante ».[73]
Nourrissant sa pensée de la lecture des théoriciens néo-libéraux, Lagasnerie se méfie à juste titre de l’autoritarisme que peut porter une vision de la politique qui ne met pas l’individu au centre. Il semble aussi refuser une évaluation politique des relations, ou une définition politique de ce que sont des relations désirables. Geoffroy de Lagasnerie ne semble pas considérer que la philosophie ou l’engagement politique doivent évaluer le désir, ou définir des formes d’exister plus désirables que d’autres. Selon son approche, la politique doit simplement créer des formes sociales qui permettent aux personnes de choisir la façon dont elles souhaitent vivre. Tout en comprenant sa méfiance, je considère quant à moi, et c’est peut-être ce qui nous différencie principalement, qu’une lutte ne mobilise largement que lorsqu’elle est liée à un imaginaire et à une représentation symbolique, jusqu’à faire écho à des conceptions esthétiques ou des visions éthiques du monde. Cette divergence ne concerne pas que la politique de la sexualité, bien qu’elle la recoupe. Son approche utilitariste de l’art, sa défense de créations obligatoirement engagées, ses affirmations selon lesquelles les récits doivent être explicites et liés à des discours sociologisants, en lien avec son refus de faire des rapprochements entre politique et esthétique [74], me semble relever du même refus de prendre en compte la part d’imaginaire et d’affects présente dans toute lutte sociale.
Je considère que les luttes politiques gagneraient à ce que celles et ceux qui y participent admettent les dimensions psychologiques et désirantes de l’engagement, et pensent plus, en positif, ce à quoi ils aspirent, ce qui nous porte subjectivement, esthétiquement, éthiquement, y compris en ce qui concerne les aspects relationnels ou sexuels. Dans ce cadre, qui n’est pas celui du recodage de l’insatisfaction ou de la gêne sur le mode d’une dénonciation d’un abus, de l’identification d’un coupable et d’une demande de condamnation, où le but n’est pas d’interdire ou de punir, il me semble aussi plus aisé de réfléchir à la place des rapports de domination dans les rapports consentis, d’analyser des relations passées sans se subjectiver comme victime a posteriori, et sans produire de nouvelles normes coercitives.
Cependant, il convient d’observer que l’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie, Mon corps, ce désir, cette loi, a de nombreux mérites. Nous avons insisté sur sa critique salutaire des demandes de renforcement de l’état pénal qui s’expriment dans la lutte contre les violences sexuelles, et sur sa reprise des positions émancipatrices pour une justice restauratrice et transformatrice. Mais Lagasnerie a aussi le mérite d’expliciter plusieurs rapports au sexe, et différents points de vue sur le lien que l’on doit établir, ou non, entre la sexualité et la politique. Y compris dans son caractère polémique, l’ouvrage ouvre donc plusieurs débats.
[1] Geoffroy de Lagasnerie, Mon corps, ce désir, cette loi : réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021, p21.
[2] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p16.
[3] Michel Foucault, Leçon du 7 janvier 1976, publiée dans Dits et écrits, tome II : 1970-1975, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1994 , p163.
[4] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p27.
[5] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid p11.
[6] L’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie, cela nous est précisé d’emblée, « est la version développée d’une conférence prononcée lors du colloque « Edouard Louis : écrire la violence » qui s’est tenue à la Cité universitaire à Paris le 19 juin 2021 et il doit être lu comme tel ».
[7] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid p12.
[8] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p12.
[9] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p24.
[10] Lire à ce sujet Faut-il brûler Hocquenghem ?, d’Antoine Idier. Lire Hocquenghem de Mickael Tempête ou encore Le système de l’enfance, de Quentin Dubois et moi-même.
[11] Comme en témoigne le communiqué intitulé « Vous n’aurez pas la paix », se scandalisant notamment de l’apposition d’une plaque rendant hommage à Guy Hocquenghem, signé par une coalition allant de féministes « intersectionnelles » à l’Association Enfants Prévention Actions Pédocriminalité Inceste (EPAPI) et l’Association internationale des victimes de l’Inceste (AIVI), dont les principaux combats sont la dénonciation d’une justice considérée comme complice des pédophiles, et, dans le cas de l’AIVI la lutte contre les cours d’éducation sexuelle à l’école, qui relèveraient selon l’organisation de la « perversion » et viseraient à « attaquer l’enfance afin de la formater vers une quête de jouissance sexuelle précoce » : https://aivi.org/vous-informer/actualites/2886-quelle-education-sexuelle-pour-nos-enfants-le-colloque-2018-du-reppea.html
[12] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p24.
[13] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p25-26.
[14] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p33.
[15] Virginie Despentes, « Désormais on se lève et on se barre », Libération.fr, 1er mars 2020.
[16] Paul Aveline, Complots et pédocriminalité : Karl Zéro en roue libre, dans Arrêts sur images le 6 novembre 2021
[17] On peut commander le viol d’un enfant en ligne…et tout le monde s’en fout ? #1SUR5 chez BTP
[18] Daniel Schneidermann, #MeToo : le cas de Geoffroy de Lagasnerie, Libération, 27 décembre 2021
[19] Guy Hocquenghem et René Schérer, L’Âme atomique. Pour une esthétique d’ère nucléaire, Paris, Albin Michel, 1986.
[20] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 44-45.
[21] Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes : femmes contre la prison, Lux Editeur, 2019.
[22] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 41.
[23] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 49-50.
[23] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 46.
[25] Donatien Huet, Violences sexuelles : les musiques extrêmes face à leurs démons, dans Mediapart, 22 mai 2021
[26] Collectif, Violences sexuelles dans la scène punk/metal : les suites d’un séisme, billet de blog, 15 novembre 2021
[27] Arrêts sur images, Un tribunal médiatique ? « Il y a plein d’enquêtes qu’on ne publie pas », 10 décembre 2021.
[28] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 34.
[29] Lénaïg Bredoux et Marine Turchi, Violences sexuelles : révélations sur le comportement de Juan Branco, Médiapart, 10 juin 2021.
[30] Juan Branco a depuis été mis en examen. Il nie avoir exercé une quelconque contrainte, et c’est sur cette dimension que porte l’enquête de la justice.
[31] Marine Turchi, Affaire Duhamel : d’autres éléments pourraient intéresser la justice, Médiapart, 14 avril 2021.
[32] Entretien avec Michel Foucault par René de Ceccaty, Jean Danet et Jean Le Bitoux, paru dans le Gai Pied, N°25, avril 1981, pages 38-39. Paru également dans Dits et Écrits tome IV.
[33] Collectif, Pour une culture de la solidarité, Rébellyon, le 30 juillet 2020
[34] Elian Peltier, Adèle Haenel : « La France a complètement raté le coche » de #MeToo, New York Times, 24 février 2020
[35] Collectif, #MeToo aux candidat·e·s à la présidentielle : «Qu’allez-vous faire pour que les hommes cessent de violer ?», dans Libération le 10 décembre 2021
[36] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p51.
[37] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p53.
[38] Il faut préciser ici que contrairement à ce qui a été écrit par Judith Duportail et Daniel Schneidermann, ce récit n’est pas le sujet principal de l’ouvrage. Il occupe trois pages du livre, et n’est là qu’à titre d’exemple.
[39] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p95-98.
[40] Marion Cocquet et Marc Leplongeon, MeTooGay, les coulisses d’un drame, dans Le Point, n°2525, 18 mars 2021.
[41] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p57.
[42] Vanessa Springora, Le Consentement, Paris, éditions Grasset, 2020.
[43] Vanessa Springora écrit dans Le Consentement : « La situation aurait été bien différente si, au même âge, j’étais tombée follement amoureuse d’un homme de cinquante ans qui, en dépit de toute morale, avait succombé à ma jeunesse, après avoir eu des relations avec nombre de femmes de son âge auparavant, et qui, sous l’effet d’un coup de foudre irrésistible, aurait cédé, une fois, mais la seule, à cet amour pour une adolescente. Oui, alors là, d’accord, notre passion extraordinaire aurait été sublime, c’est vrai, si j’avais été celle qui l’avait poussé à enfreindre la loi par amour, si au lieu de cela G. n’avait pas rejoué cette histoire cent fois tout au long de sa vie ; peut-être aurait-elle été unique et infiniment romanesque, si j’avais eu la certitude d’être la première et la dernière, si j’avais été, en somme, dans sa vie sentimentale, une exception . Comment ne pas lui pardonner, alors, sa transgression ? L’amour n’a pas d’âge, ce n’est pas la question. »
[44] Dans un article intitulé Lire Matzneff et publié par Lundimatin, Antoine Mazot-Oudin et moi-même avons montré, en citant Gabriel Matzneff, en quoi son pouvoir sur les adolescentes et les enfants ne relève pas de la revendication d’une libération sexuelle, ni même d’un quelconque gauchisme post-soixante huitard, mais d’un système littéraire de pouvoir et de prédation assumé comme tel, qu’il légitime par ses références aristocratiques et sa misogynie.
[45] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p58-59.
[46] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p105-106.
[47] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p59-60.
[48] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p62.
[49] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p62-63.
[50] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p82.
[51] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p78-79.
[52] Antoine Idier, Michel Foucault devant la commission de révision du code pénal, dans Lundimatin, le 17 mai 2021
[53] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p91.
[54] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p74-75.
[55] C’est-à-dire la rupture avec les normes et les discours aujourd’hui existants qui encadrent la sexualité, et la défense des actes sexuels comme relevant d’une activité parmi d’autres, importante mais désacralisée et dédramatisée.
[56] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p105-106.
[57] Dans le numéro de janvier-mars 2022, Lagasnerie déclare que le mouvement gay « tout en étant très peu punitif (…) a transformé les structures sociales et mentales, et fait diminuer le nombre d’agressions et le niveau de violences auxquels sont exposés les gays. C’est un mouvement culturel, mais, surtout, un mouvement qui a demandé des droits plutôt que des peines et qui a, de cette façon, obtenu une transformation puissante de l’hégémonie culturelle »
[58] Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, textes rassemblés et édités par Rostom Mesli, traductions françaises de Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, EPEL, 2010.
[59] L’histoire de ces débats est notamment résumée par Eric Fassin dans sa préface à Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, préface d’Éric Fassin, traduction de Cynthia Kraus, La Découverte, Paris, 2005.
[60] Par exemple dans les articles du journal Marianne, ou, plus proche de l’extrême-droite, dans les prises de position d’Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy ou Eugénie Bastié.
[61] À propos d’une enquête dénonçant le comportement d’Esther Benbassa vis-à-vis de ses subordonnés, il écrivait récemment, « si, comme on le dit souvent lorsque l’on souhaite malgré tout défendre ce genre de papier, le problème du harcèlement au travail, et notamment sur les assistants parlementaires, est structurel et qu’il faut en parler, je suis évidemment d’accord – mais alors que l’enquête soit structurelle et non pas individualisante et donc dépolitisante comme elle l’est ici. Au moment des Panama Papers Julian Assange avait fait un entretien dans lequel il avait souligné que le journalisme, en s’étant concentré sur quelques évadés fiscaux, avait volé l’histoire en ne parlant pas des structures du capitalisme et de la banque qui avaient rendu possible toute cette évasion fiscale. C’est la même chose qui se passe ici. Est-ce que ce type d’enquête me dit quelque chose des structures de pouvoir dans la société où est-ce qu’elle nous vole l’histoire en ciblant de manière totalement arbitraire et fallacieuse une personne, dont on abstrait quelques faits même graves de toute son histoire – ce qui fait que l’on inscrit les faits reprochés dans son caractère, son tempérament, beaucoup plus que dans le droit du travail ou le fonctionnement des institutions… »
[62] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p18.
[63] Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, préface d’Éric Fassin, traduction de Cynthia Kraus, La Découverte, Paris, 2005.
[64] Entretien avec Michel Foucault par René de Ceccaty, Jean Danet et Jean Le Bitoux, paru dans le Gai Pied, N°25, avril 1981, p38-39. Paru également dans Dits et Écrits tome IV texte n°293.
[65] Didier Lestrade, Pourquoi les gays sont passés à droite, Paris, Le Seuil, 2012.
[66] Alain Naze, Manifeste contre la normalisation gay, La Fabrique, 2017.
[67] Geoffroy de Lagasnerie, L’Art impossible, Presses universitaires de France, coll. « Des mots », 2020.
[68] Geoffroy de Lagasnerie, « Le mouvement gay pourrait inspirer la lutte contre les violences sexuelles« , dans Têtu, janvier-mars 2022
[69] Didier Eribon, Écrits sur la psychanalyse, Paris, Fayard, 2019.
[70] Gilles Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel, avec le texte intégral de La Vénus à la fourrure, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 1967.
[71] Harz-Labour n°21, Jouir avec ou sans entrave. Ce que le BDSM peut nous apprendre
[72] Quentin Dubois et Vivian Petit, Hocquenghem, réflexion sur la défaite homosexuelle, Lundimatin, le 23 août 2021
[73] Lundimatin, Entretien avec René Schérer, le 15 février 2021
[74] Geoffroy de Lagasnerie, L’Art impossible, Presses universitaires de France, coll. « Des mots », Paris, 2020.
/////// Autres documents
Entretien avec Gwenola Ricordeau, à propos de son livre, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, publié aux éditions Lux.
Entretien avec Geoffroy De Lagasnerie, sociologue et philosophe, à propos de son ouvrage La conscience politique, publié aux éditions Fayard. Entretien > Emmanuel Moreira Image > Cyril Zannettacci Dans la théorie politique « tout se passe comme si une sorte de magie était à l’ouvre dans […]
Que peut la sociologie lorsqu’elle interroge le système du jugement et de la répression ? C’est l’enjeu du dernier livre de Geoffroy de Lagasnerie : Juger. L’Etat pénal face à la sociologie.
Entretien radiophonique.


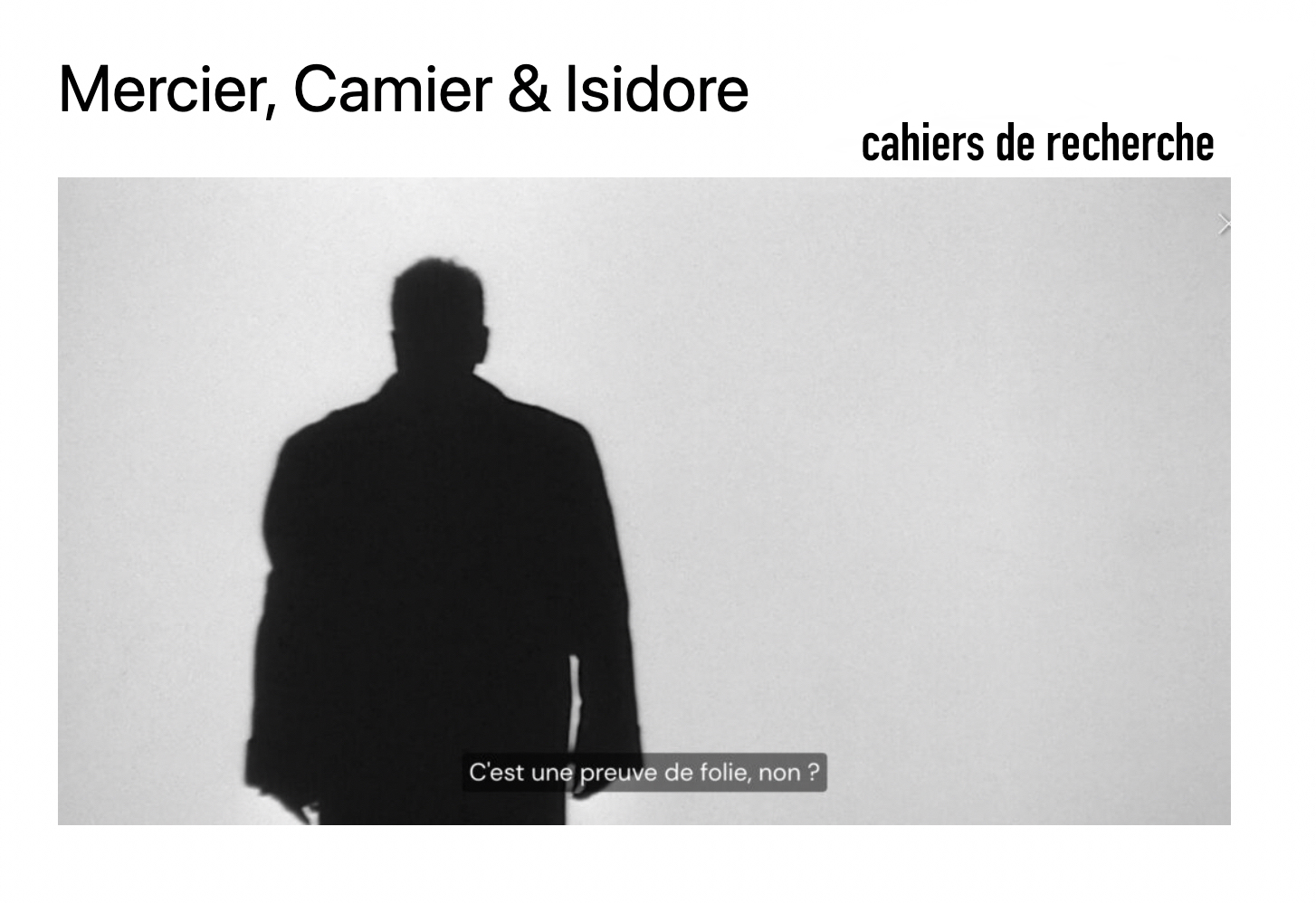



politique(s) de la sexualité
par Vivian Petit
A propos de Mon corps, ce désir, cette loi. Réflexions sur la politique de
la sexualité, Geoffroy de Lagasnerie, éditions Fayard, 2021.
Nous avons souhaité proposer à Vivian Petit une lecture de l’ouvrage Mon corps, ce désir, cette loi. Réflexions sur la politique de la sexualité de Geoffroy de Lagasnerie, publié aux éditions Fayard en octobre 2021. Cette recension initialement prévue pour le projet éditorial Pneûma &ligature qui malheureusement n’a pu voir le jour, trouve naturellement sa place dans les pages de La vie manifeste. L’occasion pour nous de lui renouveler nos remerciements pour cette lecture qui vient enrichir le livre de Geoffroy de Lagasnerie et apporter quelques éléments critiques quant à la visée politique dans laquelle s’inscrit la contribution de Geoffroy de Lagasnerie aux débats sur la sexualité et les politiques d’émancipations.
Vivian Petit contribue à plusieurs revues, notamment Lundimatin et Harz-Labour. Parmi ses articles publiés dans Lundimatin on peut lire Hocquenghem, réflexions sur la défaite homosexuelle ; Le système de l’enfance, Lectures de Guy Hocquenghem et René Schérer ; Les messes noires de Michel Foucault, le bullshit de Guy Sorman (co-écrits avec Quentin Dubois), Lire Matzneff (co-écrit avec Antoine Mazot-Oudin). Il travaille actuellement à l’écriture d’un ouvrage autour de la figure de Rimbaud. Il a également effectué deux voyages en Palestine : le premier en Cisjordanie et à Jérusalem, en avril 2009, le second à Gaza, de février à avril 2013, période durant laquelle il a travaillé comme enseignant au Département de français de l’université Al-Aqsa. De ces deux séjours il a publié Retours sur une saison à Gaza (éditions scribest 2017).
Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Ses travaux portent sur l’art, la culture et les intellectuels, sur la philosophie sociale et politique ou encore sur la théorie critique. Il est notamment l’auteur de Juger. L’État pénal face à la sociologie, (Fayard, 2016) ; Penser dans un monde mauvais (PUF 2017) ; Le Combat Adama, avec Assa Traoré (Stock, 2019) ; La Conscience politique (Fayard, 2019). Il dirige la collection «à venir» aux éditions Fayard.Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue, professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Ses travaux portent sur l’art, la culture et les intellectuels, sur la philosophie sociale et politique ou encore sur la théorie critique. Il est notamment l’auteur de Juger. L’État pénal face à la sociologie, (Fayard, 2016) ; Penser dans un monde mauvais (PUF 2017) ; Le Combat Adama, avec Assa Traoré (Stock, 2019) ; La Conscience politique (Fayard, 2019). Il dirige la collection «à venir» aux éditions Fayard.
Mon corps, ce désir, cette loi est un livre qui s’inscrit dans la pensée critique de l’abolitionnisme pénal et dresse les apories discursives auxquelles ne cesse de se heurter la politique de la sexualité autour de la question du désir et de la conscience, de la liberté et de l’emprise. Si l’exploitation, la brutalisation du corps, la violence corporelle sont des réalités objectivables dans le cas du travail, l’auteur refuse cette objectivation aux relations sexuelles consenties. Celles-ci se développent à l’intérieur d’une «zone grise» qui résiste à l’objectivation. Et c’est le concept même de domination que l’auteur veut suspendre pour rendre compte des relations sexuelles consenties, car le désir ne se retrouve pas annulé dans la saisie d’un tel concept. Lorsque la sexualité se trouve mêlée à des rapports de hiérarchie, est-ce la sexualité ou la hiérarchie qui pose problème ? N’est-ce pas les rapports de hiérarchies qui posent problème à la possibilité de relations sexuelles et non l’inverse ? Pourtant, bien souvent, dans les discours qui font usage du concept de domination et d’emprise, c’est le désir qui se retrouve sacrifié sur l’autel de la hiérarchie.
politique(s) de la sexualité – Vivian Petit
À l’automne dernier, Geoffroy de Lagasnerie a fait paraître Mon corps, ce désir, cette loi, ouvrage dans lequel il propose de repenser la politique relative aux violences sexuelles afin d’analyser leurs causes structurelles plutôt que de focaliser sur les seules responsabilités individuelles. Ainsi, Lagasnerie, qui s’inspire des travaux visant à l’abolitionnisme pénal et à l’émergence d’une justice réparatrice et transformatrice, critique la focalisation d’une partie des discours féministes contemporains sur la dimension pénale et punitive de la lutte contre les violences sexuelles.
Si ce livre est courageux, c‘est notamment parce qu’il entend échapper aux fausses dichotomies établies dans le contexte post #Metoo. En effet, les histoires du féminisme, du mouvement gay, et celle des luttes contre les violences sexuelles sont traversées par des débats et des tendances diverses depuis des décennies. Aussi, comme l’écrit Lagasnerie, « le champ de la politique de la sexualité » est « un espace où s’opposent des épistémologies différentes du traumatisme et de la répression, des conceptions de l’agression sexuelle et de ce que veut dire être victime et être coupable, de la répression et de la vengeance, du bonheur et du malheur, de la norme et du désir »[1]. Par conséquent, précise Lagasnerie, il serait erroné de réduire les réflexions à propos des violences sexuelles (notamment sur les façons de les définir, de les reconnaître ou de les empêcher), à une opposition entre un mouvement féministe soutenant les victimes face à leurs agresseurs d’une part, et des personnes résistant à ce mouvement d’autre part.
Geoffroy de Lagasnerie entend prolonger l’histoire du mouvement gay, dont il espère que les luttes contre les violences sexuelles s’inspireront. Dans les premières pages de son livre, avant d’entrer dans la discussion et d’interroger des points précis de certains discours féministes contemporains, il précise d’emblée qu’il partage « les mêmes constats et les mêmes objectifs qui constituent ce que l’on pourrait appeler le socle politique du féminisme », à savoir « la nécessité de lutter contre la violence, les agression, les multiples formes de domination que subissent les femmes et les minorités sexuelles dans toutes les sphères de la vie sociale, professionnelle, domestique ». Et il précise : « l’espace des interrogations que je veux rouvrir suppose la reconnaissance de ce socle et son acceptation comme une évidence ».[2]
Tout en se situant à gauche et en partageant les objectifs affichés de lutte contre la domination masculine, le livre de Lagasnerie se distingue de la masse des écrits sur les violences sexuelles en plusieurs points. D’abord, Lagasnerie ne considère pas qu’il existerait une seule ‘‘parole des victimes’’ qui se ‘‘libérerait’’. Il pointe au contraire une opération politique dans la mise en avant de certaines paroles de victimes – souvent celles qui affirment le caractère irréparable du traumatisme et la nécessité de punir – aux dépens d’autres expressions. Ensuite, Lagasnerie refuse de célébrer le durcissement des lois sanctionnant les infractions sexuelles, notamment la répression grandissante des rapports entre majeurs et mineurs, comme un progrès ou un nouveau pas effectué dans la grande marche vers l’égalité. Il critique un « exceptionnalisme sexuel », et constate que des organisations et des militant(e)s « progressistes », d’ordinaire critiques du populisme pénal et généralement enclins à mettre en avant les causes des violences plutôt que les seules responsabilités individuelles, rompent subitement avec leurs principes dès lors qu’il s’agit de faire condamner des auteurs d’infractions sexuelles. Cette observation sur la singularisation des violences sexuelles vis-à-vis d’autres formes de violences pousse Lagasnerie à interroger la place de la sexualité dans les représentations et les discours contemporains. Sa réflexion sur la sexualité, le conduit à inviter à ne pas surestimer l’influence des actes sexuels dans le développement psychique, dès lors qu’ils ne sont pas imposés, et à considérer les violences sexuelles au même titre que d’autres violences physiques. En désacralisant la sexualité, en considérant que le consentement ou la violence doit être le critère principal pour juger une relation, Lagasnerie appelle aussi à se méfier de la notion d’« emprise », qui invaliderait le désir dès lors que celui-ci serait développé dans un contexte inégalitaire et, surtout, qui présuppose selon l’auteur une norme de ce que devrait être une relation ‘‘normale’’ ou un désir « non vicié ». Enfin, puisque tout désir est par définition socialement construit au sein d’un ordre social inégalitaire, mais que ce désir peut tout de même nous structurer et nous émanciper, l’auteur se demande s’il ne faudrait pas délaisser le concept de ‘‘domination’’ pour analyser des relations sexuelles consenties. Lagasnerie, nous y reviendrons, et nous discuterons ce point, appelle à une « dépolitisation du désir ».
Si les différents énoncés de Geoffroy de Lagasnerie doivent pouvoir être prolongés, discutés, interrogés, critiqués, nous devons reconnaître qu’il a le mérite d’assumer le débat, fût-il polémique, sur un sujet à propos duquel il est de bon ton de louer une supposée ‘‘libération de la parole’’, en prenant soin, le plus souvent, de ne pas analyser ni interroger le contenu de ladite parole. L’auteur semble situer son travail dans ce que Foucault nommait la «criticabilité des choses, des institutions, des pratiques, des discours »[3]. Lagasnerie étudie des régimes de discours et des normes régissant des pratiques, et il tient à rappeler que ce sont à chaque fois, autant d’autres pratiques et d’autres discours, réels ou potentiels, qui sont occultés.
Des paroles qui en censurent d’autres.
Si le régime d’énonciation en vigueur est aujourd’hui qualifié de ‘‘libération de la parole’’, Geoffroy de Lagasnerie le rappelle, tout discours répond à des normes, et toute mise en avant de certaines prises de parole en invisibilise d’autres. Ainsi, à la suite de Bourdieu et Eribon, Lagasnerie appelle à se demander, lors de chaque mobilisation collective « Qui n’est pas là ? Qui ne parle pas ? Qui sont les voix absentes ? »[4]
Dans le cas des victimes de violences sexuelles, la réponse apportée par Lagasnerie se trouve au début du livre. La parole invisibilisée est celle de victimes qui décryptent les logiques de l’agression sexuelle mais critiquent « la logique pénale » et « des formes publiques de la vengeance collective ».[5] Parmi ces discours « raréfiés et invisibilisés », Lagasnerie situe en bonne place celui de Samantha Geimer, citée par Edouard Louis comme l’une des femmes les plus inspirantes pour lui [6]. L’actrice, violée par Roman Polanski lorsqu’elle avait 13 ans et qui, après avoir échangé avec le réalisateur, déclarait lui avoir pardonné, était allée jusqu’à affirmer que les actions du procureur ou des militantes féministes instrumentalisant son cas avaient été plus traumatisantes que les actes de Polanski lui-même. S’il n’est pas question, ni dans le livre de Geoffroy de Lagasnerie, ni dans cet article, de dicter une attitude à adopter aux personnes qui ont été victimes de viol, il convient de noter, comme l’observe Lagasnerie, que le ‘‘soutien aux victimes’’ qui s’est exprimé dans le cadre de ce qu’on appelle désormais l’affaire Polanski, n’accordait plus aucune écoute à celle qui avait été victime dès lors qu’elle dérogeait à ce qui était attendu d’elle.
Ainsi, en 2019, peu avant les protestations organisées dans le cadre de la cérémonie des Césars, Samantha Geimer, opposée par principe aux sanctions à perpétuité et refusant d’être figée éternellement dans une identité de victime, demandait aux militantes de ne pas mentionner son nom ou son histoire pour défendre des positions qui n’étaient pas les siennes. Cela n’empêchait pas plusieurs d’entre elles d’afficher peu après « Samantha : 13 ans » sur les murs de Paris, alors que l’intéressée déclarait que « demander à toutes les femmes de supporter le poids de leur agression, mais aussi de l’indignation de tout le monde pour l’éternité » relevait d’un « besoin égoïste de haine et de punition ». Au même moment, Adèle Haenel, dont la voix fut bien plus écoutée et relayée que celle de Samantha Geimer, déclarait en porte-parole autoproclamée des victimes de Polanski que le « distinguer c’est cracher au visage de toutes les victimes : ça veut dire ‘ce n’est pas si grave de violer des femmes’. »[7] Ainsi, comme l’analyse Lagasnerie, des groupes militants reproduisent parfois une volonté de punition et une dépossession des victimes dans la prise en charge des violences subies, autant de caractéristiques d’ordinaire imputées à la justice pénale et invoquées pour expliquer le faible nombre de dénonciation de viols, en comparaison du caractère massif du phénomène.[8]
Cette ignorance des demandes de Samantha Geimer, au nom de l’affirmation du besoin de punir, semble pourtant tourner le dos à de nombreux principes ‘‘progressistes’’. Aussi, l’indépendance des lieux culturels vis-à-vis de l’État, et la critique des peines à perpétuité ont historiquement fait partie de l’ADN des mouvements de gauche. Pourtant, les semaines précédant la cérémonie des Césars, les appels à la déprogrammation du film de Polanski, via des demandes d’intervention des élus, comme l’opposition à la prescription ou la défense d’un bannissement à vie, étaient apparus médiatiquement comme la seule position féministe audible.
Les questionnements sur le financement et la production des œuvres sont évidemment légitimes, et il convient de noter que des choix sont faits, que des propositions sont préférées à d’autres, et que de nombreux projets ne voient jamais le jour. Réaliser un film et être financé pour cela n’est donc pas un « droit ». Pour autant, nous observons que les interventions visant à empêcher les projections du film de Roman Polanski une fois réalisé et diffusé ne ciblaient pas Gaumont, producteur et diffuseur du film, mais le plus souvent des cinémas publics ou associatifs. Pour un certain nombre d’entre eux, tout en diffusant le film, les animateurs de ces lieux interrogeaient le lien entre la réception d’une œuvre et les considérations sur la biographie de l’artiste. Plusieurs d’entre eux organisaient aussi, suite aux projections, des discussions sur les violences sexuelles et le sexisme dans le milieu du cinéma. Là aussi, une position féministe en recouvrait une autre, et le fait de préciser les enjeux pour ne pas céder trop rapidement à l’envie de censure ou au désir de punir était soit ignoré soit amalgamé injustement à un soutien aux actes imputés au réalisateur.
Si nombre de médias se sont interrogés sur le désir de censure visant le film de Roman Polanski, peu ont questionné leur propre ignorance des autres positions féministes qui existaient. Ils ne se sont pas non plus appesantis sur le refus de prendre en compte la parole de Samantha Geimer, qui relève elle-aussi de l’effet de censure, au sens de Jacques Derrida : le fait qu’une instance, étatique ou non, rende difficile voire impossible qu’un discours soit mentionné ou discuté dans l’espace public.
Quand le procès de Mai 68 gagne la gauche.
Parmi les nombreux signes de la diabolisation de positions émancipatrices qui semblent avoir gagné la gauche ces dernières années dans le cadre de sa surenchère punitive contre les violences sexuelles, Geoffroy de Lagasnerie cite notamment la lecture rétrospective des discussions qui ont eu cours dans les années 70, et des positions exprimées dans la signature en 1977, par de nombreux écrivains, penseurs, artistes, médecins, ou militantes féministes, d’une « Lettre ouverte à la Commission de révision du Code pénal pour la révision de certains textes régissant les rapports entre adultes et mineurs ». Ce texte, comme le résume Lagasnerie, « proposait d’interroger un ensemble de délits qui encadraient alors la sexualité des mineurs et affirmait que ‘‘l’entière liberté des partenaires d’une relation sexuelle’’ devrait apparaître comme ‘‘la condition nécessaire et suffisante de la licéité de cette relation’’ »[9]
Comme l’évoque Lagasnerie, et comme nous étions quelques-uns à le rappeler quelques mois plus tôt lorsque Guy Hocquenghem et les militants du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) étaient décrits de façon anachronique comme des « apologistes de la pédocriminalité »[10], ces prises de position s’inscrivaient à la fois dans le contexte des mobilisations lycéennes de l’époque, dans celui de la lutte contre la répression des homosexuels (dont tout rapport d’un majeur avec un mineur de moins de 18 ans était illégal, alors même que la majorité sexuelle était de 15 ans), dans la critique de la psychiatrisation du désir, mais aussi dans les réflexions féministes critiquant l’autorité familiale sur les enfants et les adolescents. La lettre ouverte en question était notamment signée par Simone de Beauvoir, Christine Rochefort, Françoise d’Eaubonne, Hélène Cixous, et soutenue par des médecins liés au Planning familial.
Aujourd’hui, dans le contexte du durcissement des lois régissant les rapports entre majeurs et mineurs, et d’une proximité grandissante entre certaines organisations féministes et des associations de protection de l’enfance, pour certaines situées très à droite [11], Lagasnerie explique que ces positions exprimées dans les années 70 sont interprétées selon « un schéma fascisant de l’élite culturelle comme groupe dégénéré, sans morale et aux mœurs dépravées » qui « a façonné nombre de discours ces dernières années, à droite comme à gauche – si tant est que ce soit alors encore la gauche ».[12]
Pourtant, poursuit Geoffroy de Lagasnerie, les expressions des années 70, qui visaient à libérer les mineurs des surveillances familiales et institutionnelles, ne sont probablement pas moins féministes que les positions de celles qui aujourd’hui appellerait à envoyer Brigitte Macron en prison pour sa relation avec l’un de ses lycéens qui deviendra président de la République. Les militantes des années 70, qui soutenaient Gabrielle Russier, jeune professeure libertaire incarcérée pour avoir entretenu en mai 68 une relation avec l’un de ses élèves âgé de 16 ans, n’étaient pas non plus moins féministes que celles des militantes d’aujourd’hui, qui qualifieraient la professeure de ‘‘pédocriminelle’’ et se situeraient du côté des magistrats et des psychiatres dont les décisions ont fini par la pousser au suicide.[13]
Les propos réactionnaires tenus sous couvert de protection de l’enfance et de lutte contre les violences sexuelles sont nombreux. Lagasnerie cite notamment la signature par une élue EELV d’une « pétition qui mettait en question l’issue judiciaire de l’affaire d’Outreau (où treize accusés à la suite de dénonciations fantaisistes ont été innocentés de viols sur enfants après des années de prison et dont le sort avait suscité à juste titre une énorme indignation publique) en affirmant qu’elle avait favorisé l’impunité des pédo-criminels, comme s’il était possible de regretter que des innocents soient acquittés parce qu’une telle décision enverrait un mauvais signal à de futures victimes potentielles », ou encore le slogan du groupe Paris Queer Antifa, qui lors de la dernière marche des fiertés appelait à « brûler violeurs et assassins », ce « qui ressemble tout de même plus à un slogan d’extrême-droite qu’à une démarche animée par les valeurs de l’antifascisme et l’éthique queer… » [14]
À ces exemples de rhétorique réactionnaire qui infuse à gauche sous couvert de lutte contre les violences sexuelles, nous pourrions ajouter les discours qui, plutôt que de chercher à penser structurellement la question des violences (notamment sexuelles) faites aux enfants (qui sont le plus souvent exercées par des membres de la famille ou des proches), propagent les fantasmes complotistes autour d’une élite pédocriminelle hors sol, dépravée et malfaisante. Ce discours est par exemple présent dans la tribune écrite par Virginie Despentes louant la réaction d’Adèle Haenel lors de la cérémonie des Césars, qui fustigeait « les plus riches » et « leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu’ils violent » [15].
Nous pouvons aussi mentionner la façon dont Rokhaya Diallo a récemment emboîté le pas à Karl Zéro, pourtant connu pour ses documentaires et ses revues complotistes à propos des attentats du 11 septembre 2001 selon lui organisés par la CIA, ou sur les tueurs et violeurs en série qui ne seraient que des exécutants chargés d’enlever des enfants pour le bénéfice des différentes familles royales et autres puissants de ce monde [16]. Sur le plateau de Balance Ton Post, la militante féministe et antiraciste affirmait notamment face au réalisateur venu présenter son film sur les « réseaux pédocriminels » (notamment francs-maçons) que la pédophilie était dans notre société « une norme sociale très très importante » avant de remercier Karl Zéro d’avoir « bien montré (…) la proximité de certaines personnes impliquées dans des viols d’enfants avec le Conseil constitutionnel » [17].
Alors qu’il serait souhaitable de prolonger les réflexions portant sur la domination des enfants par les adultes, d’analyser les représentations des enfants comme êtres faibles et obéissants qui favorisent leur fétichisation, mais aussi de réfléchir aux formes de reconnaissance des torts causés ou aux manières d’aider à la guérison des traumatismes, certaines figures médiatiques de la gauche préfèrent, quand elles ne se bornent pas à appeler à la vengeance, se vautrer dans le complotisme bas de gamme.
Et comme s’il fallait confirmer le regard porté par Lagasnerie dans Mon corps, ce désir, cette loi sur l’incapacité d’une partie de la gauche à remettre en cause le primat punitif et vengeur dès qu’il est question des violences sexuelles, notons la réaction de Judith Duportail, journaliste et animatrice d’un podcast intitulé On peut plus rien dire, se donnant pour but « de débattre autrement. Sans clashs, sans caricatures et sans pensées toutes faites ». Récemment, semblant oublier les principes fièrement affichés, la journaliste réagissait sur Instagram au livre de Lagasnerie en tentant, à partir de quelques citations tronquées et de commentaires les extrapolant, de faire croire que son auteur y tenait un discours masculiniste, qu’il légitimait le harcèlement sexuel ou minimisait le viol. En conclusion, dans une envolée plus proche du discours de campagne d’un(e) candidat(e) de droite que des principes portés par les mouvements d’émancipation dont elle se réclame, Judith Duportail assénait que le discours de Lagasnerie était l’incarnation « des discours post soixante-huitards qu’on s’échine à dénoncer » …
Quelques centaines de retweets plus tard, Daniel Schneidermann, journaliste d’habitude plus enclin à déceler les emballements et à pointer le manque de rigueur de ses confrères, bâclait pour Libération un article ne citant que les extraits de l’ouvrage diffusés les jours précédents sur les réseaux sociaux, avant de se demander si l’on ne pouvait pas déceler « dans [l]a prise de position [de Geoffroy de Lagasnerie] des relents de la permissivité soixante-huitarde en matière de pédocriminalité, aujourd’hui unanimement rejetée dans l’enfer de Mai 68. » [18]
En 1986, dans les dernières pages de leur ouvrage intitulé L’Âme atomique [19], René Schérer et Guy Hocquenghem notaient déjà que le faux souvenir d’une libération sexuelle supposément totale et sans limite, qui aurait eu lieu pendant et après mai 68, était l’un des éléments du discours réactionnaire. Ils considéraient que le développement de ce mythe était à la fois favorisé par le reflux des mouvements d’émancipation dans les années 80 et par la constitution de la sexualité comme danger. La gauche s’est historiquement distinguée par sa défense de l’héritage de mai 68, et notamment la façon dont il fut possible à la suite de ce mouvement, de mettre à jour les différents systèmes de domination. Elle s’est aussi souvent fait remarquer par sa critique des discours sécuritaires, par son rejet du populisme pénal et ses appels à la nuance. Cependant, plusieurs décennies de procès en laxisme, conjugués à diverses paniques morales et à une représentation tronquée des violences sexuelles faites aux enfants (la contrainte découlant, rappelons-le, bien plus de l’autorité excessive exercée dans les familles, dans les églises ou dans les écoles que d’une trop grande liberté accordée aux enfants ou aux adolescents), semblent avoir, au moins pour une partie d’entre elles, aujourd’hui eu raison de ses principes.
Le désir de punir.
Alors que l’analyse des inégalités et des causes des violences sexistes et sexuelles nous aide à comprendre les structures sociales et les responsabilités collectives, le corollaire du désir de punir qui s’exprime face aux actes répréhensibles est la focalisation sur les seuls individus coupables, ce qui, comme le note Geoffroy de Lagasnerie, nous place face à un paradoxe. D’une part, « le discours sur les violences sexuelles s’articule de plus en plus à une sociologie des structures qui favorisent ou organisent le viol ou l’agression sexuelle, ce qui conduit au développement de notions comme celles de ‘‘culture du viol’’ ou de ‘‘féminicide’’ qui permettent d’objectiver à la fois les causes de la violence sexiste ou sexuelle et ses effets sur les femmes ou les minorités sexuelles en termes de subjectivation dans leur rapport à l’espace public domestique, professionnel … », d’autre part, « la réponse aux phénomènes ainsi objectivés et même en fait leur simple caractérisation s’opèrent à travers des catégories pénales, psychologiques ou individualisantes qui sont en inadéquation avec ce paradigme. La sociologie est utilisée pour penser les rapports de domination mais complètement oubliée lorsqu’il s’agit d’appréhender les actes et les subjectivités que produisent ces rapports de domination ». [20]
Dans ce cadre, si Lagasnerie considère comme tout à fait compréhensible qu’une partie des personnes victimes de violences sexuelles ressentent spontanément, à titre individuel, des envies de punition, il considère comme intellectuellement et politiquement inopérante (voire tout bonnement réactionnaire) la solution qui consiste à collectivement formuler des revendications qui induisent le renforcement de l’état pénal et la construction de nouvelles prisons. Il situe ainsi ses pas dans ceux des théoriciens de l’abolitionnisme pénal, qui, comme J.M Moore aux Etats-Unis, ou la sociologue et militante féministe anticarcérale Gwenola Ricordeau en France [21], critiquent le fait que la majorité des ressources aujourd’hui dépensées dans la lutte contre les violences sexuelles visent à infliger des souffrances aux coupables plutôt qu’à soulager celles des victimes ou à mettre en place des politiques sociales et d’éducation visant l’égalité et la fin des violences de genre [22].
Aussi, Lagasnerie fait référence à la Ligue du droit des femmes, de Simone de Beauvoir, qui écrivait dans son manifeste que « l’emprisonnement de l’agresseur (…) permet sans doute à notre société de se débarrasser d’un problème qu’elle a créé elle-même en fabriquant des violeurs mais il ne s’agit que d’un leurre. Si les femmes exigent que le viol soit dénoncé publiquement en tant que crime, c’est parce qu’elles souhaitent que tous, hommes et femmes, prennent conscience de la violence sexiste dans notre société. Elles ne veulent plus apparaître comme des victimes, c’est-à-dire comme des sujets passifs, mais comme des êtres ayant une dignité sexuelle et qu’elles entendent faire respecter et exprimer clairement en renonçant à toute vengeance inutile et notamment à l’emprisonnement ». Pour faire valoir ce principe, les militantes étaient allées jusqu’à manifester dans les tribunaux lors de procès pour viol en criant « La prison n’est pas la solution ! » ou encore « Libérez l’accusé ! » [23]
En outre, Lagasnerie se demande si l’articulation d’« une politique de la sexualité à une dénonciation des structures sociales qui façonnent les subjectivés violentes » est compatible avec « l’appareil moral que tend à former le journalisme contemporain à travers la publication d’enquêtes ciblées sur des noms propres ».[24] En complément de son propos, nous pouvons ajouter que la focalisation sur les noms propres dans les discours médiatiques, en plus de détourner de l’analyse des causes en créant des monstres qu’il est possible de mettre à distance, va parfois même jusqu’à produire, dans l’esprit du public, un oubli ou une méconnaissance des faits dont les personnes sont accusées. Ces faits, qui vont du viol à la blague déplacée, peuvent avoir le même effet sur une réputation dès lors qu’un nom est mentionné dans un certain contexte.
Récemment, un collectif de femmes liées au milieu musical punk-métal a analysé d’un point de vue féministe la façon dont des accusations de sexisme furent alignées, sans nuance ni graduation, dans un article publié par Médiapart [25], ainsi que les effets délétères d’une telle publication. Dans une longue tribune écrite collectivement [26], elles y dénoncent notamment « la mort sociale des individus visés (perte d’emploi, exclusion de la communauté, du cercle social et familial, dépression) » et constatent que « cette exclusion opère bien souvent sans distinction de degrés quant à la gravité des accusations. »
Aussi, écrivent-elles à propos de la publication de Mediapart, « cet article tend plutôt à confondre différents niveaux de gravité, mettant sur le même plan viol, agressions sexuelles, relations affectives et/ou sexuelles complexes, paroles sexistes, entre-soi masculin. (…) On n’est pas là ou le même à 15 ans, à 25 ans ou à 40 ans. Et on n’a pas la même sexualité non plus. Tous les enjeux précédemment évoqués peuvent nous amener à revisiter, parfois a posteriori, une expérience affective ou sexuelle, et à y repérer des relations complexes, des vécus douloureux, des pratiques non désirées, des contraintes, des déceptions. Pour autant cela ne veut pas dire que là ou le partenaire était intentionnellement malveillant·e, ou qu’iel cherchait à heurter. En dehors du cadre des violences définies par la loi, la sexualité peut impliquer des mauvaises expériences, des ratés, des regrets, des conflits, des blessures ».
Il y a peu de doute sur l’injustice vécue par certains des accusés comme sur le caractère éthiquement discutable d’un processus qui consiste à aligner les noms de personnes qu’il s’agit de diaboliser, sans établir des niveaux de gravités dans les actes reprochés. Aussi, la tribune mentionne la perte de confiance de plusieurs des personnes qui ont témoigné et n’ont pas reconnu leurs propos dans l’article.
Enfin, les rédactrices de la tribune font remarquer que la création de boucs-émissaires et l’injonction à prendre position pour sauver sa réputation sont absolument contre-productives si l’on considère qu’il est nécessaire d’entamer une réflexion collective sur les rapports de pouvoir : « le positionnement des groupes ou des individu·e·s nous a questionnées sur les intentions de fond de chacun·e. Des dizaines voire des centaines de personnes, plus ou moins proches de notre courant musical et/ou d’individu·e·s en faisant partie, ont relayé l’article de Mediapart sur les réseaux, avouant parfois ne pas l’avoir lu. Quand on interroge certain·e·s à ce sujet, iels expliquent qu’iels s’y sont senti·e·s obligé·e·s, afin de ne pas être assimilé·e·s aux faits évoqués dans l’article. René Girard évoque ce phénomène collectif récurrent dans sa théorie du bouc émissaire : on en jette un en pâture, afin qu’il paye pour tout le monde, que les projecteurs soient fixés sur lui et que son sacrifice lave les péchés de tous, la question de la véracité de sa culpabilité semblant presque secondaire. Par là même, on cultive une atmosphère lourde et délétère avec la menace : « attention, préparez-vous, il y aura d’autres accusés ! ». Cela a également permis à certains groupes ou individu·e·s de se positionner et de se rendre visibles dans un mécanisme d’autopromotion ou de dédouanement, sans remise en question de leur propre comportement. »
Par ailleurs, des enquêtes médiatiques portant sur des personnes accusées dans des affaires de viol ou d’agression sexuelle peuvent compiler et amalgamer des faits disparates, allant de graves accusations à des faits qui seraient vus comme anecdotiques s’ils concernaient une autre personne. Marine Turchi, journaliste au pôle enquêtes de Mediapart, et autrice de nombreux papiers mettant en cause des personnalités publiques pour leur comportement vis-à-vis des femmes, expliquait récemment dans une émission d’Arrêts sur images qu’il s’agit souvent, en compilant des faits disparates, de citer « plein de témoignages » « qui se recoupent » et permettraient de faire apparaître « un mode opératoire ». [27]
Pourtant, comme le rappelle Geoffroy de Lagasnerie, l’essentialisme est critiqué de longue date par nombre d’avocats pénalistes, qui mettent en cause, y compris dans le cas des tueurs en série, des « constructions symboliques des relations ontologiques entre une personne et son comportement » [28]. En plus de noter dans les propos de Marine Turchi la réalisation d’enquêtes à charge, on peut se demander si cette façon de relier entre eux des faits qui ont lieu à des années voire des décennies d’écart, et qui sont recomposés et réinterprétés à la lumière d’une accusation récente, permet réellement de dresser le portrait psychologique d’une personne.
Le risque de ces interprétations est de se situer à la frontière de l’anthropologie négative du libéralisme, décrivant l’être humain comme cohérent, calculateur, poursuivant son intérêt et toujours conscient de ses actes, et de la psychiatrie qui s’exprime dans les tribunaux et essentialise des individus pour mieux les mettre à distance. Cela conduit le plus souvent à finalement ne rien comprendre des psychologies des personnes, et surtout de ce qui les produit.
De plus, amalgamer les différents actes des personnes mises en cause, dont certains n’ont que peu de rapports avec des fait répréhensibles, fait courir le risque de passer de la dénonciation de rapports contraints, établis ou à prouver, à la constitution, par l’insinuation et la description d’une ambiance, d’un nouvel ordre moral. Parfois, dans ces articles, la frontière entre la lutte contre les violences sexuelles et la police des mœurs peut devenir poreuse. Mediapart a par exemple publié un article intitulé Violences sexuelles : révélations sur le comportement de Juan Branco [29] après l’ouverture d’une enquête pour viol le visant [30]. Dans cet article, censé ajouter d’autres accusations contre Juan Branco, était décrit un geste déplacé qui pourrait recevoir la qualification d’agression sexuelle, geste que l’intéressé nie avoir commis, mais aussi des fantasmes exprimés dans une correspondance privée dans le cadre d’une relation consentie, ou le fait d’avoir reçu des messages d’étudiantes encore admiratives de celui qui avait été leur professeur de Terminale. En outre, la journaliste citait les propos d’une femme de la haute bourgeoisie qui désapprouvait la relation entretenue par sa fille avec celui qui est connu comme l’ancien avocat de Jean-Luc Mélenchon et un militant proche des Gilets jaunes …
Quelques mois plus tôt, Mediapart titrait Affaire Duhamel : d’autres éléments pourraient intéresser la justice. [31] Aux faits d’inceste dénoncés par Camille Kouchner et qui seront plus tard reconnus par Olivier Duhamel, étaient amalgamés, sans qu’on perçoive très bien en quoi de tels actes seraient répréhensibles, l’invitation faite aux enfants à discuter politique avec les adultes de la famille, ou encore le fait que les enfants pouvaient avoir connaissance de la multiplicité des amours de leurs parents…
Plutôt que de focaliser sur le viol, ou de chercher à analyser les structures sociales qui le rendent possible, Médiapart et une partie de la gauche préfèrent souvent décrire des ambiances ou insister sur le danger inhérent à tel ou tel individu. L’émergence de la figure de l’individu dangereux, et par ricochet le risque que les violences sexuelles ne soient plus abordées comme des faits précis mais que leur évocation pousse à considérer le sexe comme un danger qui rôde, était déjà notée en 1978 par Michel Foucault. Dans le cadre d’un entretien donné à France Culture [32], il expliquait que cette représentation du danger véhiculée par les médias avait notamment été développée dans les tribunaux par les discours des experts psychiatres : « Autrefois, les lois interdisaient un certain nombre d’actes, actes d’ailleurs d’autant plus nombreux qu’on n’arrivait pas très bien à savoir ce qu’ils étaient, mais enfin c’était bien à des actes que la loi s’en prenait. On condamnait des formes de conduite. Maintenant, ce qu’on est en train de définir, et ce qui, par conséquent, va se trouver fondé par l’intervention et de la loi, et du juge, et du médecin, ce sont des individus dangereux. On va avoir une société de dangers, avec, d’un côté, ceux qui sont mis en danger et, d’un autre côté, ceux qui sont porteurs de danger. Et la sexualité ne sera plus une conduite avec certaines interdictions précises ; mais la sexualité, ça va devenir une espèce de danger qui rôde, une sorte de fantôme omniprésent, fantôme qui va se jouer entre hommes et femmes, entre enfants et adultes, et éventuellement entre adultes entre eux, etc. »
Du lynchage en milieu militant.
De cette représentation du danger, et du caractère toujours plus vague des accusations, découlent évidemment de nombreuses rumeurs, lesquelles ne visent pas seulement des personnalités publiques. Nous avons mentionné plus haut les logiques de boucs-émissaires qui ont fait suite à la publication de l’article de Mediapart à propos des violences sexistes et sexuelles dans le milieu punk-métal. Cette sphère n’est évidemment pas la seule à être concernée par de telles logiques. Comme de nombreuses personnes, j’ai par exemple pu assister ou me faire raconter divers moments de justice populaire organisés dans des milieux militants dits « anticapitalistes », « libertaires » ou « autonomes », qui servaient souvent de prétexte à des règlements de compte entre groupuscules.
Là non plus, la gradation dans les actes reprochés n’était pas toujours présente (des listes d’« agresseurs » pouvaient circuler, alignant parfois sans plus de précision, les noms d’un militant accusé de viol et d’un autre à qui il était reproché, sur un mode vague, d’avoir manqué d’empathie lors d’un rapport consenti). Souvent, au nom de la protection des victimes, la personne mise en cause n’était pas informée de ce dont elle était accusée, et il arrivait même que ceux qui œuvraient au bannissement ne le sachent pas eux-mêmes, et qu’ils se basent sur la seule rumeur publique. Plusieurs d’entre nous ont aussi eu l’occasion d’entendre le même récit, agrémenté des mêmes détails à propos de deux personnes différentes, ou d’entendre des « victimes » désignées témoigner en faveur de leur « agresseur » supposé pour démentir les rumeurs. À chaque fois que j’ai évoqué ces faits auprès d’amis vivant dans d’autres villes ou fréquentant d’autres milieux, ils m’ont fait part de cas similaires. Enfin, plusieurs de mes amies me parlant d’un viol ou d’une agression subie m’ont dit être inquiètes à l’idée que leur histoire puisse être connue et instrumentalisée. Afin de ne pas se retrouver figées dans le statut de victime passive par des groupes militants instrumentalisant cette figure, j’ai fréquemment entendu des femmes dire qu’elles se refusaient à parler publiquement de leur vécu.
Il y a un an et demi, à Lyon, face à l’inflation de ces pratiques, un rassemblement de collectifs divers, regroupant les animateurs d’une caisse de solidarité permettant de payer des frais de justices, des responsables d’une permanence d’accueil des personnes sans papiers, des militantes féministes ou anti-autoritaires ou encore les gérants de bars associatifs, LGBT friendly et féministes, s’est constitué pour critiquer ces comportements. Ils y écrivent notamment : « Nous voyons aujourd’hui des personnes pratiquer au sein de nos luttes diverses formes de harcèlement (téléphonique, tags nominatifs, agressions physiques et verbales, menaces de mort, attaques de lieux…), fichage de personnes (photos, films, « blacklists »…) se fondant sur des histoires déformées, manipulées, ou complètement inventées ; cet acharnement cinglant pousse à l’isolement et à l’ostracisation. » [33]
Et puisqu’il ne s’agit pas seulement de dénoncer ces pratiques, mais, lorsque les faits sont avérés, de penser les formes de la reconnaissance des actes, de leur réparation et du changement de leurs auteurs, les signataires précisent qu’ils dénoncent aussi ces pratiques parce qu’elles empêchent toute forme de réparation : « Si les personnes tentent des excuses c’est de la mauvaise foi, si elles ne disent rien c’est reconnaître leurs actes et si elles se font aider, leurs soutiens deviennent complices ou coupables. (…) Pour nous, la dénonciation publique peut permettre de libérer la parole de victimes dont les voix portent moins que celle de leurs agresseur.euse.s. En revanche, nous ne pouvons la voir que comme une étape et nous refusons catégoriquement que ces dénonciations deviennent le point de départ d’une justice punitive d’abattage, dont l’efficacité dépend forcément d’un rapport de pouvoir favorable, ou encore un moyen de discréditer des personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. »
« On te croit ».
Parmi les dogmes militants, l’interdiction de remettre en cause ce qui est désigné comme la « parole des victimes », c’est-à-dire en pratique l’obligation de croire absolument toute accusation, figure en bonne place. Nous avons pourtant vu, par exemple dans le cas de Samantha Geimer, que la parole d’une femme qui a été victime peut être rapidement ignorée dès lors qu’elle ne correspond plus aux attendus. Mais c’est aussi ce dogme en tant que tel qui devrait être interrogé.
Les militant(e)s défendant le fait de considérer chaque accusation comme absolument vraie, et se targuant d’accéder aux demandes de la personne qui la formule (par exemple de relais public et nominatif d’une accusation, ou d’exclusion de l’accusé de tous les espaces publics où ils pourront le croiser), le font au nom du fait qu’une personne se déclarant victime n’aurait « aucun intérêt à mentir ». C’est par exemple ce qui est exprimé par Adèle Haenel dans le New York Times : « On doit croire toutes les femmes qui parlent. (…) On n’a rien à gagner à se dire victime et les conséquences sur la vie privée sont très négatives ». [34]
La parole doit évidemment être écoutée avec sérieux et bienveillance, et les mis en cause doivent être confrontés aux accusations qui les visent. Il m’est arrivé de participer à de tels processus. Aussi, lorsque les personnes sont amenées à fréquenter les mêmes espaces, des solutions doivent être trouvées pour éviter que, comme cela est trop souvent le cas, ce soient les plaignantes qui quittent les lieux ou les structures qu’elles fréquentent.
Cependant, le principe de « croire toutes les femmes qui parlent », au nom du fait qu’elles n’auraient pas d’intérêt à mentir, est évidemment paradoxal, dans la mesure où il crée, de fait, un intérêt à se dire victime pour être écoutée. Ce paradoxe est accentué lorsque certains collectifs militants défendent le principe d’accéder à toutes les demandes de qui se dit victime, indépendamment de la gravité des faits reprochés ou et sans tenter de vérifier les accusations.
Ces dernières années, nombre de publications ont par exemple évoqué les personnes qui se sont frauduleusement fait passer pour des victimes des attentats du Bataclan, soit par intérêt financier, soit simplement pour rejoindre une communauté ou bénéficier d’un espace d’écoute. Il semble difficile d’imaginer que la possibilité du mensonge s’arrête aux frontières des relations sentimentales et sexuelles. Aussi, nous prenons peu de risque à supposer que ces personnes se tourneront plus facilement vers des groupes précisant qu’ils « croient toujours » ceux qui se disent victimes ou, pour reprendre les mots d’Adèle Haenel, « toutes les femmes qui parlent ».
Les comportements minoritaires de dénonciation d’agressions imaginaires, parfois définis comme pathologiques et la plupart du temps signes d’une souffrance, peuvent d’ailleurs être vus comme des occasions de développer notre empathie et d’aménager des espaces de parole. Il s’agit cependant de ne pas amalgamer écoute et prise en compte de la souffrance d’une part, créance totale dans chaque énoncé et désignation d’un coupable d’autre part.
Récemment, une tribune liée au #Metoopolitique affirmait : « si les revendications et témoignages des différents mouvements #MeToo étaient entendus (…) On cesserait de remettre en doute notre parole alors que dans les faits les fausses accusations représentent 2 % à 10 % des cas». [35] Les signataires revendiquant la mise à l’écart de tous les mis en cause, on peut s’étonner d’un argument se basant sur le pourcentage d’injustice que l’on serait prêt à tolérer. Aussi, il convient de remarquer que tout en dénonçant une institution judiciaire à qui il est reproché de « remettre en doute la parole » des plaignantes, les signataires citent à l’appui de leur démonstration les chiffres fournis par cette même institution. La signification de ces chiffres est cependant extrapolée. Cette statistique ne signifie pas qu’entre 90 et 98 % des dénonciations seraient en tout point véridiques, mais que, dans les cas où des plaintes ont été déposées, il a été démontré dans 2 à 10 % des cas que l’accusation reposait sur un mensonge.Dans la majorité des situations, deux versions s’affrontent et il est impossible pour l’institution judiciaire de trancher avec certitude.
Dans la plupart des cas, les infractions sexuelles étant commises en l’absence de témoins et laissant peu de preuves matérielles, il est compréhensible que, dans le cadre de la justice pénale, le doute profite aux accusés. A l’inverse, dans un système qui ne serait pas centré sur la sanction du coupable mais qui reposerait sur la reconnaissance, la réparation des torts causés, l’aide à la reconstruction des victimes et le changement des auteurs de violence, l’accusé aurait probablement plus intérêt à s’exprimer et reconnaître ses torts.
Par ailleurs, si les fausses accusations consciemment élaborées dans le seul but de nuire sont rares, un phénomène plus courant, la réinterprétation par des individus du consentement donné précédemment, doit pouvoir être pris en compte. Nous avons cité précédemment le texte écrit par des femmes liées à la scène punk-métal qui, à la suite de l’article de Mediapart amalgamant des situations très différentes, mentionnaient la distinction à établir entre la gêne ou la souffrance ressentie et le fait que notre partenaire serait objectivement auteur d’une agression.
Dans son ouvrage Geoffroy de Lagasnerie insiste sur la complexité des interactions sexuelles et des situations « qui peuvent aller du malentendu à l’auto-contrainte, qui peuvent naviguer entre la violence et l’habitude, le oui et le non, le dit et le non-dit, le plaisir et l’ennui » [36]. La notion de zone grise peut nous servir à appréhender ces situations, à reconnaître la gêne et la souffrance sans désigner un coupable ou réifier un acte dans la catégorie de l’agression ou de l’abus. Il faut cependant savoir accueillir toutes les implications de cette notion. : « Le caractère problématique et inquiétant que peut prendre la politique de la sexualité quand elle s’inscrit dans un doublet sociologico-répressif apparaît (…) lorsqu’elle développe un usage descriptif d’une notion comme celle de zone grise mais qu’au lieu d’aller au bout de sa signification éthique elle ressaisit les actions qui s’y sont produites à travers une optique de l’extension de la logique de la punition individuelle et de l’identification d’un responsable – contre laquelle cette notion a pourtant été forgée … – en recodant tout un ensemble d’interactions protéiformes inscrites dans la logique de la pratique au prisme d’une catégorie comme celle d’abus (avec un abuseur et un abusé). » [37]
Par ailleurs, pour aider à penser la façon dont on peut réinterpréter une relation et se vivre comme victime d’un abus en y étant encouragé par certain cadres contemporains, Geoffroy de Lagasnerie mentionne sa rencontre avec Didier Eribon, de vingt-huit ans son aîné, et la façon dont il aurait pu réécrire ses souvenirs si la relation n’avait pas duré. [38] : « Alors que se multiplient aujourd’hui des prises de parole sur l’emprise, la différence d’âge et de statut dans les relations, l’abus, je voudrais conclure en racontant ce qui s’est passé lors de la naissance de la relation qui me lie avec Didier Eribon depuis plus de vingt ans : lorsque j’ai rencontré Didier, j’étais très jeune, nous avions une grande différence d’âge – nous l’avons toujours puisque cela ne change pas avec le temps – et il est certain que mon désir pour lui, le désir de coucher avec lui et d’avoir une relation avec lui, s’enracinait aussi dans le fait qu’il était ce qu’il était : son statut, la découverte à travers lui de la vie culturelle et intellectuelle, sa renommée, la fascination qu’exerçait sur moi la figure de l’auteur qui publie. Sa beauté et son attraction sexuelle étaient liées, comme dit Deleuze, à tout le monde qu’il portait en lui et qui se dépliait à travers lui. Lorsque ma mère a découvert cette relation, une crise violente a éclaté, avec des cris, des insultes (c’est aujourd’hui heureusement totalement apaisé) et, si j’avais eu deux ans de moins, si j’avais été mineur, elle aurait très certainement porté plainte. Ce que ma mère percevait à ce moment-là comme une emprise, je l’ai vécu comme un contre-pouvoir libérateur contre la famille, l’école, l’université – tous ces cadres qui exercent aussi leur emprise sans qu’on les mette jamais en question – et je crois que, grâce à la relation avec Didier, j’ai eu la chance d’avoir une vie beaucoup plus libre que celle que j’aurais eue si je ne l’avais pas rencontré.
Didier et moi sommes toujours amoureux et en couple. Mais les choses auraient pu se passer autrement. La vie pourrait avoir été différente. Didier aurait très bien pu me quitter, cesser d’être amoureux de moi ou rencontrer un autre garçon. Et peut-être aurais-je pu alors, quelques années plus tard, à cause de certains cadres contemporains, reconfigurer mon expérience, réécrire mon âme comme dit Ian Hacking et dénoncer Didier en disant que je me rends compte désormais qu’il a utilisé son prestige et son pouvoir pour me séduire et abuser de moi. J’aurais pu publier un tweet en disant : je me rends compte aujourd’hui que j’ai été abusé. Ou même : je me rends compte aujourd’hui que j’ai été violé. Et le pire est que j’aurais probablement été cru, que certains auraient pu m’écrire « je te crois » au point que j’aurais fini par y croire moi-même, et que Didier aurait alors été maltraité sur les réseaux voire publiquement dénoncé, que peut-être il aurait dû déménager, n’aurait plus été publié ou invité aux Etats-Unis. Peut-être y aurait-il eu des manifestants devant chez lui, des affiches collées pour le dénoncer.
Cette simple éventualité montre le caractère problématique de certaines formes de prises de parole contemporaines sur la sexualité qui tendent de plus en plus à être soumises à des opérations subjectives et rétrospectives d’interprétation, de reconstruction a posteriori de ressenti.
Nous pouvons tous faire des choses que nous regrettons au cours de nos vies, nous changeons d’avis, d’impression, de préférence … (…) Un problème politique apparaît lorsque cette reconstruction a posteriori a tendance à être promue comme étant non pas une interprétation a posteriori du passé mais comme une expression de la vérité du moment passé, dont c’est l’expérience alors ressentie qui aurait été mensongère » [39].
Outre la réflexion sur la façon dont deux vérités, celle du moment vécu et celle de l’analyse a posteriori peuvent soit se compléter soit s’opposer, l’intérêt de ce passage se situe notamment dans la description de réactions militantes bassement vengeresses. Selon ce qui est ici décrit par Lagasnerie, et fait écho à plusieurs affaires récentes [40], plus d’énergie semble dépensée pour harceler un coupable désigné que pour soutenir une personne en souffrance.
Aussi, souvent, dans les discours militants, les personnes qui ont subi des violences (ou qui se déclarent victimes en réinterprétant une relation passée) ne sont plus définies que par un statut de victime, et poussées à se percevoir uniquement par des événements subis. Cette essentialisation, à laquelle s’ajoute le fait de voir son destin relié éternellement à son agresseur réel ou supposé par les appels à la vengeance, ne fait qu’accroître le mal-être.
En outre, lorsqu’elles prennent la parole publiquement, certaines personnes se déclarant victimes reçoivent des centaines de messages leur rappelant leur traumatisme ou les appelant à porter sur leurs épaules le poids de l’ensemble des autres violences sexuelles. Ces comportements, favorisés par la distance liée à la numérisation des échanges, ignorent la violence produite par la rencontre entre les centaines de messages reçus, et la solitude éprouvée dans une chambre étudiante. Lorsqu’à cela s‘ajoutent des difficultés familiales, économiques, universitaires ou liées aux confinements successifs, nous l’avons malheureusement constaté, la souffrance peut conduire au suicide.
Dans ce cas, plutôt que de reproduire les mêmes mécanismes en appelant au lynchage des coupables désignés, le devoir des milieux militants devrait être d’entamer une réflexion sur la façon d’accueillir les paroles souffrantes sans accentuer les douleurs, et sans chercher automatiquement des monstres à châtier.
Exceptionnalisme sexuel, emprise et (dé)politisation du désir.
Geoffroy de Lagasnerie se méfie de la notion d’ « emprise ». En effet, si nous vivons dans un monde social fait d’inégalités et de différences de pouvoir, il est logique de constater que le désir est construit dans et par ce cadre. Il note toutefois, comme sur d’autre sujets, un paradoxe entre d’une part le recours à la sociologie pour constater les inégalités et analyser des structures, et d’autre part l’usage de la notion d’« emprise », qui soumet les rapports sociaux à « une analyse internaliste et individualisante ».[41]
Lagasnerie insiste sur la difficulté d’évaluer le consentement autrement que minimalement, au présent, en tant qu’absence de contrainte. On peut en effet, à l’appui de son propos, affirmer qu’aucune relation n’est exempte de rapports de pouvoir, et que cela ne nous permet pas pour autant de réinterpréter toutes nos interactions comme une ‘‘emprise’’, des ‘‘abus’’, voire des ‘‘viols’’. Cependant, pour nuancer, précisons que la contrainte n’est pas seulement physique ou liée à une menace, et qu’elle peut relever de la prise de pouvoir globale d’un individu sur un autre, favorisée par un rapport social inégalitaire. On pourrait aussi se demander, dans ces cas limites, par exemple la relation avec Gabriel Matzneff décrite par Vanessa Springora dans Le Consentement [42], où est la frontière, parfois poreuse, entre le simple changement de regard sur son vécu, et la mise à jour objective d’un système de contrainte.
À la suite de la publication de l’ouvrage de Vanessa Springora, la réaction principale a consisté à affirmer sur tous les tons qu’on ne peut pas être consentant à une relation avec un majeur avant d’avoir atteint 15 ans. Le propos de Springora est cependant plus précis et subtile, puisqu’elle se demande au contraire « comment admettre qu’on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant ». Aussi, Springora ne généralise pas ses observations à toutes les relations que des adolescent(e)s ont pu entretenir avec des adultes. Elle écrit au contraire de la façon la plus explicite qui soit qu’elle est prête à considérer qu’il peut exister une relation exceptionnelle entre un adolescent(e) et une personne plus âgée [43]. A propos de son histoire, elle décrit, dans un cadre donné, de façon précise et nuancée, sans généraliser ni réifier des catégories d’âge, des mécanismes de pouvoir, qui recoupent d’ailleurs ceux décrits par Matzneff lui-même dans ses ouvrages.[44]
On pourrait objecter à Geoffroy de Lagasnerie, qui fait du consentement et de l’absence de contrainte la clé de voûte de son analyse, que le consentement est une notion contractuelle et que, dans un cadre inégalitaire, le contrat peut aussi être ce qui entérine les inégalités. Il suffit par exemple d’avoir signé un contrat de travail, défini comme un lien de subordination, pour s’en apercevoir. Cependant, Lagasnerie remet préventivement en cause cette analogie. En effet, alors que dans le cas du travail, l’activité peut être vécue avec plaisir tout en relevant objectivement de l’exploitation et de la violence infligée aux corps, sans que les travailleurs en aient toujours conscience, dans le cas de la sexualité, écrit-il, la prise de conscience est inversée. C’est le fait de vivre subjectivement la violence, la conscience subjective de la contrainte, ou alors la réinterprétation d’une situation, qui produit le traumatisme.[45] Selon lui il n’y a donc pas, dans le cadre de la sexualité, hors situation d’amnésie, de violence objective qui ne soit pas éprouvée par le sujet. Il déduit de cela la nécessité de se borner à l’évaluation du consentement, au présent, et de se méfier des formes de violence que l’individu peut s’infliger à lui-même en réinterprétant ses souvenirs. [46]
La reconstruction a posteriori d’un souvenir ou la réinterprétation d’une situation, écrit-il, n’est ni totalement fausse, ni totalement vraie, et si elle possède à l’évidence une part de vérité, c’est aussi en tant qu’interprétation, et non comme simple vérité du moment.[47] Par ailleurs, si Lagasnerie va jusqu’à affirmer que la domination n’est pas objectivable dans des relations consenties [48], et s’il se méfie des réinterprétations a posteriori de notre vécu, ou des jugements extérieurs affirmant qu’une personne qui désire une relation serait cependant abusée car en position dominée (il va jusqu’à écrire que la réinterprétation du consentement au prisme des logiques de domination relève d’un « projet réactionnaire »), c’est notamment parce qu’une telle considération présuppose toujours une idée de ce que serait une relation ‘‘normale’’ : « Affirmer que quelqu’un a éprouvé du désir pour quelqu’un d’autre à cause d’une situation de domination et que son désir serait vicié car il a été façonné par l’histoire et la société ou « sous emprise » n’annule pas la réalité du désir et ne permet pas d’établir un « dommage ». Penser que la reconstruction sociologique de la naissance du désir vaut annulation du désir est aussi dénué de sens qu’affirmer qu’un phénomène est construit socialement voudrait dire qu’il n’existe pas. (…) Pour pouvoir mettre en cause un désir ou un fantasme en invoquant sa fabrication historique ou sa signification politique, il faut nécessairement supposer une norme de ce qu’aurait été un désir neutre, « non façonné » par la société et qui renvoie toujours implicitement à la figure de relations entre personnes d’âge, de classe, de groupe et de race homogènes et identiques… » [49]
Aussi, critique de la loi votée au début de l’année 2021 qui considère comme viol tout rapport sexuel entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur (dès lors que le majeur a cinq ans de plus), Lagasnerie rappelle la position du Planning familial qui, quelques années auparavant, face à un projet de loi analogue, s’alarmait que la sexualité des adolescents devienne « encore plus taboue et cachée », ce qui ne pourrait que contribuer à éloigner les mineurs des espaces de parole et des structures de soin. Lagasnerie critique aussi le renforcement du pouvoir des parents induit par une telle évolution législative, et notamment les possibilités d’intervention familiale pour empêcher une relation homosexuelle ou avec une personne dont l’origine déplaît à la famille.[50]
Geoffroy de Lagasnerie, tout en étant prêt à accepter l’idée d’une présomption de non-consentement des mineurs de moins de quinze ans avec des majeurs, défend la nécessité de juger les situations dans leurs singularités, et la possibilité de prouver que certaines de ces relations sont consenties. Il cite Edouard Louis et Rachid O, qui ont raconté une expérience érotique (dans le cas d’Edouard Louis) et des relations sexuelles (pour Rachid O) vécues à l’adolescence avec des hommes bien plus âgés, et la façon dont ces relations les ont émancipés de la violence qui s’exerçait dans les cadres scolaires et familiaux. Tout en précisant qu’il n’appelle pas à prendre ces exemples en modèle, il rappelle que de telles expériences existent, et qu’elles prouvent la nécessité de juger les situations au cas par cas.[51]
Lagasnerie semble s’inspirer de penseurs qui, dans les années 70, avaient défendu le fait que la pénalisation du viol ne devait pas se faire en fonction d’une barrière d’âge fixe et inamovible, mais de l’identification, par la jurisprudence, de ce que Michel Foucault nommait des « systèmes de contrainte ». En 1977, face à la commission de révision du code pénal, Foucault déclarait à propos des rapports entre majeurs et mineurs, qu’en dépit des « incertitudes du consentement », il préférait « un arbitraire décidé par le juge à un arbitraire décidé par la loi » [52].
Aussi, comme le rappelle Lagasnerie, Foucault avait proposé, dans le cadre d’une réflexion visant à émanciper la sexualité des tutelles de l’État, de « dé-sexualiser et dé-psychologiser le droit , par exemple en abordant le viol comme une violence physique – comme une agression – en abolissant la référence à la sexualité. Cette idée rejoint certains slogans prononcés par des activistes qui affirment, je crois à juste titre, que le viol n’est pas affaire de sexualité mais de violence. » [53]
Lagasnerie fait aussi remarquer que dans les cas de harcèlement sexuel à l’université ou au travail, c’est le plus souvent la connotation sexuelle des remarques ou des échanges qui est considérée comme le danger par la justice ou les médias, alors que le problème réside en réalité dans l’existence d’un rapport hiérarchique : « La focalisation sur les propos ou les gestes jugés offensants ou déplacés dans le cadre du travail, et la codification de ceux-ci comme relevant d’un problème de ‘‘harcèlement sexuel répréhensible’’ pourraient fonctionner comme une opération de stabilisation voire de renforcement de tout un ensemble de hiérarchies instituées. (…) Une moindre focalisation dramatisante sur la sexualité aurait pu amener à la construction d’une autre analytique, au sein de laquelle il pourrait sembler tout à fait normal voire sain qu’il y ait dans l’espace du travail des propositions, des incitations, des blagues, des relations … et qui seraient susceptibles d’être l’objet de réponses simples et libres si les hiérarchies et les rapports de pouvoir étaient transformés dans un sens égalitaire. » [54] En conclusion de son ouvrage, pour développer un rapport à la sexualité apaisé et non dramatique, l’auteur appelle à la fois à « désexualiser la sexualité [55] et la lutte contre les violences sexuelles », et à appuyer la critique des normes culturelles sur autre chose que des procédures pénales.[56]
En guise de conclusion …
Dans les réactions hostiles déclenchées par le livre sur les réseaux sociaux, les passages constatant l’existence d’un exceptionnalisme sexuel sont ceux qui ont fait le plus réagir. Lagasnerie y fut accusé, sur la base de citations opportunément tronquées, de légitimer le harcèlement sexuel ou de minimiser l’impact psychologique du viol. Parfois, il lui fut reproché, en tant qu’homme qui s’exprime sur ces sujets, de faire du « mansplaining », voir d’exprimer une position « masculiniste ». On pourrait se borner à ironiser sur l’absurdité d’un tel argument, qui présuppose que l’exceptionnalisme sexuel et le féminisme carcéral sont le seul point de vue féministe existant, lequel serait attaqué par Lagasnerie « en tant qu’homme », alors même que les mouvements féministes ont toujours été traversés par ces débats. On pourrait en outre faire remarquer qu’il est incohérent de demander à un auteur opposé par principe à la prison et critique de la justice pénale d’arrêter sa réflexion à la frontière des infractions sexuelles, alors même qu’il s’appuie sur la lecture de penseurs qui ont critiqué la sexualisation du droit. Mais on peut aussi profiter de l’occasion pour faire quelques observations sur les références intellectuelles qui sont celles de Lagasnerie.
D’une part, nous l’avons spécifié, Geoffroy de Lagasnerie se réfère à sa propre expérience, ou à d’autres expériences homosexuelles, en même temps qu’il entend prolonger les réflexions du mouvement gay. Il mentionne dans une interview récente pour le magazine Têtu la façon dont ce mouvement a fait baisser les violences homophobes par un combat culturel, sans demander plus de répression [57]. On peut aussi déceler dans son livre la méfiance du mouvement gay vis-à-vis de toute prise en charge de la sexualité par l’État, et son rejet de la définition par le pouvoir politique d’une norme relationnelle trop rigide.
D’autre part, son affirmation selon laquelle la violence sexuelle est bien plus une affaire de violence que de sexe rejoint celle des féministes dites pro-sexe qui se sont exprimées dans les années 80, dans le contexte de ce qu’il est convenu d’appeler les sex wars. Alors que des féministes radicales comme Catharine MacKinnon (à l’origine de la définition du harcèlement sexuel dans la loi américaine) et Andrea Dworkin (qui fut l’initiatrice de campagnes contre la pornographie et la prostitution) assumaient une critique de la sexualité, qu’elles amalgamaient à la violence de genre, d’autres féministes, comme Gayle Rubin, dites pro-sexe, ont tenu à effectuer cette séparation entre sexualité et violence de genre.[58] Pour les féministes pro-sexe, la violence sexuelle est plus liée à un ordre social (qui peut par ailleurs diaboliser les sexualités minoritaires) qu’à la dimension strictement sexuelle de l’interaction.[59]
Lagasnerie prolonge cette réflexion, et semble voir dans la focalisation sur la dimension spécifiquement sexuelle de ces violences, l’origine des réflexes punitifs à gauche. Au début de son ouvrage, il écrit notamment : « Il existe dans nos sociétés quelque chose comme une sorte d’exceptionnalisme sexuel. Cet exceptionnalisme sexuel apparaît notamment dans le fait que, sur ce sujet, la gauche semble oublier ses principes et inverse ses analyses. Alors que la critique de la prison, de l’individualisation de la responsabilité, de l’approche répressive occupe une place d’ordinaire essentielle dans les mouvements progressistes, la mobilisation contre les violences sexuelles prend presque toujours la forme d’un appel à renforcer l’action répressive et punitive : critique de la justice pour ne pas assez punir les violeurs ou les agresseurs sexuels, appel à augmenter l’âge du consentement, mise en question des règles de la prescription voire son principe même, revendication permanente d’une aggravation des peines et invention de nouveaux délits, de nouveaux crimes ou de nouveaux critères d’incrimination, refus de la possibilité de la réhabilitation, de l’oubli, du pardon. (…) La sexualité est aujourd’hui l’un des seuls domaines qui engendre des logiques de bannissement. Pour des révélations d’attitudes ou de comportements qui sont parfois seulement décrits comme inappropriés ou offensants, certains perdent leur travail et toute possibilité de retrouver un travail dans le secteur culturel – alors que la gauche n’a cessé de se battre pour l’idée de réhabilitation. Comment expliquer par exemple que, à la suite du témoignage d’Adèle Haenel dans Mediapart en 2019, il semble inconcevable que Christophe Ruggia, qu’elle accusait de caresses et de désirs déplacés, refasse un film alors que dans le même temps et heureusement d’ailleurs, des rappeurs, des cinéastes, d’anciens braqueurs ou brigades rouges peuvent continuer à tourner, chanter ou publier y compris lorsqu’ils ont été condamnés pour enlèvement, séquestration, appartenance à une bande armée … ? »
Cette affirmation de l’existence d’un exceptionnalisme sexuel « dans nos sociétés » mériterait probablement d’être nuancée. On peut d’une part observer que dans certains discours de droite [60], c’est au contraire dans les seuls cas d’accusations de violence sexuelle que l’on peut entendre la dénonciation d’une justice expéditive ou d’un tribunal médiatique, autant de précautions qui ne sont pas prises lorsque, par exemple, un rappeur ou un humoriste est désigné comme islamiste à longueur de colonnes. D’autre part, la focalisation à gauche sur des cas individuels et la défense d’un populisme pénal ne concernent pas que les cas de violences sexuelles. Ainsi, alors qu’animer des ateliers en prison et ‘‘œuvrer à la réinsertion’’ sont pourtant perçus de façon positive dans le milieu de la culture, de nombreuses voix s’élèvent à chaque fois que Bertrand Cantat, qui a pourtant fini de purger sa peine en 2010, envisage de se produire sur scène. Aussi, et Geoffroy de Lagasnerie l’a plusieurs fois mentionné, de nombreuses enquêtes journalistiques portant sur les violences policières, le harcèlement au travail ou la fraude fiscale, se bornent à pointer des actes présentés comme de simples dysfonctionnements, des fautes individuelles, et masquent ainsi les structures sociales, les mécanismes d’exploitation et de répression.[61] C’est donc logiquement que, de cette focalisation sur les responsabilités individuelles, peuvent découler chez de nombreux activistes la jubilation face à l’incarcération de Claude Guéant et Patrick Balkany, ainsi que la dénonciation du ‘‘laxisme’’ qui caractériserait le traitement de Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy ou Alexandre Benalla.
Lagasnerie a cependant raison de constater que « la sexualité n’est pas un sujet de réflexion comme les autres. Il est chargé d’une intensité émotionnelle particulière qui rend parfois impossible la discussion. (…) La sexualité est un domaine à propos duquel les prises de position sont souvent marquées par une forme d’irrationalité parce que beaucoup y réfléchissent en ayant en tête des images de telle ou telle pratique ou de tel ou tel type de relation qui provoquent chez eux des dégoûts, ce qui empêche alors toute forme de raisonnement apaisé.
D’ordinaire, la pluralité des points de vue sur une question est appréhendée comme un point de départ que la discussion a pour fonction de conjurer et de réduire au minimum possible. Mais sur la question sexuelle, il est sans doute beaucoup plus pertinent de considérer la diversité des investissements et des sensibilités comme une donnée irréductible et un indépassable. »[62]
Cependant, à l’inverse des féministes pro-sexe ou des penseurs queers, si Lagasnerie critique la focalisation étatique et médiatique sur la dimension sexuelle des abus, et s’il constate la spécificité des débats relatifs à la sexualité, ce n’est pas, il me semble, pour accorder une autre place au désir dans la politique, ni pour analyser les différences entre les relations. Judith Butler a insisté sur le fait que la sexualité peut reproduire des normes de genre, mais qu’elle peut aussi les subvertir.[63] Précédemment, Foucault avait décrit les modes de vie homosexuels dans ce qu’ils avaient de spécifique, et avait vu leur existence comme une opportunité de réinventer les relations.[64] Hocquenghem et le FHAR avaient quant à eux défendu une homosexualité révolutionnaire remettant en cause des attendus liés à la préservation de l’ordre social, telles que la fixité du partenaire, la centralité de la reproduction ou l’existence de relations entre personnes de même âge, de même origine et de même classe sociale. Des visions de l’homosexualité comme défense d’une communauté et de formes de vie minoritaires sont encore aujourd’hui présentes, par exemple, dans les écrits de Didier Lestrade [65] ou Alain Naze [66].
Au contraire, je crois, Geoffroy de Lagasnerie, qui considère que le rapport à l’esthétique n’est pas politique [67], semble avoir le même point de vue à propos du désir. En citant la façon dont le désir sexuel est décrit par Edouard Louis dans ses récits, Lagasnerie l’associe essentiellement à une action du corps, plus qu’à un imaginaire ou à des représentations symboliques qu’il s’agirait d’analyser. Il aborde aussi l’homosexualité, et semble-t-il le désir en général, comme un simple « choix d’objet ». Il l’explique dans son entretien pour Têtu : « Toute forme de critique sociale du désir suppose une norme implicite et souvent réactionnaire de ce qu’aurait dû être un désir non vicié. On va essayer d’expliquer le désir pour une personne avec un âge différent, une classe différente, une origine différente … Quand l’âge ou le milieu sont identiques, on ne remet jamais en question ce désir, on le présuppose comme évident, contrairement à ceux qui seraient liés à un phénomène de domination. On ratifie donc l’idée qu’il y aurait des choix d’objets légitimes … Je pense qu’il faut réaffirmer une forme d’autonomie de la sexualité et du désir par rapport à la politique. On peut très bien fantasmer de coucher avec quelqu’un qui se déguise en policier et qui menotte, insulte ou frappe, et lutter contre les violences policières. Foucault, par exemple, aimait les rapports SM, il n’avait pas pour autant envie de se faire taper dans la rue. » [68]
Dans ses textes critiques de la psychanalyse, Didier Eribon a aussi insisté sur le danger à établir des jugements sur le désir ou sur les relations sentimentales et sexuelles.[69] L’évaluation du désir ou d’une relation présuppose toujours une norme et il est légitime de refuser les polices des mœurs. On peut cependant se demander si, au nom du refus de penser à partir d’une norme, Lagasnerie et Eribon ne s’interdisent pas parfois d’analyser l’imaginaire et les symboles qui structurent les désirs.
En outre, la situation décrite par Lagasnerie comme exemple d’un désir dépolitisé n’est pas autant exempte de politique qu’elle en a l’air. En effet, le fantasme d’être dominé par un homme déguisé en policier (voire par un vrai agent de police), ou le fait de prendre plaisir d’une mise en scène de violence policière, comporte une distance critique vis-à-vis du pouvoir. Le masochisme, expliquait Deleuze, est une ironie sur le pouvoir, qui vise à le détourner de son objet pour en prendre plaisir.[70]
Il y a quelques années, dans un article à propos du BDSM publié dans Harz-Labour [71], publication rennaise distribuée au cœur des luttes, j’avais tenté d’expliquer que « dans ces relations, plutôt que de nier l’existence du pouvoir qui nous traverse et nous produit, le but est d’œuvrer à sa circulation, à son détournement ou à son retournement, et d’en tirer plaisir. Certes, nous connaissons les discours de ceux qui affirment que les adeptes du BDSM seraient, malgré certaines transgressions, extrêmement respectueux de la dichotomie domination / soumission. Pourtant, le fait de tirer plaisir des pratiques de domination et de soumission, souvent lié à la conscience du caractère arbitraire de cette pantomime, constitue un trouble dans les rapports de pouvoir. »
Contrairement à Geoffroy de Lagasnerie, je ne considère pas que le rapport de Foucault au SM soit à dissocier de sa réflexion sur les rapports de pouvoir et la subjectivation qui en découle. Aussi, quand Foucault aborde la question de la désexualisation de la sexualité (il signifie par là la défense d’une érotique polymorphique, la rupture de la sexualité avec un ensemble de normes, dont le caractère central accordé à la génitalité), cela est à mettre en lien avec sa « politique de l’amitié » associée au mouvement gay, et l’invention de nouveaux rapports et de nouveaux modes de vie.
Par ailleurs, Lagasnerie, semble se distancier d’une approche révolutionnaire de l’homosexualité, qui ne la définissait pas comme un « choix d’objet », une attirance pour le même sexe, mais comme une subjectivation, liée, entre autres, à un rapport à la nuit, à la communauté, à l’altérité, à la provocation, etc. Cette vision était tellement présente que Deleuze, qui n’était pas homosexuel, a pu s’y reconnaître. Dans le même temps, Guy Hocquenghem et Hervé Guibert ont pu imaginer, dans des romans autofictionnels, la relation de leur alter-ego avec une femme.
La prétention révolutionnaire d’une partie du mouvement homosexuelle était notamment détaillée par Quentin Dubois l’été dernier, lors d’une présentation de l’œuvre de Guy Hocquenghem et de l’histoire du Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire que nous avions effectuée ensemble : « Cette prétention révolutionnaire [celle du FHAR] fit éviter des écueils politiques de taille (la reterritorialisation dans l’identité, les supplications d’être reconnus comme respectables, mais aussi de défendre l’homosexualité comme un choix d’objet ou une préférence, un amour du même, un « amour entre un homme qui aime un homme »). Il s’agissait donc de tenir ensemble économie politique et économie libidinale, et de produire une politique révolutionnaire fondée sur l’auto-affirmation d’un pouvoir d’inquiéter l’hétérosexualité prenant pour cible le cabinet psy, la famille et l’école. » [72]
Geoffroy de Lagasnerie ne centre pas son approche politique sur les analyses du désir ou des relations, ni sur des considérations esthétiques ou l’attention au déploiement d’une puissance communautaire. Il ne semble pas reconnaître de fonction autotélique à la politique, mais simplement l’aborder en fonction de la nécessité d’exprimer des revendications pour faire reculer les inégalités et accroître la liberté des individus. Il s’écarte là de nombre de pensées émancipatrices qui, après mai 68, n’ont pas pris pour point de départ un apport rationaliste et utilitariste à la politique (comme revendication vis-à-vis des institutions), mais plutôt ce que René Schérer nommait dans un entretien récent « les incursions de la pensée désirante ».[73]
Nourrissant sa pensée de la lecture des théoriciens néo-libéraux, Lagasnerie se méfie à juste titre de l’autoritarisme que peut porter une vision de la politique qui ne met pas l’individu au centre. Il semble aussi refuser une évaluation politique des relations, ou une définition politique de ce que sont des relations désirables. Geoffroy de Lagasnerie ne semble pas considérer que la philosophie ou l’engagement politique doivent évaluer le désir, ou définir des formes d’exister plus désirables que d’autres. Selon son approche, la politique doit simplement créer des formes sociales qui permettent aux personnes de choisir la façon dont elles souhaitent vivre. Tout en comprenant sa méfiance, je considère quant à moi, et c’est peut-être ce qui nous différencie principalement, qu’une lutte ne mobilise largement que lorsqu’elle est liée à un imaginaire et à une représentation symbolique, jusqu’à faire écho à des conceptions esthétiques ou des visions éthiques du monde. Cette divergence ne concerne pas que la politique de la sexualité, bien qu’elle la recoupe. Son approche utilitariste de l’art, sa défense de créations obligatoirement engagées, ses affirmations selon lesquelles les récits doivent être explicites et liés à des discours sociologisants, en lien avec son refus de faire des rapprochements entre politique et esthétique [74], me semble relever du même refus de prendre en compte la part d’imaginaire et d’affects présente dans toute lutte sociale.
Je considère que les luttes politiques gagneraient à ce que celles et ceux qui y participent admettent les dimensions psychologiques et désirantes de l’engagement, et pensent plus, en positif, ce à quoi ils aspirent, ce qui nous porte subjectivement, esthétiquement, éthiquement, y compris en ce qui concerne les aspects relationnels ou sexuels. Dans ce cadre, qui n’est pas celui du recodage de l’insatisfaction ou de la gêne sur le mode d’une dénonciation d’un abus, de l’identification d’un coupable et d’une demande de condamnation, où le but n’est pas d’interdire ou de punir, il me semble aussi plus aisé de réfléchir à la place des rapports de domination dans les rapports consentis, d’analyser des relations passées sans se subjectiver comme victime a posteriori, et sans produire de nouvelles normes coercitives.
Cependant, il convient d’observer que l’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie, Mon corps, ce désir, cette loi, a de nombreux mérites. Nous avons insisté sur sa critique salutaire des demandes de renforcement de l’état pénal qui s’expriment dans la lutte contre les violences sexuelles, et sur sa reprise des positions émancipatrices pour une justice restauratrice et transformatrice. Mais Lagasnerie a aussi le mérite d’expliciter plusieurs rapports au sexe, et différents points de vue sur le lien que l’on doit établir, ou non, entre la sexualité et la politique. Y compris dans son caractère polémique, l’ouvrage ouvre donc plusieurs débats.
[1] Geoffroy de Lagasnerie, Mon corps, ce désir, cette loi : réflexions sur la politique de la sexualité, Fayard, 2021, p21.
[2] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p16.
[3] Michel Foucault, Leçon du 7 janvier 1976, publiée dans Dits et écrits, tome II : 1970-1975, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Sciences humaines », 1994 , p163.
[4] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p27.
[5] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid p11.
[6] L’ouvrage de Geoffroy de Lagasnerie, cela nous est précisé d’emblée, « est la version développée d’une conférence prononcée lors du colloque « Edouard Louis : écrire la violence » qui s’est tenue à la Cité universitaire à Paris le 19 juin 2021 et il doit être lu comme tel ».
[7] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid p12.
[8] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p12.
[9] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p24.
[10] Lire à ce sujet Faut-il brûler Hocquenghem ?, d’Antoine Idier. Lire Hocquenghem de Mickael Tempête ou encore Le système de l’enfance, de Quentin Dubois et moi-même.
[11] Comme en témoigne le communiqué intitulé « Vous n’aurez pas la paix », se scandalisant notamment de l’apposition d’une plaque rendant hommage à Guy Hocquenghem, signé par une coalition allant de féministes « intersectionnelles » à l’Association Enfants Prévention Actions Pédocriminalité Inceste (EPAPI) et l’Association internationale des victimes de l’Inceste (AIVI), dont les principaux combats sont la dénonciation d’une justice considérée comme complice des pédophiles, et, dans le cas de l’AIVI la lutte contre les cours d’éducation sexuelle à l’école, qui relèveraient selon l’organisation de la « perversion » et viseraient à « attaquer l’enfance afin de la formater vers une quête de jouissance sexuelle précoce » : https://aivi.org/vous-informer/actualites/2886-quelle-education-sexuelle-pour-nos-enfants-le-colloque-2018-du-reppea.html
[12] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p24.
[13] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p25-26.
[14] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p33.
[15] Virginie Despentes, « Désormais on se lève et on se barre », Libération.fr, 1er mars 2020.
[16] Paul Aveline, Complots et pédocriminalité : Karl Zéro en roue libre, dans Arrêts sur images le 6 novembre 2021
[17] On peut commander le viol d’un enfant en ligne…et tout le monde s’en fout ? #1SUR5 chez BTP
[18] Daniel Schneidermann, #MeToo : le cas de Geoffroy de Lagasnerie, Libération, 27 décembre 2021
[19] Guy Hocquenghem et René Schérer, L’Âme atomique. Pour une esthétique d’ère nucléaire, Paris, Albin Michel, 1986.
[20] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 44-45.
[21] Gwenola Ricordeau, Pour elles toutes : femmes contre la prison, Lux Editeur, 2019.
[22] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 41.
[23] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 49-50.
[23] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 46.
[25] Donatien Huet, Violences sexuelles : les musiques extrêmes face à leurs démons, dans Mediapart, 22 mai 2021
[26] Collectif, Violences sexuelles dans la scène punk/metal : les suites d’un séisme, billet de blog, 15 novembre 2021
[27] Arrêts sur images, Un tribunal médiatique ? « Il y a plein d’enquêtes qu’on ne publie pas », 10 décembre 2021.
[28] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p 34.
[29] Lénaïg Bredoux et Marine Turchi, Violences sexuelles : révélations sur le comportement de Juan Branco, Médiapart, 10 juin 2021.
[30] Juan Branco a depuis été mis en examen. Il nie avoir exercé une quelconque contrainte, et c’est sur cette dimension que porte l’enquête de la justice.
[31] Marine Turchi, Affaire Duhamel : d’autres éléments pourraient intéresser la justice, Médiapart, 14 avril 2021.
[32] Entretien avec Michel Foucault par René de Ceccaty, Jean Danet et Jean Le Bitoux, paru dans le Gai Pied, N°25, avril 1981, pages 38-39. Paru également dans Dits et Écrits tome IV.
[33] Collectif, Pour une culture de la solidarité, Rébellyon, le 30 juillet 2020
[34] Elian Peltier, Adèle Haenel : « La France a complètement raté le coche » de #MeToo, New York Times, 24 février 2020
[35] Collectif, #MeToo aux candidat·e·s à la présidentielle : «Qu’allez-vous faire pour que les hommes cessent de violer ?», dans Libération le 10 décembre 2021
[36] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p51.
[37] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p53.
[38] Il faut préciser ici que contrairement à ce qui a été écrit par Judith Duportail et Daniel Schneidermann, ce récit n’est pas le sujet principal de l’ouvrage. Il occupe trois pages du livre, et n’est là qu’à titre d’exemple.
[39] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p95-98.
[40] Marion Cocquet et Marc Leplongeon, MeTooGay, les coulisses d’un drame, dans Le Point, n°2525, 18 mars 2021.
[41] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p57.
[42] Vanessa Springora, Le Consentement, Paris, éditions Grasset, 2020.
[43] Vanessa Springora écrit dans Le Consentement : « La situation aurait été bien différente si, au même âge, j’étais tombée follement amoureuse d’un homme de cinquante ans qui, en dépit de toute morale, avait succombé à ma jeunesse, après avoir eu des relations avec nombre de femmes de son âge auparavant, et qui, sous l’effet d’un coup de foudre irrésistible, aurait cédé, une fois, mais la seule, à cet amour pour une adolescente. Oui, alors là, d’accord, notre passion extraordinaire aurait été sublime, c’est vrai, si j’avais été celle qui l’avait poussé à enfreindre la loi par amour, si au lieu de cela G. n’avait pas rejoué cette histoire cent fois tout au long de sa vie ; peut-être aurait-elle été unique et infiniment romanesque, si j’avais eu la certitude d’être la première et la dernière, si j’avais été, en somme, dans sa vie sentimentale, une exception . Comment ne pas lui pardonner, alors, sa transgression ? L’amour n’a pas d’âge, ce n’est pas la question. »
[44] Dans un article intitulé Lire Matzneff et publié par Lundimatin, Antoine Mazot-Oudin et moi-même avons montré, en citant Gabriel Matzneff, en quoi son pouvoir sur les adolescentes et les enfants ne relève pas de la revendication d’une libération sexuelle, ni même d’un quelconque gauchisme post-soixante huitard, mais d’un système littéraire de pouvoir et de prédation assumé comme tel, qu’il légitime par ses références aristocratiques et sa misogynie.
[45] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p58-59.
[46] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p105-106.
[47] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p59-60.
[48] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p62.
[49] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p62-63.
[50] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p82.
[51] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p78-79.
[52] Antoine Idier, Michel Foucault devant la commission de révision du code pénal, dans Lundimatin, le 17 mai 2021
[53] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p91.
[54] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p74-75.
[55] C’est-à-dire la rupture avec les normes et les discours aujourd’hui existants qui encadrent la sexualité, et la défense des actes sexuels comme relevant d’une activité parmi d’autres, importante mais désacralisée et dédramatisée.
[56] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p105-106.
[57] Dans le numéro de janvier-mars 2022, Lagasnerie déclare que le mouvement gay « tout en étant très peu punitif (…) a transformé les structures sociales et mentales, et fait diminuer le nombre d’agressions et le niveau de violences auxquels sont exposés les gays. C’est un mouvement culturel, mais, surtout, un mouvement qui a demandé des droits plutôt que des peines et qui a, de cette façon, obtenu une transformation puissante de l’hégémonie culturelle »
[58] Gayle Rubin, Surveiller et jouir. Anthropologie politique du sexe, textes rassemblés et édités par Rostom Mesli, traductions françaises de Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, EPEL, 2010.
[59] L’histoire de ces débats est notamment résumée par Eric Fassin dans sa préface à Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, préface d’Éric Fassin, traduction de Cynthia Kraus, La Découverte, Paris, 2005.
[60] Par exemple dans les articles du journal Marianne, ou, plus proche de l’extrême-droite, dans les prises de position d’Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy ou Eugénie Bastié.
[61] À propos d’une enquête dénonçant le comportement d’Esther Benbassa vis-à-vis de ses subordonnés, il écrivait récemment, « si, comme on le dit souvent lorsque l’on souhaite malgré tout défendre ce genre de papier, le problème du harcèlement au travail, et notamment sur les assistants parlementaires, est structurel et qu’il faut en parler, je suis évidemment d’accord – mais alors que l’enquête soit structurelle et non pas individualisante et donc dépolitisante comme elle l’est ici. Au moment des Panama Papers Julian Assange avait fait un entretien dans lequel il avait souligné que le journalisme, en s’étant concentré sur quelques évadés fiscaux, avait volé l’histoire en ne parlant pas des structures du capitalisme et de la banque qui avaient rendu possible toute cette évasion fiscale. C’est la même chose qui se passe ici. Est-ce que ce type d’enquête me dit quelque chose des structures de pouvoir dans la société où est-ce qu’elle nous vole l’histoire en ciblant de manière totalement arbitraire et fallacieuse une personne, dont on abstrait quelques faits même graves de toute son histoire – ce qui fait que l’on inscrit les faits reprochés dans son caractère, son tempérament, beaucoup plus que dans le droit du travail ou le fonctionnement des institutions… »
[62] Geoffroy de Lagasnerie, Ibid, p18.
[63] Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, préface d’Éric Fassin, traduction de Cynthia Kraus, La Découverte, Paris, 2005.
[64] Entretien avec Michel Foucault par René de Ceccaty, Jean Danet et Jean Le Bitoux, paru dans le Gai Pied, N°25, avril 1981, p38-39. Paru également dans Dits et Écrits tome IV texte n°293.
[65] Didier Lestrade, Pourquoi les gays sont passés à droite, Paris, Le Seuil, 2012.
[66] Alain Naze, Manifeste contre la normalisation gay, La Fabrique, 2017.
[67] Geoffroy de Lagasnerie, L’Art impossible, Presses universitaires de France, coll. « Des mots », 2020.
[68] Geoffroy de Lagasnerie, « Le mouvement gay pourrait inspirer la lutte contre les violences sexuelles« , dans Têtu, janvier-mars 2022
[69] Didier Eribon, Écrits sur la psychanalyse, Paris, Fayard, 2019.
[70] Gilles Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch. Le froid et le cruel, avec le texte intégral de La Vénus à la fourrure, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 1967.
[71] Harz-Labour n°21, Jouir avec ou sans entrave. Ce que le BDSM peut nous apprendre
[72] Quentin Dubois et Vivian Petit, Hocquenghem, réflexion sur la défaite homosexuelle, Lundimatin, le 23 août 2021
[73] Lundimatin, Entretien avec René Schérer, le 15 février 2021
[74] Geoffroy de Lagasnerie, L’Art impossible, Presses universitaires de France, coll. « Des mots », Paris, 2020.
/////// Autres documents
Tout recours au pénal est d’abord un échec du collectif
Entretien avec Gwenola Ricordeau, à propos de son livre, Pour elles toutes. Femmes contre la prison, publié aux éditions Lux.
La rencontre avec un policier est le touchant-touché du sujet politique
Entretien avec Geoffroy De Lagasnerie, sociologue et philosophe, à propos de son ouvrage La conscience politique, publié aux éditions Fayard. Entretien > Emmanuel Moreira Image > Cyril Zannettacci Dans la théorie politique « tout se passe comme si une sorte de magie était à l’ouvre dans […]
Voir l’Etat pénal tel qu’il est.
Que peut la sociologie lorsqu’elle interroge le système du jugement et de la répression ? C’est l’enjeu du dernier livre de Geoffroy de Lagasnerie : Juger. L’Etat pénal face à la sociologie.
Entretien radiophonique.
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris