Frank Smith, Sébastien Zaegel, Jean-Philippe Cazier
Jean-Philippe Cazier : Les trois films que tu as réalisés ont été projetés au Centre Beaubourg le 24 janvier dernier : Le vent, le vent, Eureka, et Le Film des questions. Je n’avais pas vu tes films et j’ai découvert les trois à la suite. Deux questions un peu générales pour commencer. Quels rapports établis-tu entre ton travail d’écrivain et celui de cinéaste ? D’autre part, si je faisais une généalogie un peu rapide, je rattacherais spontanément tes films à ceux de Duras ou de Straub et Huillet. On y retrouve de manière évidente ce qui signe leurs œuvres : disjonction, qui ne veut pas dire indépendance, entre l’image et le son en off, recours aux plans fixes, utilisation de textes très écrits, très littéraires, une certaine fascination pour les paysages, les matières naturelles mais aussi urbaines ou technologiques filmées de manière à les rendre autonomes et énigmatiques, etc. Si je pense à Duras, c’est aussi, sans doute, à cause du fait que dans Le vent, le vent, c’est Emmanuelle Riva, l’héroïne d’Hiroshima mon amour, qui dit en off un texte d’Emmanuel Hocquard aux tournures également très durassiennes. Il y a aussi dans Le Film des questions le fait que tu filmes les deux acteurs en train de lire le texte du film, comme Duras dans Le camion, avec Depardieu. En regardant Le Film des questions et le travelling qui avance sur une route du Névada par Alabama pendant quasiment toute la durée du film, on pourrait aussi penser à certains plans de Resnais…
Frank Smith : Je ne me considère pas comme un cinéaste. Je cherche comment des idées en poésie peuvent s’appliquer en cinéma. Et je cherche comment les ressources propres au cinéma peuvent être réévaluées par les forces du poétique. Je décide de faire un film quand je me rends compte avoir atteint des limites indépassables pour moi à l’écrit et que je peux transférer/rattraper vers le cinéma avec d’autres moyens. Le mode opératoire est ici constitué des différentes matières élaborées pour le besoin d’un film – images / textes / sons –, à la fois expurgées de toute intention d’énonciation et redéployées, jetées à nouveau ensemble. Les composants du film sont appelés à se reconfigurer, à flotter de concert. Et réciproquement. C’est cette frontière entre film et livre qui fait l’objet d’une exploration désormais. Quand il est question de frontière, comme l’indique Judith Butler, on désigne, par voie de conséquence, les actions de séparer, de défendre, de secourir voire de cohabiter. Des agrégats sensibles, donc, qui flottent de conserve, qui s’associent, s’escortent les uns par rapport aux autres dans un souci de protection, sous la forme d’un film-livre. On pourrait dire aussi que ces mêmes matières serviraient à révéler ce que l’on est en train de dire ― la langue ne pouvant jamais dire que ce qu’elle est.
Un livre = un film = un livre. Eureka est devenu un journal après avoir été un film et Le Film des questions un film après avoir été un livre. Mais on ne sait pas où est le film, on ne sait pas où est le livre. La frontière ne s’ouvre pas entre les matériaux rassemblés et le dehors, l’outside, mais dans leur for intérieur, comme des forces constitutives qui se tendent. Dans ce projet de collision, la frontière livre / film sort de ses gonds ou est contournée. Sait-on jamais si l’on dispose de tous les documents nécessaires pour pouvoir franchir le check-point, négocier le passage avec les gardes-frontière ? On a prélevé et recyclé, on a détourné, on a reformulé, on a réagencé, on a répliqué. Une dé-médiation mise en place pour une re-médiation en surplomb. Enquête, éclaircissement pour voir ce que ça donne. Une résolution, ce que fait la poésie – ailleurs. Ce que ça donnerait. Un usage autre et différent depuis les mêmes opérandes.
Pour ce qui est des références dont tu parles, Duras et les Straub, bien entendu, mais aussi James Benning, Chantal Akerman, et Pasolini. Duras pour son inventivité totale entre littérature et cinéma. Les Straub pour leur force politique. Benning pour son art de la découpe du réel américain. Akerman pour les condensations de sens qu’elle produit aussi bien dans ses films de fiction que ses propositions de type plus documentaire, même si la question des genres n’est plus recevable aujourd’hui. Il faudrait citer Godard, bien entendu. Pasolini pour ses réflexions sur le concept de montage en poésie et au cinéma. Cette conception du montage comme opération signifiante a pour lui des implications philosophiques et esthétiques : il estime que « le montage effectue sur le matériau du film la même opération que la mort accomplit sur la vie », la mort elle-même opérant selon lui « un fulgurant montage de notre vie » ; c’est elle qui donne un sens à la vie, qui ordonne ce « chaos de possibilités » qu’était l’existence humaine tant qu’elle avait encore un futur. Ainsi, le montage est créateur de sens parce qu’il permet non seulement de reconstruire une totalité synthétique mais surtout parce qu’il permet d’isoler des fragments de la réalité — corps, visages, paysages — qu’il investit d’une « dimension sacrale » en les séparant du reste de la représentation.
Ces sont ces artistes-là en particulier qui me permettent de réfléchir aux différents types d’opérations à mettre en place. Je les redéploie dans le champ de l’image et du cinéma afin de réaliser ce que j’appelle des « ciné-poésies ». Quels dispositifs mettre en place en cinéma, quelle cause commune avec les opérations de Documenter ; Dupliquer/Translater ; Objectiver ; Neutraliser ; Dépersonnaliser ; Désécrire ; Co-errer ; Chercher/trouver ; Ouvrir ? L’idée motrice de ces réalisations est de translater des idées de poésie en des idées de cinéma. Mes questionnements sont par exemple les suivants : Qu’est-ce que dire et voir sachant qu’on ne peut pas dire ce qu’on voit ni voir ce qu’on dit ? Qu’est-ce qu’une coupe, un montage poétique, un montage cinématographique ? Comment restituer, reconstituer un mouvement non-narratif et un rythme avec des images ? Comment reproduire un événement catastrophique dans le mouvement du cinéma ? Comment opérer des effets de translation au cinéma ? Comment établir les principes d’une co-errance au cinéma ? Comment évaluer le rapport paysage/visage ? Comment rendre compte d’un événement catastrophique sans privilégier des accidents ? Ce voyage a aussi pour but de mettre à l’épreuve de la représentation en vidéo des concepts utilisés jusque-là en peinture et en écriture : le modèle, le discontinu narratif, l’énoncé, le fragment, l’intonation, la conjugaison, les connexions, la circulation, etc.
Sébastien Zaegel : Je n’ai pu assister qu’au Film des questions, et dispose donc de cette seule ressource pour m’exemplifier ce que tu dis de cette « frontière intérieure » entre poésie et cinéma. Je la vois bien dans le livre, avec cette alternance de phrases déclaratives en charge d’un discours systématiquement rapporté (« on dit », « il a été établi », « le fait est ») – le récit d’un crime équivaudrait donc toujours à la reconstitution de celui-ci –, et la mise en question de la possibilité de mettre en image. Or, à cette possibilité questionnée de faire image, répond l’impossibilité – affirmée à plusieurs reprises dans le texte – de faire la lumière sur l’énigme de l’événement « pré-texte » : ce trajet meurtrier, le 10 mars 2009, d’un tireur fou sur une portion de route d’Alabama. Tu parles, d’ailleurs, de la lumière comme d’une composante élémentaire de l’image – liée à ces phénomènes polysémiques de révélation et de réflexion – parmi toute cette déclinaison que tu fais des éléments qui lui sont constitutifs ou afférents, et qui ensemble forment un film : l’œil, la caméra, la visée de l’objectif, le cadre, le montage. Un film dont tu examines chacun des paramètres par les moyens de la poésie : la « question du langage » / le langage « en question ».
Le livre est alors bel et bien cette zone frontalière de co-errance. Quant au film, à la « question du film », elle me semble porter sur ce que l’événement inscrit dans le paysage : quelle trace la fugacité d’un accident, d’une catastrophe, laisse-t-elle au sein de cette permanence ? Ce paysage dont tu te demandes s’il « a existé de toute éternité, avec ces crimes à venir ». Au moyen d’une coexistence entre ces deux temporalités – la permanence et l’événement – il s’agit donc, là encore, de reconstituer des scènes de crime – fussent-elles potentielles : de procéder à une investigation poétique. C’est alors qu’intervient selon moi le montage comme mode opératoire. L’analyse qu’en propose Pasolini, et cet usage que tu en fais a contrario.
Il y a en effet une puissance ordonnatrice de la mort – le trajet en voiture du meurtrier traçant une ligne dans le « chaos de possibilités » du paysage, déterminant une durée et donnant une direction au film. Cette durée et cette direction devaient se traduire, dans le dispositif de captation que tu imaginais, par un traveling en plan-séquence : le paysage étant filmé depuis une voiture effectuant ce même trajet. Donc, aboutir, paradoxalement, à un film sans montage. Or, tu as finalement choisi d’utiliser la fonction Google Street View. Qui procède, au contraire, par montages feuilletés d’images. Produisant, sur la durée du parcours, une permanence factice, sans continuité temporelle. Nous traversons des images prises dans une chronologie éclatée, et truffée « d’accidents » qui sont autant de micro-évènements : brusques changements climatologiques, passage d’une saison à l’autre, sans compter les distorsions de perspective, les mouvements par à-coups et la pixellisation. Une fonction dont le principe est, du reste, adossé au fantasme du tout voir, donc tout savoir. Une carte à l’échelle 1/1, qui serait en même temps un « œil-caméra ».
Ma question est donc la suivante : en quoi ce choix de matériaux pour ton film réexamine cette série de questions que tu poses dans le livre : « Où est l’événement dans les images qu’on capture ? (…) Quand advient-il, l’événement, dans les images une fois saisies, le paysage tranché ? Quand advient-il, l’événement, dans les images une fois saisies, le paysage absorbé par le regard à travers l’objectif de la caméra ? » ?
Frank Smith : Je préférerais ne pas, ne pas posséder une habitude convenable. Je préférerais rester dans un milieu où aucune réponse ne sera en mesure de répondre au problème posé. Chaque question formulée affecte mais ne s’intègre pas forcément. Gilles Deleuze définit l’événement comme une surface, quelque chose qui se déploie indépendamment de toute profondeur, suspendue, non redevable d’un commencement ou d’une terminaison. Epuiser, épuiser les totalités d’une variation, épuiser les possibles en tant que réponses supposées justes face aux crimes. Une manière de déployer cette distraction. « Quand une personne meurt – dit Georges Didi-Huberman à propos de La Rabbia, le film de Pasolini – avec sa vie, on a presque tout perdu. On a perdu les milliers d’actes et de paroles que cette personne aurait encore pu émettre. Ses amis se réunissent alors, et il est question d’une forme de survivance, du style même de cette forme, à travers ce que l’on appelle un éloge funèbre. Pour Pasolini, cette forme c’est le montage. Le montage a à voir avec quelque chose de vivant » (…) Le montage c’est Dionysos : celui qui est coupé en morceaux comme les rushs d’un film et celui qui, au-delà de cette opération de découpage, se met à danser – comme un film bien monté danse ». Le Film des questions veut dire. Le Film des questions veut dire, veut dire trouver ce qui a eu lieu. Le Film des questions veut mettre en œuvre, veut faire état d’urgence où toutes choses réapparaîtraient sous une forme jusque-là inaperçue. Ce qui est exponentiellement possible dans la réalité. Ce qui reste.
Jean-Philippe Cazier : Dans Euréka apparaissent sur l’écran les mots « un rapport vivant, élastique ». Est-ce que cela pourrait servir de définition de la façon dont tu traites dans tes films le rapport entre l’image vue et le texte ? Est-ce que tu dirais que cette proposition pourrait aussi valoir pour le rapport au monde que tes films – mais aussi tes livres – impliquent ? Etablir avec le monde un rapport vivant et élastique par lequel le monde devient multiple, discontinu, hétérogène, ainsi que celui – peut-on encore dire « celui » ? – qui s’y rapporte ?
Frank Smith : De quoi est-il question, selon une telle perspective texte sur images ? Dans Eureka, un film se donne à voir, il se rend disponible sous les yeux des spectateurs. Il y est question d’une masse de gens – les Américains –, d’un territoire – celui de la ville californienne –, d’une liaison entre un homme et une femme – une histoire dont on ne sait si elle a lieu, a eu lieu ou aura lieu. Parallèlement, il n’y a rien à entendre – le film est muet – et il n’y a rien à voir car, comme le dit Georges Didi-Huberman : « il n’y a jamais personne sur aucune photographie ». La persona non grata est cette personne que l’on refoule, que l’on rejette hors des frontières. C’est en ce sens que l’expression « hors-champ » est ici adéquate : dans ce qu’on fait, on ne pense jamais assez à ce qu’on ne voit pas, à ce qu’on n’entend pas, on ne pense jamais assez à ce qu’on ne connaît pas. À ce qui se trame en dehors de la sphère d’intervention ou d’investigation. À ce qui est transformé par ce qu’on choisit de ne pas représenter. Une image nie autant qu’elle affirme, elle n’est pas faite seulement de ce qu’elle montre ou croit vouloir montrer, mais de ce qu’elle exclut. Dans le langage courant, dire d’un individu qu’il est non grata revient à l’ostraciser. À l’exclure, donc. Il s’agit de ré-inclure, de ré-agencer pour, oui, tendre un élastique entre les choses et les gens. Remplir les vacuoles de vide entre ce qui ne se parle pas, ne se voit pas, ne s’entend pas. Quant à « celui » dont tu parles, le langage est toujours le sujet, ce qui compte c’est juste la coexistence de tous les circuits mis en place, chacun avec un présent. Un présent où c’est déjà fait, un présent où c’est pas encore fait, un présent où c’est en train de se faire. Il sera toujours temps d’aller voir autre part : « D’ailleurs, il n’y a rien à voir là-dedans », comme l’écrit Rimbaud.
EUREKA un film de Frank Smith 2009 • vidéo numérique • 35’
Sébastien Zaegel : De cette « masse de gens » – les Américains – s’engendre « le tueur en masse » dont Le Film des questions retrace l’itinéraire. Et s’il n’y a rien à entendre dans Eureka, je sais que tes travaux actuels abordent la question de la prise de parole collective et de la polyphonie de foule. Ce que tu appelles, dans Chœurs politiques, ton texte en cours, la « langue démocratique ». Or, corolairement – peut-être –, l’entité que tu désignes encore dans Le Film des questions comme les « people » est devenue « le peuple » dans tes derniers écrits. Qu’implique cette substitution ?
Frank Smith : Cette substitution erre de la masse à la foule et de la foule aux peuples — il y a toujours non un mais des peuples. Oui, vient enfin le moment d’errer. Et pour moi le moment de le nommer, de le défendre, de le reconstituer non par respect, nostalgie ou compassion, mais par souci de l’autre. Non pas comme Œdipe, pauvre roi sans sceptre, aveugle intérieurement illuminé, mais d’errer dans la fête sombre de l’anarchie. On peut désormais penser « la différence » ET « la répétition ». C’est-à-dire – au lieu de se les représenter – les faire et les jouer. « La pensée au sommet de son intensité sera elle-même différence et répétition ; elle fera différer ce que la représentation cherchait à rassembler ; elle jouera l’indéfinie répétition dont la métaphysique entêtée cherchait l’origine » (Gilles Deleuze). Ne plus se demander : différence entre quoi et quoi? Différence délimitant quelles espèces et partageant quelle grande unité initiale ? Ne plus se demander : répétition de quoi, de quel événement ou de quel modèle premier ? Mais penser la ressemblance, l’analogie ou l’identité comme autant de moyens de recouvrir la différence et la différence des différences. Penser la répétition, sans origine de quoi que ce soit, et sans réapparition de la même chose, par le cinéma et par la poésie. Et bientôt par le théâtre. Le théâtre où se jouent les différences de maintenant. Fin de la représentation, le théâtre de maintenant.
Jean-Philippe Cazier : Dans Le vent, le vent, en particulier, tu construis des images qui tendent vers l’abstraction ou en tout cas qui transforment ce qui est filmé en une sorte de matière abstraite mais qui devient par-là étrangement vivante. Les paysages sont transformés en surface plane, étagée, où les éléments se juxtaposent comme des couches sédimentées et hétérogènes. Le paysage n’est plus rassemblé en une unité signifiante par et pour l’œil d’un observateur. Il devient un ensemble de matières et de mouvements, son hétérogénéité est libérée et marque la vie du monde comme celle du film. Tu filmes alors moins des paysages que des mouvements, des devenirs, toute une multiplicité qui n’est pas spontanément vue mais qui constitue l’image. L’image est une vie du monde qui est ce qui est créé et vu par l’image. On retrouve la même logique esthétique dans tes deux autres films, et de manière particulièrement originale dans Le Film des questions, où ce qui est vu est surtout fait d’images mobiles extraites de Google earth et par lesquelles le paysage s’anime d’un mouvement interne incessant : les images sont traversées de pixels mobiles, elles sautent brusquement d’un moment de la journée à un autre, d’un état de la lumière à un autre, les éléments du paysage se juxtaposent, se dédoublent, se déchirent, etc. Les accidents qui font partie des images de Google earth rejoignent la logique qui est celle de tes deux autres films : une logique de la vie, de l’hétérogénéité, du mouvement. Est-ce que c’est ça qui t’intéresse dans ce que tu filmes, la vie plutôt que les choses, les devenirs plutôt que les identités ? Il me semble que dans Le vent, le vent, mais aussi dans les deux autres, tu fais subir au langage le même traitement : le texte d’Hocquard, très littéraire et dense, qui est lu en voix off, semble à la fois être dit et dispersé, désagrégé par la voix d’Emmanuelle Riva qui en déroule le contenu. Le temps qui est celui de la lecture, la durée qui est celle du texte dit, font que celui-ci, en même temps qu’il est dit, au fur et à mesure que la lecture avance, est oublié, perdu pour la mémoire, disparaissant dans un vide qui l’absorbe et le disloque – comme si, justement, le texte était lui aussi soumis au principe du vent et de la dispersion, qui est le principe de la vie : apparition, transformation, mobilité, disparition. Il s’agirait de faire sortir la langue de son unité, de son appartenance à un supposé sujet pour, comme dans le cas du paysage, en libérer la nature mobile et vivante.
Frank Smith : Le vent, le vent, c’est opérer : une disjonction hori/verti et dire/voir, enchaîner les actuels – le réel – de l’Ouest américain dans sa banalité la plus crue, casser le rapport vertical du pouvoir de l’image cinématographique. Une pratique du riz à travers laquelle la caméra se plante dans le sol ici et là sans s’y enfoncer pour capturer la surface du réel plat américain, retirer l’or de la ruée vers l’Ouest.
Après avoir réalisé Le vent, le vent, qui s’attachait à filmer le vent, c’est-à-dire rien, le rien et le vide, après avoir réalisé Eureka, filmé dans la ville d’Eureka, au nord de San Francisco, qui, après le rien, avait comme fonction de filmer le tout, c’est-à-dire la masse du peuple américain saisie au hasard d’une petite localité banale de Californie, l’idée était de filmer l’entre-deux, l’intervalle qui bouge entre le rien et le tout, entre le vide et le plein, filmer un paysage en Alabama dans lequel un tueur en série, le mardi 10 mars 2009, a assassiné 10 personnes avant de mettre fin à ses jours, entre 3:30 et 4:17 de l’après-midi, le long d’un itinéraire qui court de la ville de Kinston, dans le Comté de Coffee, jusqu’à la ville de Geneva, en passant par Samson, dans le Comté de Geneva, à 25 miles de là.
Filmer des plans séquences d’un paysage en mouvement, c’est absorber des lignes, les lignes de stratifications, de segmentarités de ce paysage. Pas d’arborescence ici, même si les arbres et les forêts abondent en Alabama, mais la mise en place et en forme d’une succession de lignes qui se déroulent d’un début jusqu’à une fin totale. Ces plans forment la ligne convectrice1 du film, dans le respect de la durée des divers faits recensés au cours de cette échappée criminelle. Un premier angle de vue, comme une bordure, puis un deuxième angle qui vient se superposer au premier, puis un troisième qui vient recouvrir à son tour les deux précédents, etc. Couche de couche, chaque angle de vue affine, complète, enrichit, se juxtapose ou se fond au précédent, lignes de répartition, comme dimensions du film splitté, mais aussi ligne échappatoire ou de dislocation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant, la multiplicité se métamorphose en changeant de nature. On ne se contente pas seulement de liaisons localisables entre points et positions le long de la route, il n’y a jamais de reproduction possible. C’est plutôt une mémoire courte qui est ici rafraîchie, ou une anti-mémoire, en procédant par variation, expansion, conquête, capture, piqûre. Le Film des questions se rapporte à une carte qui doit être produite, construite, toujours démontable et connectable, renversable, modifiable, à entrées et sorties multiples. Un événement a un début et une fin, mais un paysage se meut toujours par le milieu. Le Film des questions trace et empreinte par le point médian.
Jean-Philippe Cazier : Je remarque que tes trois films sont des films d’errance. Par exemple, l’errance du tueur dans Le Film des questions. Mais le principe de l’errance est aussi présent et structurant dans les deux autres films. Il y a tout un cinéma de l’errance, une tradition de films où l’on erre, de la Nouvelle Vague à Wim Wenders, de Jim Jarmusch à Rossellini. Dans tes films, à côté d’images fixes, la caméra est souvent embarquée dans une voiture ou sur un bateau, ou portée à l’épaule, et ce que l’on voit c’est ce qui est capté au cours de son déplacement. Ou bien elle filme des mouvements : carrefours, voitures, camions, éoliennes, vagues, etc. Ou encore d’autres types de mouvements : un feu de signalisation qui s’allume et s’éteint, un paysage qui devient son reflet sur l’arrière d’un camion en mouvement, etc. Dans Le Film des questions, ce qui est vu est un travelling avant qui s’étend quasiment tout au long de la durée du film. Habituellement, l’errance dans les films est celle d’un personnage qui ne maîtrise pas le monde, qui s’inscrit au contraire dans les mouvements du monde et s’y laisse porter. Cette errance du personnage est ainsi, surtout, celle du monde qui devient un ensemble de mouvements d’errance, aberrants, acentrés. Il me semble que dans tes films on retrouve tout cela, sauf qu’il n’y a pas de personnages, l’errance de la caméra étant celle du monde lui-même, comme elle est celle du film. Cette errance comme forme générale ou principe produit non pas un personnage dans un monde en mouvement, mais des films où ce qui importe c’est que le monde ne soit pas un lieu où errer mais devienne lui-même errant pour un regard qui n’est plus celui d’un sujet, un regard impersonnel, anonyme, qui n’appartient plus à une subjectivité. Il me semble que si tes films sont des films d’errance, c’est parce qu’il s’agit de délier le monde de toute maîtrise par un sujet, en vue d’une action, et de le laisser être dans sa mobilité vitale, dans son hétérogénéité, son absence de sens, qui est autant une absence de Dieu. Des films de vent pour un monde de vent. L’errance serait ainsi ce qui permet de produire un autre rapport au monde, « vivant et élastique », jamais arrêté dans une forme déterminée et fixe, par lequel le monde, purement visible, sensible, ne serait que temps et mouvement, hétérogénéité et devenir. Le monde comme co-errance plutôt que cohérence…
Frank Smith : Oui, une fixation non fixe sur la question de l’errance. On sait que ça marche bien aux Etats-Unis, cette question. Et se demander si on peut encore croire au monde. Toute occurrence de la vie a tendance à nous apparaître aujourd’hui pour ce qu’elle est — un cliché. On oscille entre le déjà-vu et l’événement nu, car on ne sait pas faire autrement que de continuer à pratiquer ces schémas qui n’assurent pourtant plus leur fonction. Savons-nous accorder de la réalité aux événements comme tels, indépendamment d’un plan d’avenir qui leur assigne un degré et une signification ou d’un jugement rétrospectif qui les évalue d’après leurs débouchés ? On veut toujours qu’un événement ait une fin, alors qu’il s’agit d’abord d’une rupture, d’une mutation de la perception collective. Croire au monde, c’est croire à la réalité de ses ruptures, voir comment l’événement se perpétue, balbutie, se met en suspens. Chaque question comme une bifurcation, une déviation, une prolifération devant la route qui se jette droite devant nous, catastrophe voulant dire bifurcation. Des spécimens, des échantillons de faits qui sont modulés dans les intervalles des images.
LE VENT, LE VENT un film de Frank Smith, 2006 • 33′ • Vidéo numérique
Jean-Philippe Cazier : Une autre chose qui m’a frappé est que tes images ne renvoient pas à un regard. Ce qui est vu n’est pas supposé être vu par quelqu’un puisque tu ne filmes pas du point de vue d’un personnage – il n’y a pas de personnages dans tes films –, ni même en caméra subjective. Ce qui est vu est vu par la caméra mais n’est pas une vision mécanique, si l’on peut dire. Tes images sont non pas des choses vues mais des visibilités, ce qui t’intéresse c’est moins le regard que le visible. Les paysages naturels ou urbains, les gens que tu filmes ne sont pas vus, c’est-à-dire vus par quelqu’un, mais sont visibles. On n’est plus dans l’image supposée représenter quelque chose ou le point de vue de quelqu’un. Sont produits des points de vue à l’intérieur d’un pur visible, un monde non humain pour un œil non humain, un œil qui n’est pas un œil, justement, mais un principe de visibilité pour le visible du monde. Je ne sais pas si c’est clair ce que je dis… En tout cas, il me semble que c’est par ce régime de l’image que le monde peut être arraché au regard unificateur d’un sujet, à un regard qui donne du sens et de l’identité, pour filmer au contraire le monde d’une manière asubjective qui s’installe à l’intérieur de la vie du monde et non dans la tête d’un sujet. Ceci est frappant dans tes deux premiers films et surtout dans le dernier, Le film des questions, où le visible n’est pas à la lettre filmé puisqu’il est prélevé sur Google earth, sans point de vue élaboré par toi en tant que cinéaste mais simplement donné comme visibilité du monde à travers un processus anonyme. C’est cet anonymat du point de vue, cette installation dans le visible qui permet de voir, à travers ces images, la vie du monde, la multiplicité du monde, son étrangeté, son hétérogénéité mobile, c’est-à-dire le temps vivant qui fait que l’être n’est pas mais devient sans cesse. Je pense là, aussi, à un plan qui est je crois au début d’Euréka, où la route est filmée de nuit, la caméra étant dans la voiture, la route étant filmée ainsi, telle qu’elle se déroule, en suivant les zig zag du trajet, le paysage apparaissant et disparaissant dans la lumière des phares, dans l’obscurité. Je crois que c’est une image emblématique de ton travail…
Frank Smith : Comment se glisser dans l’épaisseur de ce qu’on dit, de ce qu’on voit ? D’où pour moi le désir de porter le on à l’écrit, à l’écran : « Il a été établi que », « Le fait est que », « On dit que ». Le Film des questions porte cette conception-là. C’est la société en ses pouvoirs multiples et dans les coercitions qu’elle exerce qui nous fait voir et qui nous fait parler. Contre cet étranglement, le on nous rejette en pleine mer.
Le Film des questions, à savoir l’abandon du centre vertical et l’abandon du monde solide. Des mouvements mécaniques, tout ça c’est absolument lié. Se placer sur un faisceau énergétique. Il n’y a plus du tout de privilège de la verticalité. Au contraire, c’est des prises de positions antiverticales. Deux caractères, entre autres, d’une modernité possible : l’abandon de l’axe de verticalité et l’abandon du modèle solide au profit de faisceaux énergétiques. Si je dis ça, c’est une espèce de manière de s’approcher, de vivre, le système des images-mouvement qui ne cessent de varier les unes par rapport aux autres – sur toutes leurs faces et dans toutes leurs dimensions et depuis toutes leurs origines, Google en l’occurrence. Et se pose la question de la qualité de l’image, et se pose la question de l’auteur de l’image, et se pose la question du mouvement à l’intérieur de cette série d’images low cost, universellement usurpées.
Je pars encore une fois d’un événement catastrophique et je le traite par des moyens poético-cinématographiques. Dans Le Film des questions, on en reste à la surface des choses banales, y compris dans leur potentiel catastrophique, à la surface du paysage. On épuise, on épuise la totalité d’une variation d’images sales, puisées dans Google Earth, on épuise les possibles en tant que réponse supposée. Une manière de ne pas préférer, de déployer une distraction par rapport à un événement. Je ne fabrique pas mes images, je les prélève, je les emprunte. Je me pose sur des images existantes dans une combinaison matière-mouvement autre. Ce serait aussi une autre façon de penser, si humble ?
Sébastien Zaegel : À travers ce décentrement du sujet, pris dans le faisceau énergétique de l’image-mouvement et dans l’indiscernabilité énonciative – asubjective – du « on », la question des affects revient à plusieurs reprises dans le texte : visage inexpressif du tueur, possibilité – en question – d’un « paysage état d’âme », la question de savoir ce que l’« on » fait de la douleur des protagonistes de ce fait divers, etc. À quoi pourrait-on – peut-être ? – rajouter l’usage de la musique lors de la projection, et sa capacité à susciter une dynamique affective chez l’auditeur. Quel est le statut de ce reliquat affectif dans un dispositif qui tend à l’impersonnalisation ? Autrement dit, et c’est une question qui rejoint l’actualité immédiate : comment traites-tu, par ces moyens poético-cinématographiques, l’« émotion collective » provoquée par l’événement catastrophique ? Quel est ton positionnement formel vis-à-vis de cette composante intrinsèque de ce qui est vécu collectivement comme une catastrophe ?
Frank Smith : Tout est question d’intensité. Je cherche à minimiser la teneur en subjectivation, même si c’est impossible. C’est ce que m’ont appris les poètes objectivistes. Donc les affects, oui, mais à petite dose. Quant à la catastrophe, elle ne cesse de nous assaillir. Et comme dit Didi-Huberman : « Ce n’est pas la même chose, en effet, de commémorer une catastrophe passée dans les pompes consensuelles des ‘lieux de mémoire’, et de se remémorer une catastrophe passée pour éclairer la situation présente sous l’angle des incendies à venir ». Je redis à mon compte : voir, pour savoir, pour prévoir.
Jean-Philippe Cazier : Le film intitulé Le Film des questions, que tu as présenté pour la première fois au Centre Pompidou l’autre soir, a été précédé d’un livre également intitulé Le Film des questions, paru en 2014. Dans ce livre, le film est présent mais en tant que virtuel : un film réel mais virtuel, un film non pas à faire, un film possible, à venir, mais existant dans le présent du livre en tant que virtuel. A la lecture, je me demandais comment tu allais t’y prendre au cas où tu réaliserais effectivement ce film. Et l’autre soir j’ai vu la solution très inventive que tu as trouvée pour conserver cet état virtuel du film. Tu n’as pas tourné ce film en te servant du livre comme d’une espèce de scénario mais tu as construit un agencement audio-visuel où s’intègrent les images extraites de Google Earth, le texte du livre, les images que tu as filmées des acteurs lisant ton livre, mais aussi les deux acteurs présents dans la salle et lisant en direct le livre, ainsi que Philippe Langlois interprétant au piano, en live, sa partition magnifique. Cet agencement fait tenir ensemble tous ces éléments autant qu’il les disjoint, et il me semble qu’il est la réalisation radicale de ce que tu avais déjà mis en place dans les autres films où effectivement tu abordes le cinéma, le film, comme un agencement audio-visuel. Il me semble que la séance de l’autre soir est le plus évident de ce que tu fais dans le cinéma, puisque tes films sont des agencements audio-visuels, où il s’agit de penser le rapport entre l’audio et le visuel mais aussi la différence, de produire un rapport qui à la fois existe et est nié, n’est jamais de l’ordre de la coïncidence, existe en n’étant pas. Ce qu’ajoutait la séance de l’autre soir est la dimension immersive : les spectateurs n’étaient pas seulement face à un écran mais étaient immergés dans quelque chose d’inédit, en tout cas pour moi, à la limite entre le cinéma, la lecture, le théâtre, la musique, et qui se déplaçait le long de ces limites – là encore, il s’agirait d’errance – tout en maintenant du début à la fin ces limites. Donc, au lieu de faire un film à partir du Film des questions, tu as fait cet agencement audio-visuel qui vaut aussi, me semble-t-il pour le monde et le rapport au monde tels qu’ils sont impliqués par ton travail : un monde audio-visuel où les écarts ne se résorbent pas, où l’hétérogénéité existe pour elle-même, où rien ne vient unifier et étouffer la multiplicité vivante du monde. L’autre soir tu as proposé une expérience de cette multiplicité qui était très forte…
Entretien réalisé le 30/01/15
///////////////////// Autres documents
Poème dramatique pour voix
[Extraits]
par Frank Smith
Lecture de Gaza, d’ici-là par Frank Smith – Entretien avec l’auteur – Texte de Jean-Philippe Cazier.
Une intervention radiophonique d’Ossama Mohammed à propos du film Eau argentée, Syrie autoportrait, un film d’Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan & Mille et un Syriens
Border, France/ UK, 2004
27 min. Digibeta PAL, Colour, Stereo
Directed, Produced, Written, Camera, Edited Laura Waddington
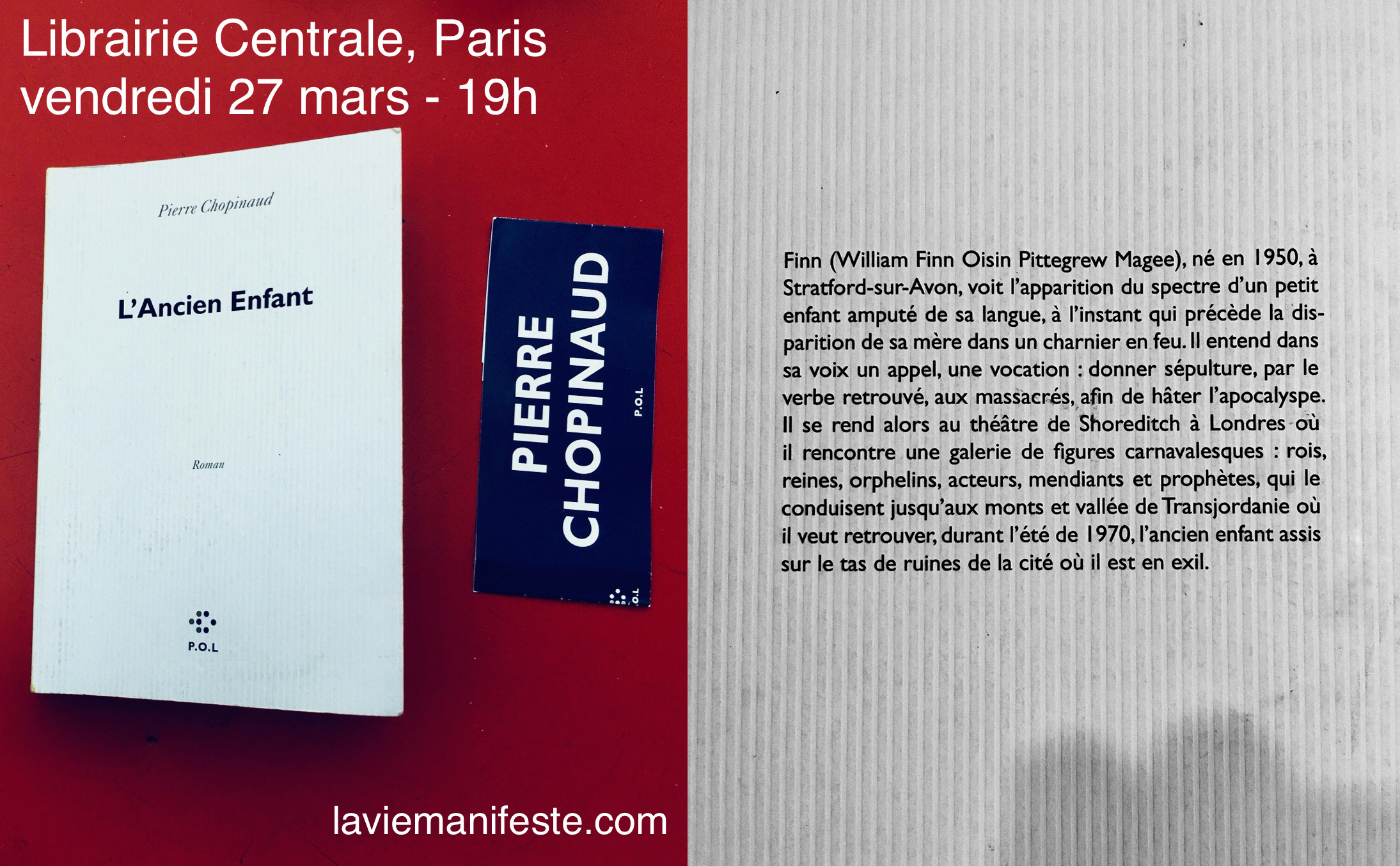

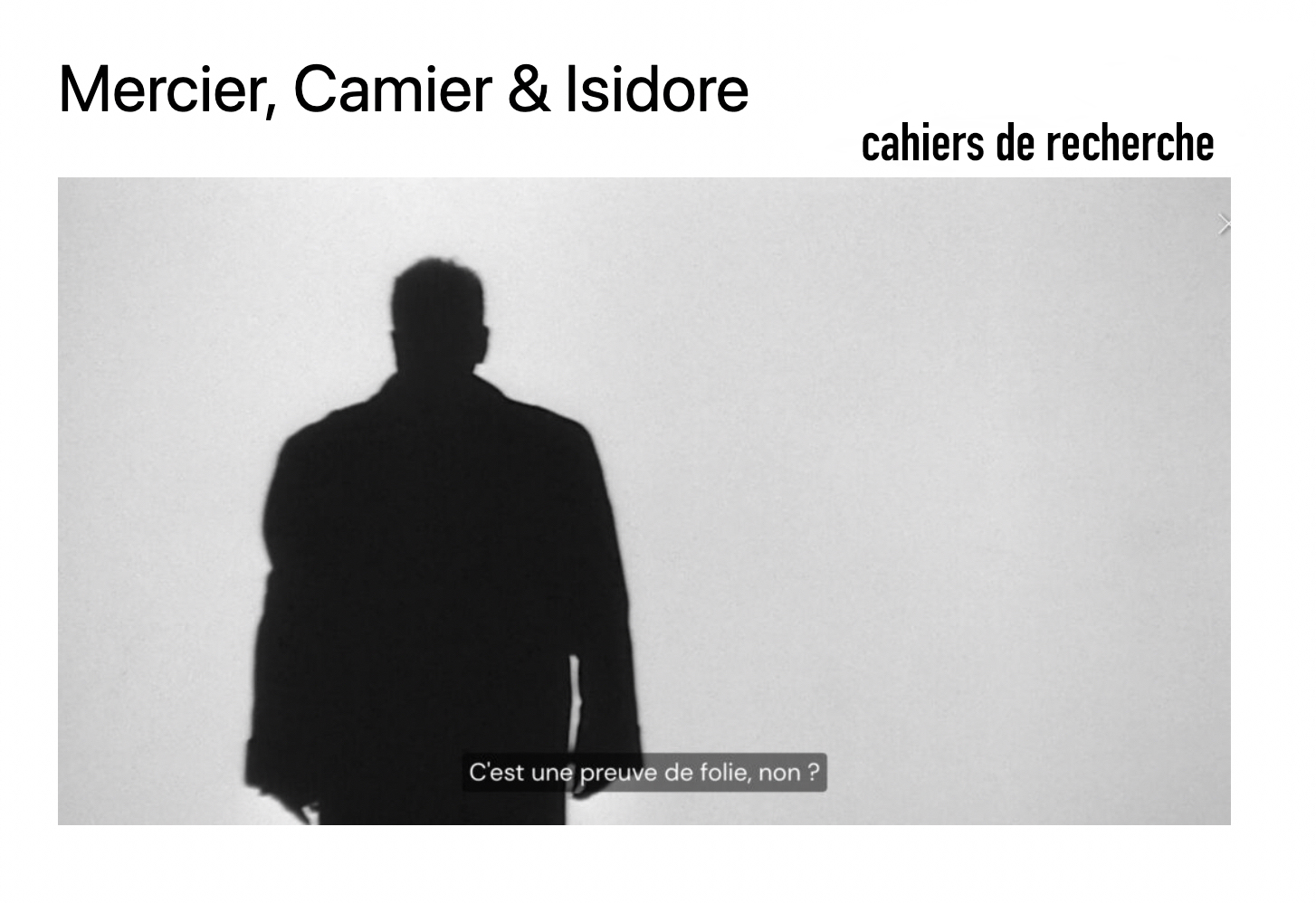



Filmer/Ecrire – Vient enfin le moment d’errer
Frank Smith, Sébastien Zaegel, Jean-Philippe Cazier
Jean-Philippe Cazier : Les trois films que tu as réalisés ont été projetés au Centre Beaubourg le 24 janvier dernier : Le vent, le vent, Eureka, et Le Film des questions. Je n’avais pas vu tes films et j’ai découvert les trois à la suite. Deux questions un peu générales pour commencer. Quels rapports établis-tu entre ton travail d’écrivain et celui de cinéaste ? D’autre part, si je faisais une généalogie un peu rapide, je rattacherais spontanément tes films à ceux de Duras ou de Straub et Huillet. On y retrouve de manière évidente ce qui signe leurs œuvres : disjonction, qui ne veut pas dire indépendance, entre l’image et le son en off, recours aux plans fixes, utilisation de textes très écrits, très littéraires, une certaine fascination pour les paysages, les matières naturelles mais aussi urbaines ou technologiques filmées de manière à les rendre autonomes et énigmatiques, etc. Si je pense à Duras, c’est aussi, sans doute, à cause du fait que dans Le vent, le vent, c’est Emmanuelle Riva, l’héroïne d’Hiroshima mon amour, qui dit en off un texte d’Emmanuel Hocquard aux tournures également très durassiennes. Il y a aussi dans Le Film des questions le fait que tu filmes les deux acteurs en train de lire le texte du film, comme Duras dans Le camion, avec Depardieu. En regardant Le Film des questions et le travelling qui avance sur une route du Névada par Alabama pendant quasiment toute la durée du film, on pourrait aussi penser à certains plans de Resnais…
Frank Smith : Je ne me considère pas comme un cinéaste. Je cherche comment des idées en poésie peuvent s’appliquer en cinéma. Et je cherche comment les ressources propres au cinéma peuvent être réévaluées par les forces du poétique. Je décide de faire un film quand je me rends compte avoir atteint des limites indépassables pour moi à l’écrit et que je peux transférer/rattraper vers le cinéma avec d’autres moyens. Le mode opératoire est ici constitué des différentes matières élaborées pour le besoin d’un film – images / textes / sons –, à la fois expurgées de toute intention d’énonciation et redéployées, jetées à nouveau ensemble. Les composants du film sont appelés à se reconfigurer, à flotter de concert. Et réciproquement. C’est cette frontière entre film et livre qui fait l’objet d’une exploration désormais. Quand il est question de frontière, comme l’indique Judith Butler, on désigne, par voie de conséquence, les actions de séparer, de défendre, de secourir voire de cohabiter. Des agrégats sensibles, donc, qui flottent de conserve, qui s’associent, s’escortent les uns par rapport aux autres dans un souci de protection, sous la forme d’un film-livre. On pourrait dire aussi que ces mêmes matières serviraient à révéler ce que l’on est en train de dire ― la langue ne pouvant jamais dire que ce qu’elle est.
Un livre = un film = un livre. Eureka est devenu un journal après avoir été un film et Le Film des questions un film après avoir été un livre. Mais on ne sait pas où est le film, on ne sait pas où est le livre. La frontière ne s’ouvre pas entre les matériaux rassemblés et le dehors, l’outside, mais dans leur for intérieur, comme des forces constitutives qui se tendent. Dans ce projet de collision, la frontière livre / film sort de ses gonds ou est contournée. Sait-on jamais si l’on dispose de tous les documents nécessaires pour pouvoir franchir le check-point, négocier le passage avec les gardes-frontière ? On a prélevé et recyclé, on a détourné, on a reformulé, on a réagencé, on a répliqué. Une dé-médiation mise en place pour une re-médiation en surplomb. Enquête, éclaircissement pour voir ce que ça donne. Une résolution, ce que fait la poésie – ailleurs. Ce que ça donnerait. Un usage autre et différent depuis les mêmes opérandes.
Pour ce qui est des références dont tu parles, Duras et les Straub, bien entendu, mais aussi James Benning, Chantal Akerman, et Pasolini. Duras pour son inventivité totale entre littérature et cinéma. Les Straub pour leur force politique. Benning pour son art de la découpe du réel américain. Akerman pour les condensations de sens qu’elle produit aussi bien dans ses films de fiction que ses propositions de type plus documentaire, même si la question des genres n’est plus recevable aujourd’hui. Il faudrait citer Godard, bien entendu. Pasolini pour ses réflexions sur le concept de montage en poésie et au cinéma. Cette conception du montage comme opération signifiante a pour lui des implications philosophiques et esthétiques : il estime que « le montage effectue sur le matériau du film la même opération que la mort accomplit sur la vie », la mort elle-même opérant selon lui « un fulgurant montage de notre vie » ; c’est elle qui donne un sens à la vie, qui ordonne ce « chaos de possibilités » qu’était l’existence humaine tant qu’elle avait encore un futur. Ainsi, le montage est créateur de sens parce qu’il permet non seulement de reconstruire une totalité synthétique mais surtout parce qu’il permet d’isoler des fragments de la réalité — corps, visages, paysages — qu’il investit d’une « dimension sacrale » en les séparant du reste de la représentation.
Ces sont ces artistes-là en particulier qui me permettent de réfléchir aux différents types d’opérations à mettre en place. Je les redéploie dans le champ de l’image et du cinéma afin de réaliser ce que j’appelle des « ciné-poésies ». Quels dispositifs mettre en place en cinéma, quelle cause commune avec les opérations de Documenter ; Dupliquer/Translater ; Objectiver ; Neutraliser ; Dépersonnaliser ; Désécrire ; Co-errer ; Chercher/trouver ; Ouvrir ? L’idée motrice de ces réalisations est de translater des idées de poésie en des idées de cinéma. Mes questionnements sont par exemple les suivants : Qu’est-ce que dire et voir sachant qu’on ne peut pas dire ce qu’on voit ni voir ce qu’on dit ? Qu’est-ce qu’une coupe, un montage poétique, un montage cinématographique ? Comment restituer, reconstituer un mouvement non-narratif et un rythme avec des images ? Comment reproduire un événement catastrophique dans le mouvement du cinéma ? Comment opérer des effets de translation au cinéma ? Comment établir les principes d’une co-errance au cinéma ? Comment évaluer le rapport paysage/visage ? Comment rendre compte d’un événement catastrophique sans privilégier des accidents ? Ce voyage a aussi pour but de mettre à l’épreuve de la représentation en vidéo des concepts utilisés jusque-là en peinture et en écriture : le modèle, le discontinu narratif, l’énoncé, le fragment, l’intonation, la conjugaison, les connexions, la circulation, etc.
Sébastien Zaegel : Je n’ai pu assister qu’au Film des questions, et dispose donc de cette seule ressource pour m’exemplifier ce que tu dis de cette « frontière intérieure » entre poésie et cinéma. Je la vois bien dans le livre, avec cette alternance de phrases déclaratives en charge d’un discours systématiquement rapporté (« on dit », « il a été établi », « le fait est ») – le récit d’un crime équivaudrait donc toujours à la reconstitution de celui-ci –, et la mise en question de la possibilité de mettre en image. Or, à cette possibilité questionnée de faire image, répond l’impossibilité – affirmée à plusieurs reprises dans le texte – de faire la lumière sur l’énigme de l’événement « pré-texte » : ce trajet meurtrier, le 10 mars 2009, d’un tireur fou sur une portion de route d’Alabama. Tu parles, d’ailleurs, de la lumière comme d’une composante élémentaire de l’image – liée à ces phénomènes polysémiques de révélation et de réflexion – parmi toute cette déclinaison que tu fais des éléments qui lui sont constitutifs ou afférents, et qui ensemble forment un film : l’œil, la caméra, la visée de l’objectif, le cadre, le montage. Un film dont tu examines chacun des paramètres par les moyens de la poésie : la « question du langage » / le langage « en question ».
Le livre est alors bel et bien cette zone frontalière de co-errance. Quant au film, à la « question du film », elle me semble porter sur ce que l’événement inscrit dans le paysage : quelle trace la fugacité d’un accident, d’une catastrophe, laisse-t-elle au sein de cette permanence ? Ce paysage dont tu te demandes s’il « a existé de toute éternité, avec ces crimes à venir ». Au moyen d’une coexistence entre ces deux temporalités – la permanence et l’événement – il s’agit donc, là encore, de reconstituer des scènes de crime – fussent-elles potentielles : de procéder à une investigation poétique. C’est alors qu’intervient selon moi le montage comme mode opératoire. L’analyse qu’en propose Pasolini, et cet usage que tu en fais a contrario.
Il y a en effet une puissance ordonnatrice de la mort – le trajet en voiture du meurtrier traçant une ligne dans le « chaos de possibilités » du paysage, déterminant une durée et donnant une direction au film. Cette durée et cette direction devaient se traduire, dans le dispositif de captation que tu imaginais, par un traveling en plan-séquence : le paysage étant filmé depuis une voiture effectuant ce même trajet. Donc, aboutir, paradoxalement, à un film sans montage. Or, tu as finalement choisi d’utiliser la fonction Google Street View. Qui procède, au contraire, par montages feuilletés d’images. Produisant, sur la durée du parcours, une permanence factice, sans continuité temporelle. Nous traversons des images prises dans une chronologie éclatée, et truffée « d’accidents » qui sont autant de micro-évènements : brusques changements climatologiques, passage d’une saison à l’autre, sans compter les distorsions de perspective, les mouvements par à-coups et la pixellisation. Une fonction dont le principe est, du reste, adossé au fantasme du tout voir, donc tout savoir. Une carte à l’échelle 1/1, qui serait en même temps un « œil-caméra ».
Ma question est donc la suivante : en quoi ce choix de matériaux pour ton film réexamine cette série de questions que tu poses dans le livre : « Où est l’événement dans les images qu’on capture ? (…) Quand advient-il, l’événement, dans les images une fois saisies, le paysage tranché ? Quand advient-il, l’événement, dans les images une fois saisies, le paysage absorbé par le regard à travers l’objectif de la caméra ? » ?
Frank Smith : Je préférerais ne pas, ne pas posséder une habitude convenable. Je préférerais rester dans un milieu où aucune réponse ne sera en mesure de répondre au problème posé. Chaque question formulée affecte mais ne s’intègre pas forcément. Gilles Deleuze définit l’événement comme une surface, quelque chose qui se déploie indépendamment de toute profondeur, suspendue, non redevable d’un commencement ou d’une terminaison. Epuiser, épuiser les totalités d’une variation, épuiser les possibles en tant que réponses supposées justes face aux crimes. Une manière de déployer cette distraction. « Quand une personne meurt – dit Georges Didi-Huberman à propos de La Rabbia, le film de Pasolini – avec sa vie, on a presque tout perdu. On a perdu les milliers d’actes et de paroles que cette personne aurait encore pu émettre. Ses amis se réunissent alors, et il est question d’une forme de survivance, du style même de cette forme, à travers ce que l’on appelle un éloge funèbre. Pour Pasolini, cette forme c’est le montage. Le montage a à voir avec quelque chose de vivant » (…) Le montage c’est Dionysos : celui qui est coupé en morceaux comme les rushs d’un film et celui qui, au-delà de cette opération de découpage, se met à danser – comme un film bien monté danse ». Le Film des questions veut dire. Le Film des questions veut dire, veut dire trouver ce qui a eu lieu. Le Film des questions veut mettre en œuvre, veut faire état d’urgence où toutes choses réapparaîtraient sous une forme jusque-là inaperçue. Ce qui est exponentiellement possible dans la réalité. Ce qui reste.
Jean-Philippe Cazier : Dans Euréka apparaissent sur l’écran les mots « un rapport vivant, élastique ». Est-ce que cela pourrait servir de définition de la façon dont tu traites dans tes films le rapport entre l’image vue et le texte ? Est-ce que tu dirais que cette proposition pourrait aussi valoir pour le rapport au monde que tes films – mais aussi tes livres – impliquent ? Etablir avec le monde un rapport vivant et élastique par lequel le monde devient multiple, discontinu, hétérogène, ainsi que celui – peut-on encore dire « celui » ? – qui s’y rapporte ?
Frank Smith : De quoi est-il question, selon une telle perspective texte sur images ? Dans Eureka, un film se donne à voir, il se rend disponible sous les yeux des spectateurs. Il y est question d’une masse de gens – les Américains –, d’un territoire – celui de la ville californienne –, d’une liaison entre un homme et une femme – une histoire dont on ne sait si elle a lieu, a eu lieu ou aura lieu. Parallèlement, il n’y a rien à entendre – le film est muet – et il n’y a rien à voir car, comme le dit Georges Didi-Huberman : « il n’y a jamais personne sur aucune photographie ». La persona non grata est cette personne que l’on refoule, que l’on rejette hors des frontières. C’est en ce sens que l’expression « hors-champ » est ici adéquate : dans ce qu’on fait, on ne pense jamais assez à ce qu’on ne voit pas, à ce qu’on n’entend pas, on ne pense jamais assez à ce qu’on ne connaît pas. À ce qui se trame en dehors de la sphère d’intervention ou d’investigation. À ce qui est transformé par ce qu’on choisit de ne pas représenter. Une image nie autant qu’elle affirme, elle n’est pas faite seulement de ce qu’elle montre ou croit vouloir montrer, mais de ce qu’elle exclut. Dans le langage courant, dire d’un individu qu’il est non grata revient à l’ostraciser. À l’exclure, donc. Il s’agit de ré-inclure, de ré-agencer pour, oui, tendre un élastique entre les choses et les gens. Remplir les vacuoles de vide entre ce qui ne se parle pas, ne se voit pas, ne s’entend pas. Quant à « celui » dont tu parles, le langage est toujours le sujet, ce qui compte c’est juste la coexistence de tous les circuits mis en place, chacun avec un présent. Un présent où c’est déjà fait, un présent où c’est pas encore fait, un présent où c’est en train de se faire. Il sera toujours temps d’aller voir autre part : « D’ailleurs, il n’y a rien à voir là-dedans », comme l’écrit Rimbaud.
EUREKA un film de Frank Smith 2009 • vidéo numérique • 35’
Sébastien Zaegel : De cette « masse de gens » – les Américains – s’engendre « le tueur en masse » dont Le Film des questions retrace l’itinéraire. Et s’il n’y a rien à entendre dans Eureka, je sais que tes travaux actuels abordent la question de la prise de parole collective et de la polyphonie de foule. Ce que tu appelles, dans Chœurs politiques, ton texte en cours, la « langue démocratique ». Or, corolairement – peut-être –, l’entité que tu désignes encore dans Le Film des questions comme les « people » est devenue « le peuple » dans tes derniers écrits. Qu’implique cette substitution ?
Frank Smith : Cette substitution erre de la masse à la foule et de la foule aux peuples — il y a toujours non un mais des peuples. Oui, vient enfin le moment d’errer. Et pour moi le moment de le nommer, de le défendre, de le reconstituer non par respect, nostalgie ou compassion, mais par souci de l’autre. Non pas comme Œdipe, pauvre roi sans sceptre, aveugle intérieurement illuminé, mais d’errer dans la fête sombre de l’anarchie. On peut désormais penser « la différence » ET « la répétition ». C’est-à-dire – au lieu de se les représenter – les faire et les jouer. « La pensée au sommet de son intensité sera elle-même différence et répétition ; elle fera différer ce que la représentation cherchait à rassembler ; elle jouera l’indéfinie répétition dont la métaphysique entêtée cherchait l’origine » (Gilles Deleuze). Ne plus se demander : différence entre quoi et quoi? Différence délimitant quelles espèces et partageant quelle grande unité initiale ? Ne plus se demander : répétition de quoi, de quel événement ou de quel modèle premier ? Mais penser la ressemblance, l’analogie ou l’identité comme autant de moyens de recouvrir la différence et la différence des différences. Penser la répétition, sans origine de quoi que ce soit, et sans réapparition de la même chose, par le cinéma et par la poésie. Et bientôt par le théâtre. Le théâtre où se jouent les différences de maintenant. Fin de la représentation, le théâtre de maintenant.
Jean-Philippe Cazier : Dans Le vent, le vent, en particulier, tu construis des images qui tendent vers l’abstraction ou en tout cas qui transforment ce qui est filmé en une sorte de matière abstraite mais qui devient par-là étrangement vivante. Les paysages sont transformés en surface plane, étagée, où les éléments se juxtaposent comme des couches sédimentées et hétérogènes. Le paysage n’est plus rassemblé en une unité signifiante par et pour l’œil d’un observateur. Il devient un ensemble de matières et de mouvements, son hétérogénéité est libérée et marque la vie du monde comme celle du film. Tu filmes alors moins des paysages que des mouvements, des devenirs, toute une multiplicité qui n’est pas spontanément vue mais qui constitue l’image. L’image est une vie du monde qui est ce qui est créé et vu par l’image. On retrouve la même logique esthétique dans tes deux autres films, et de manière particulièrement originale dans Le Film des questions, où ce qui est vu est surtout fait d’images mobiles extraites de Google earth et par lesquelles le paysage s’anime d’un mouvement interne incessant : les images sont traversées de pixels mobiles, elles sautent brusquement d’un moment de la journée à un autre, d’un état de la lumière à un autre, les éléments du paysage se juxtaposent, se dédoublent, se déchirent, etc. Les accidents qui font partie des images de Google earth rejoignent la logique qui est celle de tes deux autres films : une logique de la vie, de l’hétérogénéité, du mouvement. Est-ce que c’est ça qui t’intéresse dans ce que tu filmes, la vie plutôt que les choses, les devenirs plutôt que les identités ? Il me semble que dans Le vent, le vent, mais aussi dans les deux autres, tu fais subir au langage le même traitement : le texte d’Hocquard, très littéraire et dense, qui est lu en voix off, semble à la fois être dit et dispersé, désagrégé par la voix d’Emmanuelle Riva qui en déroule le contenu. Le temps qui est celui de la lecture, la durée qui est celle du texte dit, font que celui-ci, en même temps qu’il est dit, au fur et à mesure que la lecture avance, est oublié, perdu pour la mémoire, disparaissant dans un vide qui l’absorbe et le disloque – comme si, justement, le texte était lui aussi soumis au principe du vent et de la dispersion, qui est le principe de la vie : apparition, transformation, mobilité, disparition. Il s’agirait de faire sortir la langue de son unité, de son appartenance à un supposé sujet pour, comme dans le cas du paysage, en libérer la nature mobile et vivante.
Frank Smith : Le vent, le vent, c’est opérer : une disjonction hori/verti et dire/voir, enchaîner les actuels – le réel – de l’Ouest américain dans sa banalité la plus crue, casser le rapport vertical du pouvoir de l’image cinématographique. Une pratique du riz à travers laquelle la caméra se plante dans le sol ici et là sans s’y enfoncer pour capturer la surface du réel plat américain, retirer l’or de la ruée vers l’Ouest.
Après avoir réalisé Le vent, le vent, qui s’attachait à filmer le vent, c’est-à-dire rien, le rien et le vide, après avoir réalisé Eureka, filmé dans la ville d’Eureka, au nord de San Francisco, qui, après le rien, avait comme fonction de filmer le tout, c’est-à-dire la masse du peuple américain saisie au hasard d’une petite localité banale de Californie, l’idée était de filmer l’entre-deux, l’intervalle qui bouge entre le rien et le tout, entre le vide et le plein, filmer un paysage en Alabama dans lequel un tueur en série, le mardi 10 mars 2009, a assassiné 10 personnes avant de mettre fin à ses jours, entre 3:30 et 4:17 de l’après-midi, le long d’un itinéraire qui court de la ville de Kinston, dans le Comté de Coffee, jusqu’à la ville de Geneva, en passant par Samson, dans le Comté de Geneva, à 25 miles de là.
Filmer des plans séquences d’un paysage en mouvement, c’est absorber des lignes, les lignes de stratifications, de segmentarités de ce paysage. Pas d’arborescence ici, même si les arbres et les forêts abondent en Alabama, mais la mise en place et en forme d’une succession de lignes qui se déroulent d’un début jusqu’à une fin totale. Ces plans forment la ligne convectrice1 du film, dans le respect de la durée des divers faits recensés au cours de cette échappée criminelle. Un premier angle de vue, comme une bordure, puis un deuxième angle qui vient se superposer au premier, puis un troisième qui vient recouvrir à son tour les deux précédents, etc. Couche de couche, chaque angle de vue affine, complète, enrichit, se juxtapose ou se fond au précédent, lignes de répartition, comme dimensions du film splitté, mais aussi ligne échappatoire ou de dislocation comme dimension maximale d’après laquelle, en la suivant, la multiplicité se métamorphose en changeant de nature. On ne se contente pas seulement de liaisons localisables entre points et positions le long de la route, il n’y a jamais de reproduction possible. C’est plutôt une mémoire courte qui est ici rafraîchie, ou une anti-mémoire, en procédant par variation, expansion, conquête, capture, piqûre. Le Film des questions se rapporte à une carte qui doit être produite, construite, toujours démontable et connectable, renversable, modifiable, à entrées et sorties multiples. Un événement a un début et une fin, mais un paysage se meut toujours par le milieu. Le Film des questions trace et empreinte par le point médian.
Jean-Philippe Cazier : Je remarque que tes trois films sont des films d’errance. Par exemple, l’errance du tueur dans Le Film des questions. Mais le principe de l’errance est aussi présent et structurant dans les deux autres films. Il y a tout un cinéma de l’errance, une tradition de films où l’on erre, de la Nouvelle Vague à Wim Wenders, de Jim Jarmusch à Rossellini. Dans tes films, à côté d’images fixes, la caméra est souvent embarquée dans une voiture ou sur un bateau, ou portée à l’épaule, et ce que l’on voit c’est ce qui est capté au cours de son déplacement. Ou bien elle filme des mouvements : carrefours, voitures, camions, éoliennes, vagues, etc. Ou encore d’autres types de mouvements : un feu de signalisation qui s’allume et s’éteint, un paysage qui devient son reflet sur l’arrière d’un camion en mouvement, etc. Dans Le Film des questions, ce qui est vu est un travelling avant qui s’étend quasiment tout au long de la durée du film. Habituellement, l’errance dans les films est celle d’un personnage qui ne maîtrise pas le monde, qui s’inscrit au contraire dans les mouvements du monde et s’y laisse porter. Cette errance du personnage est ainsi, surtout, celle du monde qui devient un ensemble de mouvements d’errance, aberrants, acentrés. Il me semble que dans tes films on retrouve tout cela, sauf qu’il n’y a pas de personnages, l’errance de la caméra étant celle du monde lui-même, comme elle est celle du film. Cette errance comme forme générale ou principe produit non pas un personnage dans un monde en mouvement, mais des films où ce qui importe c’est que le monde ne soit pas un lieu où errer mais devienne lui-même errant pour un regard qui n’est plus celui d’un sujet, un regard impersonnel, anonyme, qui n’appartient plus à une subjectivité. Il me semble que si tes films sont des films d’errance, c’est parce qu’il s’agit de délier le monde de toute maîtrise par un sujet, en vue d’une action, et de le laisser être dans sa mobilité vitale, dans son hétérogénéité, son absence de sens, qui est autant une absence de Dieu. Des films de vent pour un monde de vent. L’errance serait ainsi ce qui permet de produire un autre rapport au monde, « vivant et élastique », jamais arrêté dans une forme déterminée et fixe, par lequel le monde, purement visible, sensible, ne serait que temps et mouvement, hétérogénéité et devenir. Le monde comme co-errance plutôt que cohérence…
Frank Smith : Oui, une fixation non fixe sur la question de l’errance. On sait que ça marche bien aux Etats-Unis, cette question. Et se demander si on peut encore croire au monde. Toute occurrence de la vie a tendance à nous apparaître aujourd’hui pour ce qu’elle est — un cliché. On oscille entre le déjà-vu et l’événement nu, car on ne sait pas faire autrement que de continuer à pratiquer ces schémas qui n’assurent pourtant plus leur fonction. Savons-nous accorder de la réalité aux événements comme tels, indépendamment d’un plan d’avenir qui leur assigne un degré et une signification ou d’un jugement rétrospectif qui les évalue d’après leurs débouchés ? On veut toujours qu’un événement ait une fin, alors qu’il s’agit d’abord d’une rupture, d’une mutation de la perception collective. Croire au monde, c’est croire à la réalité de ses ruptures, voir comment l’événement se perpétue, balbutie, se met en suspens. Chaque question comme une bifurcation, une déviation, une prolifération devant la route qui se jette droite devant nous, catastrophe voulant dire bifurcation. Des spécimens, des échantillons de faits qui sont modulés dans les intervalles des images.
LE VENT, LE VENT un film de Frank Smith, 2006 • 33′ • Vidéo numérique
Jean-Philippe Cazier : Une autre chose qui m’a frappé est que tes images ne renvoient pas à un regard. Ce qui est vu n’est pas supposé être vu par quelqu’un puisque tu ne filmes pas du point de vue d’un personnage – il n’y a pas de personnages dans tes films –, ni même en caméra subjective. Ce qui est vu est vu par la caméra mais n’est pas une vision mécanique, si l’on peut dire. Tes images sont non pas des choses vues mais des visibilités, ce qui t’intéresse c’est moins le regard que le visible. Les paysages naturels ou urbains, les gens que tu filmes ne sont pas vus, c’est-à-dire vus par quelqu’un, mais sont visibles. On n’est plus dans l’image supposée représenter quelque chose ou le point de vue de quelqu’un. Sont produits des points de vue à l’intérieur d’un pur visible, un monde non humain pour un œil non humain, un œil qui n’est pas un œil, justement, mais un principe de visibilité pour le visible du monde. Je ne sais pas si c’est clair ce que je dis… En tout cas, il me semble que c’est par ce régime de l’image que le monde peut être arraché au regard unificateur d’un sujet, à un regard qui donne du sens et de l’identité, pour filmer au contraire le monde d’une manière asubjective qui s’installe à l’intérieur de la vie du monde et non dans la tête d’un sujet. Ceci est frappant dans tes deux premiers films et surtout dans le dernier, Le film des questions, où le visible n’est pas à la lettre filmé puisqu’il est prélevé sur Google earth, sans point de vue élaboré par toi en tant que cinéaste mais simplement donné comme visibilité du monde à travers un processus anonyme. C’est cet anonymat du point de vue, cette installation dans le visible qui permet de voir, à travers ces images, la vie du monde, la multiplicité du monde, son étrangeté, son hétérogénéité mobile, c’est-à-dire le temps vivant qui fait que l’être n’est pas mais devient sans cesse. Je pense là, aussi, à un plan qui est je crois au début d’Euréka, où la route est filmée de nuit, la caméra étant dans la voiture, la route étant filmée ainsi, telle qu’elle se déroule, en suivant les zig zag du trajet, le paysage apparaissant et disparaissant dans la lumière des phares, dans l’obscurité. Je crois que c’est une image emblématique de ton travail…
Frank Smith : Comment se glisser dans l’épaisseur de ce qu’on dit, de ce qu’on voit ? D’où pour moi le désir de porter le on à l’écrit, à l’écran : « Il a été établi que », « Le fait est que », « On dit que ». Le Film des questions porte cette conception-là. C’est la société en ses pouvoirs multiples et dans les coercitions qu’elle exerce qui nous fait voir et qui nous fait parler. Contre cet étranglement, le on nous rejette en pleine mer.
Le Film des questions, à savoir l’abandon du centre vertical et l’abandon du monde solide. Des mouvements mécaniques, tout ça c’est absolument lié. Se placer sur un faisceau énergétique. Il n’y a plus du tout de privilège de la verticalité. Au contraire, c’est des prises de positions antiverticales. Deux caractères, entre autres, d’une modernité possible : l’abandon de l’axe de verticalité et l’abandon du modèle solide au profit de faisceaux énergétiques. Si je dis ça, c’est une espèce de manière de s’approcher, de vivre, le système des images-mouvement qui ne cessent de varier les unes par rapport aux autres – sur toutes leurs faces et dans toutes leurs dimensions et depuis toutes leurs origines, Google en l’occurrence. Et se pose la question de la qualité de l’image, et se pose la question de l’auteur de l’image, et se pose la question du mouvement à l’intérieur de cette série d’images low cost, universellement usurpées.
Je pars encore une fois d’un événement catastrophique et je le traite par des moyens poético-cinématographiques. Dans Le Film des questions, on en reste à la surface des choses banales, y compris dans leur potentiel catastrophique, à la surface du paysage. On épuise, on épuise la totalité d’une variation d’images sales, puisées dans Google Earth, on épuise les possibles en tant que réponse supposée. Une manière de ne pas préférer, de déployer une distraction par rapport à un événement. Je ne fabrique pas mes images, je les prélève, je les emprunte. Je me pose sur des images existantes dans une combinaison matière-mouvement autre. Ce serait aussi une autre façon de penser, si humble ?
Sébastien Zaegel : À travers ce décentrement du sujet, pris dans le faisceau énergétique de l’image-mouvement et dans l’indiscernabilité énonciative – asubjective – du « on », la question des affects revient à plusieurs reprises dans le texte : visage inexpressif du tueur, possibilité – en question – d’un « paysage état d’âme », la question de savoir ce que l’« on » fait de la douleur des protagonistes de ce fait divers, etc. À quoi pourrait-on – peut-être ? – rajouter l’usage de la musique lors de la projection, et sa capacité à susciter une dynamique affective chez l’auditeur. Quel est le statut de ce reliquat affectif dans un dispositif qui tend à l’impersonnalisation ? Autrement dit, et c’est une question qui rejoint l’actualité immédiate : comment traites-tu, par ces moyens poético-cinématographiques, l’« émotion collective » provoquée par l’événement catastrophique ? Quel est ton positionnement formel vis-à-vis de cette composante intrinsèque de ce qui est vécu collectivement comme une catastrophe ?
Frank Smith : Tout est question d’intensité. Je cherche à minimiser la teneur en subjectivation, même si c’est impossible. C’est ce que m’ont appris les poètes objectivistes. Donc les affects, oui, mais à petite dose. Quant à la catastrophe, elle ne cesse de nous assaillir. Et comme dit Didi-Huberman : « Ce n’est pas la même chose, en effet, de commémorer une catastrophe passée dans les pompes consensuelles des ‘lieux de mémoire’, et de se remémorer une catastrophe passée pour éclairer la situation présente sous l’angle des incendies à venir ». Je redis à mon compte : voir, pour savoir, pour prévoir.
Jean-Philippe Cazier : Le film intitulé Le Film des questions, que tu as présenté pour la première fois au Centre Pompidou l’autre soir, a été précédé d’un livre également intitulé Le Film des questions, paru en 2014. Dans ce livre, le film est présent mais en tant que virtuel : un film réel mais virtuel, un film non pas à faire, un film possible, à venir, mais existant dans le présent du livre en tant que virtuel. A la lecture, je me demandais comment tu allais t’y prendre au cas où tu réaliserais effectivement ce film. Et l’autre soir j’ai vu la solution très inventive que tu as trouvée pour conserver cet état virtuel du film. Tu n’as pas tourné ce film en te servant du livre comme d’une espèce de scénario mais tu as construit un agencement audio-visuel où s’intègrent les images extraites de Google Earth, le texte du livre, les images que tu as filmées des acteurs lisant ton livre, mais aussi les deux acteurs présents dans la salle et lisant en direct le livre, ainsi que Philippe Langlois interprétant au piano, en live, sa partition magnifique. Cet agencement fait tenir ensemble tous ces éléments autant qu’il les disjoint, et il me semble qu’il est la réalisation radicale de ce que tu avais déjà mis en place dans les autres films où effectivement tu abordes le cinéma, le film, comme un agencement audio-visuel. Il me semble que la séance de l’autre soir est le plus évident de ce que tu fais dans le cinéma, puisque tes films sont des agencements audio-visuels, où il s’agit de penser le rapport entre l’audio et le visuel mais aussi la différence, de produire un rapport qui à la fois existe et est nié, n’est jamais de l’ordre de la coïncidence, existe en n’étant pas. Ce qu’ajoutait la séance de l’autre soir est la dimension immersive : les spectateurs n’étaient pas seulement face à un écran mais étaient immergés dans quelque chose d’inédit, en tout cas pour moi, à la limite entre le cinéma, la lecture, le théâtre, la musique, et qui se déplaçait le long de ces limites – là encore, il s’agirait d’errance – tout en maintenant du début à la fin ces limites. Donc, au lieu de faire un film à partir du Film des questions, tu as fait cet agencement audio-visuel qui vaut aussi, me semble-t-il pour le monde et le rapport au monde tels qu’ils sont impliqués par ton travail : un monde audio-visuel où les écarts ne se résorbent pas, où l’hétérogénéité existe pour elle-même, où rien ne vient unifier et étouffer la multiplicité vivante du monde. L’autre soir tu as proposé une expérience de cette multiplicité qui était très forte…
Entretien réalisé le 30/01/15
///////////////////// Autres documents
Poème dramatique pour voix
[Extraits]
par Frank Smith
Lecture de Gaza, d’ici-là par Frank Smith – Entretien avec l’auteur – Texte de Jean-Philippe Cazier.
Une intervention radiophonique d’Ossama Mohammed à propos du film Eau argentée, Syrie autoportrait, un film d’Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan & Mille et un Syriens
Border, France/ UK, 2004
27 min. Digibeta PAL, Colour, Stereo
Directed, Produced, Written, Camera, Edited Laura Waddington
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris