Docteur en philosophie, Véronique Bergen est l’auteur d’essais sur la philosophie contemporaine, de romans et de recueils de poèmes ; elle est membre du comité de la revue Lignes. Elle a notamment publié L’Ontologie de Gilles Deleuze ; Résistances philosophiques ; Aujourd’hui la révolution et Fragments d’Ulrike M.
Emmanuel Moreira : Véronique, tu viens de publier un ouvrage de facture philosophique aux éditions Lignes « Le corps glorieux de la Top-modèle » et un ouvrage de facture littéraire « Edie. La danse d’Icare » aux éditions Al Dante. Tu as également publié des textes de facture poétique. Comment travailles-tu cette circulation entre prose, philosophie et poésie ?
Véronique Bergen : Même si on fait une séparation des genres, à l’intérieur de chacun des genres, j’aime bien convoquer les autres genres dans une espèce de ventriloquie. Il s’agit de ne pas me cantonner à une fiction romanesque ou un corpus philosophique, même si l’état d’esprit dans lequel je me trouve et les impératifs de créations sont différents d’un champ à l’autre. C’est une question d’énergie. Lorsque qu’un problème se pose à moi, je ne sais pas d’avance si je vais le décliner, le moduler sous une forme philosophique ou sous une forme fictionnelle. Cependant, c’est dans l’espace de la fiction que je me sens davantage libre parce que je suis portée par l’invention d’une langue, parce que l’inconscient affleure, prend la plume et bouscule le régime de la pensée. Dans la création romanesque, poétique, une force qui me dépossède de la maîtrise entre en scène et me désarçonne, me déporte vers des terres inconnues. C’est en ce lieu où se rencontrent contrôle actif, prise sur la langue et déprise, lâcher-prise que quelque chose d’inédit, d’inattendu peut se produire.
Le corps glorieux de la Top-modèle
éditions Lignes
 E.M : Si « Le corps glorieux de la Top-modèle » est bien un livre de facture philosophique, le sujet, lui, est plutôt impur pour la philosophie.
E.M : Si « Le corps glorieux de la Top-modèle » est bien un livre de facture philosophique, le sujet, lui, est plutôt impur pour la philosophie.
V.B : Tout à fait. La philosophie semble avoir épuisé ses vieux schèmes et donc elle s’accapare d’objets extra-philosophiques. La vigilance exige de ne pas produire une spéculation qui arraisonne sous la bannière du concept des champs qui relèvent a priori des bords de la philosophie, de son dehors. J’avais une réticence de principe à ne pas abonder dans une philosophie du rock, de la drogue, au sens où la philosophie dirait la vérité sur ces marges habituellement traitées par la sociologie, l’histoire des idées. Bref, il s’agissait avant tout de ne pas faire de la philosophie appliquée à des matériaux « impurs », hétérogènes à son exercice tel que l’histoire de la philosophie l’a défini. J’ai voulu mettre à jour les opérateurs de pensée que la mode performe, qui la régissent. Non produire une pensée d’une sphère qui ne se penserait pas, qui serait dépourvue de pensée mais dégager les schèmes fondateurs, les invariants symboliques et les enjeux de pensée qu’elle met en scène. En même temps, au travers des phénomènes du monde de la mode, des top-modèles, se joue comme une radiographie du système du simulacre de la société contemporaine. Quelques-unes des catégories fondamentales de la mode (le changement, l’éphémère, le paraître, la séduction…) sont tellement entrées dans l’air du temps qu’on peut y voir comme un laboratoire de ce que le capitalisme au sens large représente. A savoir : la gloire des apparences. Ma visée était d’explorer les problématiques théoriques, métaphysiques que la mode acte, d’analyser la pensée qui habite cet espace « fashion » qu’on conspue pour sa légèreté, sa frivolité, lui déniant toute mise en œuvre de profondeur.
E.M : Pour cette étude, tu t’appuies sur deux auteurs importants : Agamben et Marie-José Mondzain. Guy Debord est lui absent de tes sources immédiates.
V.B : C’était un choix. Il y avait la possibilité de prendre un point de vue extrêmement critique sur la mode en l’ancrant dans une analyse des structures, dans une grille économico-politique dans la mesure où elle est quand même l’épiphénomène absolu du consumérisme, de la sphère de consommation et d’un hyperlibéralisme illimité, sauvage. Certains ont regretté que cette analyse des systèmes d’oppression (au sens de l’Ecole de Francfort) qui sont agissants dans le champ de la mode ne soit pas traitée dans le livre. Mais je voulais me focaliser sur les opérateurs de la mode et affronter deux versants : la mode comme processus de création au sens de Deleuze et la mode comme biopouvoir au sens de Foucault. J’ai donc essayé de ne jamais négliger ni l’un ni l’autre de ces deux aspects. D’où l’extrême paradoxe de mon regard qui s’enlève à la fois sur une critique du diktat aliénant des modèles canoniques d’une beauté, du formatage des esprits et sur une fascination pour l’extrême singularité des opérateurs de la mode au niveau de sa création, une sidération pour la magie de l’imaginaire des stylistes qui inventent un monde de féerie. Je parle ici de création sans faire de hiérarchisation entre les arts dits majeurs ou mineurs, ligne de partage qui n’a plus lieu d’être. La grammaire de la mode me semble intéressante parce qu’autant, en aval de son mouvement, elle recycle, formate les esprits et les discipline au sens d’un bio-pouvoir, d’un callo-bio-pouvoir quant elle déferle dans le prêt-à-porter, autant parfois, en amont, dans la haute couture ou dans la mode marginale underground, par ses incursions inventives, sa syntaxe des matières, des coupes, des explorations des possibles esthétiques des parures, elle fait bouger les choses en signant de nouveaux styles d’être au monde, de vivre son corps. Donc c’est un objet presque implosif, contradictoire en lui-même.
Si on prend par exemple la libération de la femme, il est évident que Coco Chanel ou les premières créatrices, par l’invention du pantalon, ont libéré non seulement l’image de la femme, mais la femme elle-même, enterrant la contrainte du corset, servant la cause des femme, de l’émancipation féminine. Mais cette libération s’est à son tour complètement refermée dans une aliénation en imposant à la femme des normes esthétiques qui exercent une domination, une contrainte symbolique, en l’enfermant dans des rôles limitatifs. Elle libère avant d’être recyclée en impératifs marchands qui objectalisent hommes et femmes. Et donc on a toujours ce double mouvement. Voilà pourquoi je ne me suis pas appuyée sur Guy Debord dont l’analyse du spectacle ne prend à bras le corps que le versant dénonciation des mécanismes d’enfermement.
E.M : Pourrait-on prendre la mode comme une métaphore de la politique contemporaine ?
V.B : Ce serait dramatique si elle emblématisait le nerf de la politique comme événements changeant le monde dès lors qu’elle repose sur une propension à désamorcer, neutraliser les inventions de liberté qu’elle promeut. Cependant, elle est peut-être, voire très certainement la métaphore de la politique institutionnalisée, de la politique étatique au sens ou elle recycle, bâillonne dans une réaction thermidorienne dirait Badiou les conquêtes de liberté qu’elle a frayées. Je parle de conquêtes de liberté dans le chef de la mode car elle ne fait pas que proposer des tendances vestimentaires mais véhicule, éveille des nouvelles manières d’habiter son corps, sa sexualité, ses fantasmes et génère de nouvelles modalités d’existence en promouvant par exemple des sexualités dites marginales, des pratiques transgressives, minoritaires, des mouvements de révolte venus de la rue avant de les phagocyter dans un prêt-à-penser étouffant.
E.M : Rentrons un peu dans l’ouvrage. Le phénomène contemporain des top-modèles convoque une série de catégories fondatrices qui se voient à la fois posées et subverties. Principalement les catégories de temps et d’éternité, d’idée et d’empirie, de nature et d’artifice, d’être et de paraître. Arrêtons-nous sur le premier couple : temps et éternité.
V.B : La mode comme phénomène social n’existe pas sans une mise en avant d’idées décontextualisées de l’empirie. C’est une première chose. Et surtout, elle entretient un très curieux rapport au temps, qu’Agamben avait déjà bien analysé, qui est la marque de nos sociétés : leur non-contemporanéité par rapport à elles-mêmes. C’est-à-dire qu’elle est toujours en retard sur ce qu’elle doit être et en avance sur ce qu’elle a été. Dans son rapport au temps, elle est à la fois dans un mythe d’éternité avec une volonté d’éroder les signes de finitude, de vieillissement, de marquage temporel, et elle se situe aussi dans une temporalité qui ne fait que recycler des pans du passé dans le présent, qui joue avec des blocs temporels qu’elle actionne dans un éternel retour. Plus exactement, ce n’est pas le présent qui va répéter le passé mais c’est le passé qui déjà est une répétition de ce qui va être. En même temps elle a parfois des innovations porteuses de déplacements qui trouent le tissu de Chronos : je pense à Jean-Paul Gaultier lorsqu’il a fait défiler Andrej Pejic, un homme au physique androgyne, dans une robe de mariée. C’est je crois quelque chose qui va bien au-delà du paraître, des parures, quelque chose qui fait bouger les mentalités en faisant éclater la division du masculin et du féminin, en représentant l’Idée (au sens platonicien du terme) de la Femme par un homme, donc en versant l’Idée dans le règne du simulacre.
E.M : Tu écris : « La mode est toujours démodée ».
V.B : Oui, bien sûr. Premièrement, on ne sait pas acter le point d’invention des nouvelles tendances. Et deuxièmement, la mode est démodée parce qu’elle est prise dans une fuite en avant. A partir du moment où une collection décline l’air du temps, il est déjà trop tard. Il y a là une « pathologie », une course en avant qui fonctionne comme une métaphore de la société contemporaine.
E.M : A propos du couple idée et empirie, tu écris ceci : « L’empire de la mode s’est construit sur le concept ou plus exactement sur l’idée de femme. Sur l’idée de la beauté frappé du sceau de l’éternité. » Et plus loin » sans cette Idée de femme à laquelle les femmes se soumettent, il n’y aurait pas de mode. »
V.B : Oui, certainement. Il y a un dispositif quasiment platonicien, où tout ce qui est empirique, matérialité est complètement transcendé dans une vision mythique de La Femme, dans une quasi-déliaison des deux termes sensible et intelligible.
E.M : Et en même temps il y a du corps …
V.B : … Mais c’est un corps qui n’est pas habité. C’est un corps évidé, simulacre, spectral, aérien. C’est pour cela que j’ai parlé de corps de gloire. Avec les top-modèles, on assiste à une inversions de l’incarnation, à une chair qui se fait verbe, plus exactement lumière et image. Et là c’est un paradoxe. La mode qui voulait mettre en évidence un certain corps en arrive à sa disparition. De là m’est venue l’analogie entre les mannequins et les anges. Tout se passe comme si les top-modèles en tant que caste fantomatique étaient chaque fois des catégories d’intercesseurs entre d’une part le public qui est voué simplement à communier puis à acheter et d’autre part l’idée du beau, une idée pure, en apsenateur, une notion mallarméenne césurée de son référent empirique. La mode est bâtie sur des concepts en petit nombre (Idées du beau, de l’élégance, de la séduction, de l’harmonie…, fût-ce dans ses remises en question ponctuelles de ses standards, une beauté du laid, une élégance désaxée, l’anti-beau restant sous la coupe de l’idéal régulateur du beau), des notions qui ne sont plus raccrochées à leurs répondants sensibles. C’est pour cela que je suis partie des top-modèles. Comme elles ne sont plus que des intercesseurs entre la sphère des consommateurs ici-bas et l’idée transcendante du Beau véhiculée par les créations des stylistes, on pourrait très bien s’en passer et prendre des images de synthèse. Ce qui se fait déjà…
E.M : A propos du paradoxe nature et artifice, tu écris ceci : « La mode cesse de faire du biologique, de l’anatomie du sexe et de l’âge, un destin et une fatalité. »
V.B : Davantage qu’agir simplement sur le paraître, la mode agit sur les codes éthiques, les manières d’être, le licite et l’illicite. Donc ce qu’on pourrait prendre pour extrêmement superficiel travaille en sous-main nos sociétés de façon plus prégnante et par conséquent le superficiel a une efficacité assez forte. « Le plus profond c’est la peau » disait Valéry en une formule que Deleuze a réactivée.
E.M : Mais ne crois-tu pas qu’il y a certains endroits où la mode ne s’aventurerait pas, comme par exemple le monstrueux ?
V.B : Effectivement. Elle est très bien régulée. Ses entreprises de dérégulations, d’hybridations stylistiques, d’explorations restent très codées. La mode reflète ou parfois précède ce qui se passe en art ou dans d’autres champs sociaux. Ce qui apparaît comme une transgression assez forte (introduction d’une esthétique transgenre, de mannequins androgynes, d’une sexualité SM…) tombe très vite dans un conformisme ou bien est repris dans une sorte de ritournelle qui n’a plus aucune puissance de contestation. Dans le cercle de la mode, même l’underground est recyclé.
E.M : Il y a aussi un chapitre qui a pour titre « perdurance de l’affrontent entre iconodulie et iconoclastie ». Peux-tu revenir sur la manière dont tu mobilises, ici, le travail de Marie-José Mondzain et la manière dont tu appliques ce travail comme grille de lecture ?
V.B : Marie-José Mondzain a infiniment plus de compétence que moi pour parler de cette querelle, qui est donc la grande querelle byzantine sur le statut des images. Cette querelle portait sur la question du statut de l’image, avec l’inquiétude que l’adoration, au lieu d’aller exclusivement vers Dieu, se déporte vers les images. Deux camps s’opposaient. Il y avait les partisans des images comme moyen de propagande de la foi et de l’autre côté ceux qui s’opposaient à l’image en tant qu’elle est séduction, porteuse de désirs et d’idolâtrie, la bonne icône risquant de verser dans l’idole. Je pense qu’il y a dans la mode la réactivation de cette querelle. La mode est apparemment iconophile, saturée d’images qui prolifèrent dans un déchaînement sans fin, déportant l’image vers ce que Baudrillard entend par simulacre et en même temps, elle a une part iconoclaste. Iconoclaste parce qu’elle est contrainte de multiplier sa production imageale dès lors qu’aucune image ne figurera à elle seule l’Idée du beau, qu’elle bute sur un irreprésentable (échec à figurer l’Idée de la Beauté, de la femme…) qui la force à relancer au finish la pléthore d’une production de visibilités. Puisque la mode évolue dans le royaume des idées, aucune femme top-modèle ne sera à la hauteur de l’idée. D’où cette fuite en avant dans la sécrétion d’images. Enfin, elle détient en elle une part iconoclaste en un autre sens, au sens où elle convoite, caresse le vœu de la dernière image, celle qui tuerait toutes les autres ou qui serait l’image irreprésentable qui mettrait à mort, abolirait les autres.
Edie. La danse d’Icare
éditions Al Dante
Tous les vêtements qu’on me fait porter me vont comme un gant parce que l’existence ne me va pas du tout. Si Marilyn et moi, on capte la lumière comme personne, c’est parce qu’il fait noir en nous.
je suis une jeune fille trouée de courants d’air, je peux sortir tous les personnages de ma poche car il n’y a pas d’Edie. Le photographe ne comprend pas la nuance entre jouer, incarner un personnage et n’être qu’une surface de réflection…
 Amandine André : As-tu cultivé un état de corps particulier pour rentrer dans l’écriture d’Edie ? A la lecture de ce livre, on finit par avoir la sensation que comme écrivain tu fais tienne la phrase de Flaubert « Madame Bovary, c’est moi ». Quelque chose donc d’un travestissement.
Amandine André : As-tu cultivé un état de corps particulier pour rentrer dans l’écriture d’Edie ? A la lecture de ce livre, on finit par avoir la sensation que comme écrivain tu fais tienne la phrase de Flaubert « Madame Bovary, c’est moi ». Quelque chose donc d’un travestissement.
Véronique Bergen : Je crois que j’ai un processus d’écriture très fusionnel. Une sorte d’immersion profonde à l’intérieur d’un personnage dans lequel certainement je vois un reflet ou un écho, de certaines problématisations ou points de crises qui me tenaillent, que j’analyse et autopsie à travers une figure qui est en consonance ou en résonance avec moi. Donc oui, un état de corps, mais aussi un corps de langue. Trouver une langue qui danse et qui soit en affinité avec le personnage.
A.A : Edie Sedgwick en tant qu’icône c’est presque celle qui a échappée à sa propre existence, qui en a été dépossédée. C’est-à-dire, comme Marilyn, des êtres qui ont traversé le monde en ayant tout donné et qui sont allés en un point extrême de dépossession de leur propre parole. Ton geste semble celui de recharger leurs figures par tout un volume de mots, une densité de la langue.
V.B : Dans tous mes livres, au-delà d’Edie Sedgwick, muse de la Factory, de Warhol, quand je convoque une figure de fiction, un sujet ou une époque c’est avant tout pour donner voix à ce qui a été soit bâillonné par l’Histoire officielle, ce qui a été muselé, relégué dans une Histoire des vaincus au sens de Walter Benjamin, soit ce qui a été auto-sacrifié, ce qui n’est même pas monté à la parole, ce qui n’a existé que sous la forme de l’absence. Cette deuxième voie est celle d’Edie Sedgwick, de Kaspar Hauser aussi que j’ai traité dans un autre roman, Kaspar Hauser ou la phrase préférée du vent. Edie, on peut la voir comme la Marilyn de l’underground : toutes deux se sont autocensurées au profit d’une image mythique, iconique. Donc je veille à redonner voix, oui, mais sans parler pour. Deleuze disait « ne pas parler au nom de. » C’est aussi ne pas usurper. C’est donc toujours un exercice difficile. Oui, donner voix à des figures que l’histoire a cantonnées dans l’invisibilité, afin de leur ré-insuffler une mémoire vivante, une vie dont on les a peut-être privés, mais toujours avec le risque de s’exporter, de parler à la place de. Et la question de la littérature et de la fiction, c’est de ne pas parler à la place de et pourtant on le fait.
A.A : Problème éthique. Retraverser une vie qui a été exploitée sans l’exploiter à son tour. Par exemple Edie c’est tout un processus d’exploitation par Andy Warhol. Alors qu’on touche une figure de l’exploitation, il s’agit de ne pas la faire se positionner politiquement quand elle ne s’est pas elle-même positionnée, par exemple sur le féminisme.
V.B : Oui.
///////////////////////////////// Autres documents
par Véronique Bergen.
Extrait d’Edie. La danse d’Icare, qui sort aux Editions Al Dante en septembre 2013.
Je m’appelle Edie Superstar. Je prononce très vite “Edie” car dans mon prénom il y a “die”, “mourir”. Je m’appelle Edith Minturn Sedgwick mais on me surnomme “girl on fire”. Devant le miroir, je vois se lever l’Edie de l’année 1955, mes douze ans me sauter au visage. Mais la voix que recueille un magnétophone prêt jour et nuit à enregistrer mes délires est celle de mes six ans.
« Puisque le monde nous est donné inintelligible, il faut le rendre d’une certaine façon encore plus inintelligible » Jean Baudrillard
Rencontre avec Jean Paul Curnier à propos du numéro 31 de la revue Lignes, Le Gai savoir de Baudrillard.
Entretien radiophonique et réalisation : Emmanuel Moreira


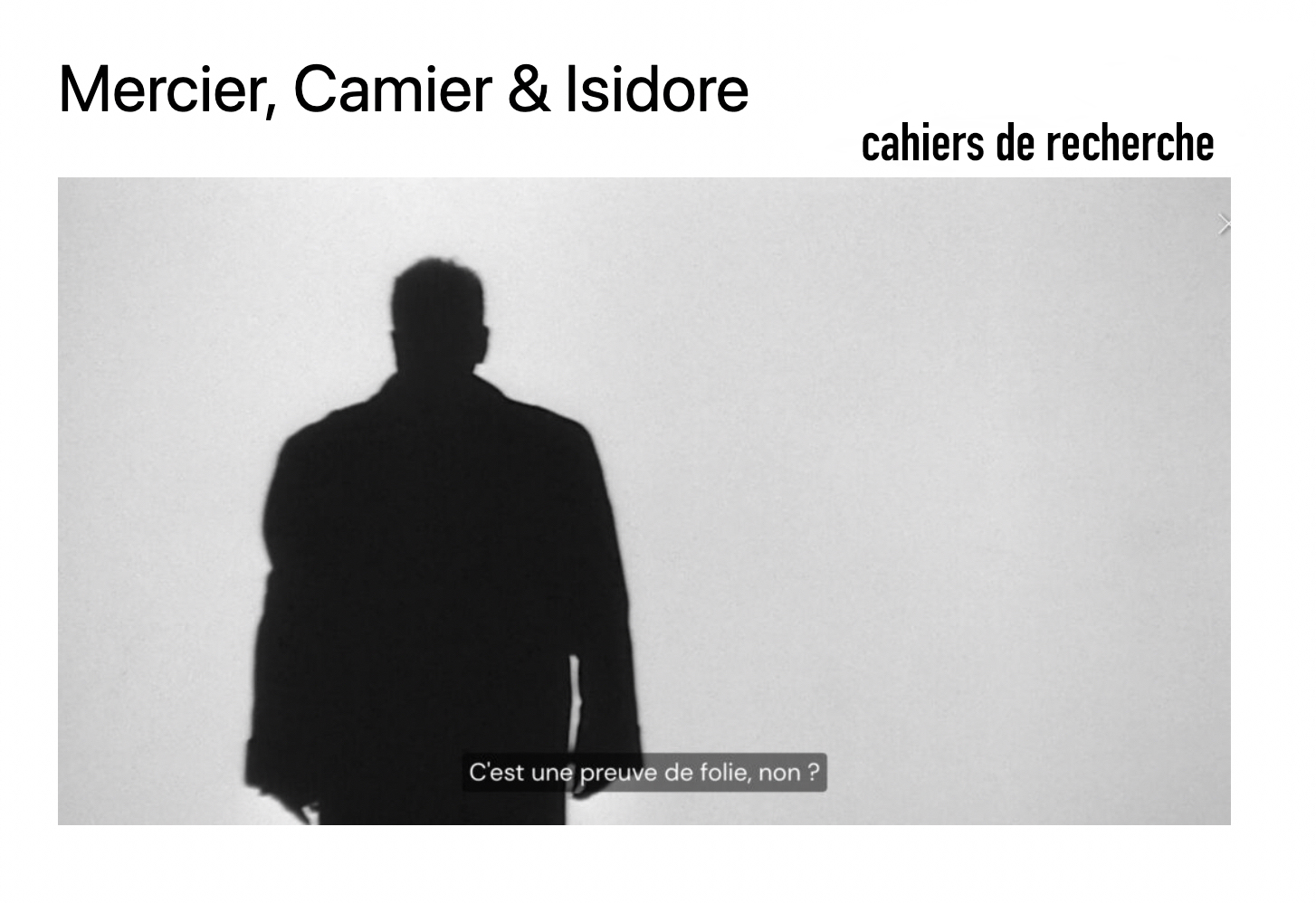



La gloire des apparences, entretien avec Véronique Bergen
Docteur en philosophie, Véronique Bergen est l’auteur d’essais sur la philosophie contemporaine, de romans et de recueils de poèmes ; elle est membre du comité de la revue Lignes. Elle a notamment publié L’Ontologie de Gilles Deleuze ; Résistances philosophiques ; Aujourd’hui la révolution et Fragments d’Ulrike M.
Emmanuel Moreira : Véronique, tu viens de publier un ouvrage de facture philosophique aux éditions Lignes « Le corps glorieux de la Top-modèle » et un ouvrage de facture littéraire « Edie. La danse d’Icare » aux éditions Al Dante. Tu as également publié des textes de facture poétique. Comment travailles-tu cette circulation entre prose, philosophie et poésie ?
Véronique Bergen : Même si on fait une séparation des genres, à l’intérieur de chacun des genres, j’aime bien convoquer les autres genres dans une espèce de ventriloquie. Il s’agit de ne pas me cantonner à une fiction romanesque ou un corpus philosophique, même si l’état d’esprit dans lequel je me trouve et les impératifs de créations sont différents d’un champ à l’autre. C’est une question d’énergie. Lorsque qu’un problème se pose à moi, je ne sais pas d’avance si je vais le décliner, le moduler sous une forme philosophique ou sous une forme fictionnelle. Cependant, c’est dans l’espace de la fiction que je me sens davantage libre parce que je suis portée par l’invention d’une langue, parce que l’inconscient affleure, prend la plume et bouscule le régime de la pensée. Dans la création romanesque, poétique, une force qui me dépossède de la maîtrise entre en scène et me désarçonne, me déporte vers des terres inconnues. C’est en ce lieu où se rencontrent contrôle actif, prise sur la langue et déprise, lâcher-prise que quelque chose d’inédit, d’inattendu peut se produire.
Le corps glorieux de la Top-modèle
éditions Lignes
V.B : Tout à fait. La philosophie semble avoir épuisé ses vieux schèmes et donc elle s’accapare d’objets extra-philosophiques. La vigilance exige de ne pas produire une spéculation qui arraisonne sous la bannière du concept des champs qui relèvent a priori des bords de la philosophie, de son dehors. J’avais une réticence de principe à ne pas abonder dans une philosophie du rock, de la drogue, au sens où la philosophie dirait la vérité sur ces marges habituellement traitées par la sociologie, l’histoire des idées. Bref, il s’agissait avant tout de ne pas faire de la philosophie appliquée à des matériaux « impurs », hétérogènes à son exercice tel que l’histoire de la philosophie l’a défini. J’ai voulu mettre à jour les opérateurs de pensée que la mode performe, qui la régissent. Non produire une pensée d’une sphère qui ne se penserait pas, qui serait dépourvue de pensée mais dégager les schèmes fondateurs, les invariants symboliques et les enjeux de pensée qu’elle met en scène. En même temps, au travers des phénomènes du monde de la mode, des top-modèles, se joue comme une radiographie du système du simulacre de la société contemporaine. Quelques-unes des catégories fondamentales de la mode (le changement, l’éphémère, le paraître, la séduction…) sont tellement entrées dans l’air du temps qu’on peut y voir comme un laboratoire de ce que le capitalisme au sens large représente. A savoir : la gloire des apparences. Ma visée était d’explorer les problématiques théoriques, métaphysiques que la mode acte, d’analyser la pensée qui habite cet espace « fashion » qu’on conspue pour sa légèreté, sa frivolité, lui déniant toute mise en œuvre de profondeur.
E.M : Pour cette étude, tu t’appuies sur deux auteurs importants : Agamben et Marie-José Mondzain. Guy Debord est lui absent de tes sources immédiates.
V.B : C’était un choix. Il y avait la possibilité de prendre un point de vue extrêmement critique sur la mode en l’ancrant dans une analyse des structures, dans une grille économico-politique dans la mesure où elle est quand même l’épiphénomène absolu du consumérisme, de la sphère de consommation et d’un hyperlibéralisme illimité, sauvage. Certains ont regretté que cette analyse des systèmes d’oppression (au sens de l’Ecole de Francfort) qui sont agissants dans le champ de la mode ne soit pas traitée dans le livre. Mais je voulais me focaliser sur les opérateurs de la mode et affronter deux versants : la mode comme processus de création au sens de Deleuze et la mode comme biopouvoir au sens de Foucault. J’ai donc essayé de ne jamais négliger ni l’un ni l’autre de ces deux aspects. D’où l’extrême paradoxe de mon regard qui s’enlève à la fois sur une critique du diktat aliénant des modèles canoniques d’une beauté, du formatage des esprits et sur une fascination pour l’extrême singularité des opérateurs de la mode au niveau de sa création, une sidération pour la magie de l’imaginaire des stylistes qui inventent un monde de féerie. Je parle ici de création sans faire de hiérarchisation entre les arts dits majeurs ou mineurs, ligne de partage qui n’a plus lieu d’être. La grammaire de la mode me semble intéressante parce qu’autant, en aval de son mouvement, elle recycle, formate les esprits et les discipline au sens d’un bio-pouvoir, d’un callo-bio-pouvoir quant elle déferle dans le prêt-à-porter, autant parfois, en amont, dans la haute couture ou dans la mode marginale underground, par ses incursions inventives, sa syntaxe des matières, des coupes, des explorations des possibles esthétiques des parures, elle fait bouger les choses en signant de nouveaux styles d’être au monde, de vivre son corps. Donc c’est un objet presque implosif, contradictoire en lui-même.
Si on prend par exemple la libération de la femme, il est évident que Coco Chanel ou les premières créatrices, par l’invention du pantalon, ont libéré non seulement l’image de la femme, mais la femme elle-même, enterrant la contrainte du corset, servant la cause des femme, de l’émancipation féminine. Mais cette libération s’est à son tour complètement refermée dans une aliénation en imposant à la femme des normes esthétiques qui exercent une domination, une contrainte symbolique, en l’enfermant dans des rôles limitatifs. Elle libère avant d’être recyclée en impératifs marchands qui objectalisent hommes et femmes. Et donc on a toujours ce double mouvement. Voilà pourquoi je ne me suis pas appuyée sur Guy Debord dont l’analyse du spectacle ne prend à bras le corps que le versant dénonciation des mécanismes d’enfermement.
E.M : Pourrait-on prendre la mode comme une métaphore de la politique contemporaine ?
V.B : Ce serait dramatique si elle emblématisait le nerf de la politique comme événements changeant le monde dès lors qu’elle repose sur une propension à désamorcer, neutraliser les inventions de liberté qu’elle promeut. Cependant, elle est peut-être, voire très certainement la métaphore de la politique institutionnalisée, de la politique étatique au sens ou elle recycle, bâillonne dans une réaction thermidorienne dirait Badiou les conquêtes de liberté qu’elle a frayées. Je parle de conquêtes de liberté dans le chef de la mode car elle ne fait pas que proposer des tendances vestimentaires mais véhicule, éveille des nouvelles manières d’habiter son corps, sa sexualité, ses fantasmes et génère de nouvelles modalités d’existence en promouvant par exemple des sexualités dites marginales, des pratiques transgressives, minoritaires, des mouvements de révolte venus de la rue avant de les phagocyter dans un prêt-à-penser étouffant.
E.M : Rentrons un peu dans l’ouvrage. Le phénomène contemporain des top-modèles convoque une série de catégories fondatrices qui se voient à la fois posées et subverties. Principalement les catégories de temps et d’éternité, d’idée et d’empirie, de nature et d’artifice, d’être et de paraître. Arrêtons-nous sur le premier couple : temps et éternité.
V.B : La mode comme phénomène social n’existe pas sans une mise en avant d’idées décontextualisées de l’empirie. C’est une première chose. Et surtout, elle entretient un très curieux rapport au temps, qu’Agamben avait déjà bien analysé, qui est la marque de nos sociétés : leur non-contemporanéité par rapport à elles-mêmes. C’est-à-dire qu’elle est toujours en retard sur ce qu’elle doit être et en avance sur ce qu’elle a été. Dans son rapport au temps, elle est à la fois dans un mythe d’éternité avec une volonté d’éroder les signes de finitude, de vieillissement, de marquage temporel, et elle se situe aussi dans une temporalité qui ne fait que recycler des pans du passé dans le présent, qui joue avec des blocs temporels qu’elle actionne dans un éternel retour. Plus exactement, ce n’est pas le présent qui va répéter le passé mais c’est le passé qui déjà est une répétition de ce qui va être. En même temps elle a parfois des innovations porteuses de déplacements qui trouent le tissu de Chronos : je pense à Jean-Paul Gaultier lorsqu’il a fait défiler Andrej Pejic, un homme au physique androgyne, dans une robe de mariée. C’est je crois quelque chose qui va bien au-delà du paraître, des parures, quelque chose qui fait bouger les mentalités en faisant éclater la division du masculin et du féminin, en représentant l’Idée (au sens platonicien du terme) de la Femme par un homme, donc en versant l’Idée dans le règne du simulacre.
E.M : Tu écris : « La mode est toujours démodée ».
V.B : Oui, bien sûr. Premièrement, on ne sait pas acter le point d’invention des nouvelles tendances. Et deuxièmement, la mode est démodée parce qu’elle est prise dans une fuite en avant. A partir du moment où une collection décline l’air du temps, il est déjà trop tard. Il y a là une « pathologie », une course en avant qui fonctionne comme une métaphore de la société contemporaine.
E.M : A propos du couple idée et empirie, tu écris ceci : « L’empire de la mode s’est construit sur le concept ou plus exactement sur l’idée de femme. Sur l’idée de la beauté frappé du sceau de l’éternité. » Et plus loin » sans cette Idée de femme à laquelle les femmes se soumettent, il n’y aurait pas de mode. »
V.B : Oui, certainement. Il y a un dispositif quasiment platonicien, où tout ce qui est empirique, matérialité est complètement transcendé dans une vision mythique de La Femme, dans une quasi-déliaison des deux termes sensible et intelligible.
E.M : Et en même temps il y a du corps …
V.B : … Mais c’est un corps qui n’est pas habité. C’est un corps évidé, simulacre, spectral, aérien. C’est pour cela que j’ai parlé de corps de gloire. Avec les top-modèles, on assiste à une inversions de l’incarnation, à une chair qui se fait verbe, plus exactement lumière et image. Et là c’est un paradoxe. La mode qui voulait mettre en évidence un certain corps en arrive à sa disparition. De là m’est venue l’analogie entre les mannequins et les anges. Tout se passe comme si les top-modèles en tant que caste fantomatique étaient chaque fois des catégories d’intercesseurs entre d’une part le public qui est voué simplement à communier puis à acheter et d’autre part l’idée du beau, une idée pure, en apsenateur, une notion mallarméenne césurée de son référent empirique. La mode est bâtie sur des concepts en petit nombre (Idées du beau, de l’élégance, de la séduction, de l’harmonie…, fût-ce dans ses remises en question ponctuelles de ses standards, une beauté du laid, une élégance désaxée, l’anti-beau restant sous la coupe de l’idéal régulateur du beau), des notions qui ne sont plus raccrochées à leurs répondants sensibles. C’est pour cela que je suis partie des top-modèles. Comme elles ne sont plus que des intercesseurs entre la sphère des consommateurs ici-bas et l’idée transcendante du Beau véhiculée par les créations des stylistes, on pourrait très bien s’en passer et prendre des images de synthèse. Ce qui se fait déjà…
E.M : A propos du paradoxe nature et artifice, tu écris ceci : « La mode cesse de faire du biologique, de l’anatomie du sexe et de l’âge, un destin et une fatalité. »
V.B : Davantage qu’agir simplement sur le paraître, la mode agit sur les codes éthiques, les manières d’être, le licite et l’illicite. Donc ce qu’on pourrait prendre pour extrêmement superficiel travaille en sous-main nos sociétés de façon plus prégnante et par conséquent le superficiel a une efficacité assez forte. « Le plus profond c’est la peau » disait Valéry en une formule que Deleuze a réactivée.
E.M : Mais ne crois-tu pas qu’il y a certains endroits où la mode ne s’aventurerait pas, comme par exemple le monstrueux ?
V.B : Effectivement. Elle est très bien régulée. Ses entreprises de dérégulations, d’hybridations stylistiques, d’explorations restent très codées. La mode reflète ou parfois précède ce qui se passe en art ou dans d’autres champs sociaux. Ce qui apparaît comme une transgression assez forte (introduction d’une esthétique transgenre, de mannequins androgynes, d’une sexualité SM…) tombe très vite dans un conformisme ou bien est repris dans une sorte de ritournelle qui n’a plus aucune puissance de contestation. Dans le cercle de la mode, même l’underground est recyclé.
E.M : Il y a aussi un chapitre qui a pour titre « perdurance de l’affrontent entre iconodulie et iconoclastie ». Peux-tu revenir sur la manière dont tu mobilises, ici, le travail de Marie-José Mondzain et la manière dont tu appliques ce travail comme grille de lecture ?
V.B : Marie-José Mondzain a infiniment plus de compétence que moi pour parler de cette querelle, qui est donc la grande querelle byzantine sur le statut des images. Cette querelle portait sur la question du statut de l’image, avec l’inquiétude que l’adoration, au lieu d’aller exclusivement vers Dieu, se déporte vers les images. Deux camps s’opposaient. Il y avait les partisans des images comme moyen de propagande de la foi et de l’autre côté ceux qui s’opposaient à l’image en tant qu’elle est séduction, porteuse de désirs et d’idolâtrie, la bonne icône risquant de verser dans l’idole. Je pense qu’il y a dans la mode la réactivation de cette querelle. La mode est apparemment iconophile, saturée d’images qui prolifèrent dans un déchaînement sans fin, déportant l’image vers ce que Baudrillard entend par simulacre et en même temps, elle a une part iconoclaste. Iconoclaste parce qu’elle est contrainte de multiplier sa production imageale dès lors qu’aucune image ne figurera à elle seule l’Idée du beau, qu’elle bute sur un irreprésentable (échec à figurer l’Idée de la Beauté, de la femme…) qui la force à relancer au finish la pléthore d’une production de visibilités. Puisque la mode évolue dans le royaume des idées, aucune femme top-modèle ne sera à la hauteur de l’idée. D’où cette fuite en avant dans la sécrétion d’images. Enfin, elle détient en elle une part iconoclaste en un autre sens, au sens où elle convoite, caresse le vœu de la dernière image, celle qui tuerait toutes les autres ou qui serait l’image irreprésentable qui mettrait à mort, abolirait les autres.
Edie. La danse d’Icare
éditions Al Dante
Véronique Bergen : Je crois que j’ai un processus d’écriture très fusionnel. Une sorte d’immersion profonde à l’intérieur d’un personnage dans lequel certainement je vois un reflet ou un écho, de certaines problématisations ou points de crises qui me tenaillent, que j’analyse et autopsie à travers une figure qui est en consonance ou en résonance avec moi. Donc oui, un état de corps, mais aussi un corps de langue. Trouver une langue qui danse et qui soit en affinité avec le personnage.
A.A : Edie Sedgwick en tant qu’icône c’est presque celle qui a échappée à sa propre existence, qui en a été dépossédée. C’est-à-dire, comme Marilyn, des êtres qui ont traversé le monde en ayant tout donné et qui sont allés en un point extrême de dépossession de leur propre parole. Ton geste semble celui de recharger leurs figures par tout un volume de mots, une densité de la langue.
V.B : Dans tous mes livres, au-delà d’Edie Sedgwick, muse de la Factory, de Warhol, quand je convoque une figure de fiction, un sujet ou une époque c’est avant tout pour donner voix à ce qui a été soit bâillonné par l’Histoire officielle, ce qui a été muselé, relégué dans une Histoire des vaincus au sens de Walter Benjamin, soit ce qui a été auto-sacrifié, ce qui n’est même pas monté à la parole, ce qui n’a existé que sous la forme de l’absence. Cette deuxième voie est celle d’Edie Sedgwick, de Kaspar Hauser aussi que j’ai traité dans un autre roman, Kaspar Hauser ou la phrase préférée du vent. Edie, on peut la voir comme la Marilyn de l’underground : toutes deux se sont autocensurées au profit d’une image mythique, iconique. Donc je veille à redonner voix, oui, mais sans parler pour. Deleuze disait « ne pas parler au nom de. » C’est aussi ne pas usurper. C’est donc toujours un exercice difficile. Oui, donner voix à des figures que l’histoire a cantonnées dans l’invisibilité, afin de leur ré-insuffler une mémoire vivante, une vie dont on les a peut-être privés, mais toujours avec le risque de s’exporter, de parler à la place de. Et la question de la littérature et de la fiction, c’est de ne pas parler à la place de et pourtant on le fait.
A.A : Problème éthique. Retraverser une vie qui a été exploitée sans l’exploiter à son tour. Par exemple Edie c’est tout un processus d’exploitation par Andy Warhol. Alors qu’on touche une figure de l’exploitation, il s’agit de ne pas la faire se positionner politiquement quand elle ne s’est pas elle-même positionnée, par exemple sur le féminisme.
V.B : Oui.
///////////////////////////////// Autres documents
par Véronique Bergen.
Extrait d’Edie. La danse d’Icare, qui sort aux Editions Al Dante en septembre 2013.
Je m’appelle Edie Superstar. Je prononce très vite “Edie” car dans mon prénom il y a “die”, “mourir”. Je m’appelle Edith Minturn Sedgwick mais on me surnomme “girl on fire”. Devant le miroir, je vois se lever l’Edie de l’année 1955, mes douze ans me sauter au visage. Mais la voix que recueille un magnétophone prêt jour et nuit à enregistrer mes délires est celle de mes six ans.
« Puisque le monde nous est donné inintelligible, il faut le rendre d’une certaine façon encore plus inintelligible » Jean Baudrillard
Rencontre avec Jean Paul Curnier à propos du numéro 31 de la revue Lignes, Le Gai savoir de Baudrillard.
Entretien radiophonique et réalisation : Emmanuel Moreira
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris