par Boyan Manchev
– Fragments pour Federico Ferrari –
Et voilà, je suis là, aux confins du monde. Mes notes de la fin du monde ont trempé d’humidité en moins d’une heure, pendant que je les feuilletais assis sous la treille du dernier hôtel, au-delà duquel est seulement le désert. Le vent est presque orageux, il meut des massifs d’air, lourds d’humidité, et pourtant tout a l’air figé. Tout se fige.
L’humidité est aussi dense qu’elle couvre le soleil, elle obscurcit le ciel. L’horizon n’est plus une limite. Il est l’espacement, la saturation qui me traverse.
Anywhere out of the world
Fuir le monde, toujours plus loin. Avec Baudelaire : anywhere out of the world. Ou bien, avec Bataille : toujours plus loin, là où est ton seul pays.
On parle ainsi depuis des siècles d’une fuite du monde – et il s’agit évidemment d’un lieu commun, d’une banalité intenable. On parle mieux d’un départ à la découverte de l’inconnu : du monde inconnu… Mais en vérité il y a plus que ça, beaucoup plus : il y a la traversée de l’espace.
Traverser l’espace, traverser la limite. Non pas s’inscrire dans la limite du monde, partir, sortir du monde, anywhere out of the world, mais aussi répondre à l’exigence de son excès, l’excès du monde – suivre le mouvement de son excès, ne pas finir sur aucune limite, être cette limite même, en expansion incessante, un front qui affronte le vide, tout en creusant un vide encore plus neutre et intense à la fois, au cœur même du vide.
Le monde ne tient pas sur place. Il n’y a pas de limite de l’être que l’on excède : l’être est son propre excès, il est l’excès même. Or le monde est son propre exode. Et les « maudits » ou les « possédés » – les derniers romantiques – sont ceux qui ont su répondre au mouvement souterrain, puissant, de son désir, le désir du monde qui est un désir immense, impersonnel, inimaginable et libre.
Il ne s’agit donc pas d’une fuite du monde mais d’une possession, la possession dont parle Tomás – il s’agit d’être possédé par la force de son excès : être le front du mouvement du monde qui est son propre excès. La limite n’est qu’un front qui se transforme.
Ainsi l’excès de notre corps, qui excède sa finitude, est un front. Et oui, nos corps sont toujours à la limite, hors de soi, la transfusion du sang, l’infusion du venin, cellules extatiques, toi, ton corps, excès illimité de mon corps, la limite du sans-limite, ta peau, ma peau, ce front continu, ce pli infini, l’exposition infinie de notre finitude dont parle Jean-Luc ; de notre nudité, nudité d’une humanité nue dont parle Fede.
L’objet ultime
Il n’y a pas de garantie, ni empirique ni métaphysique, que la fin du monde ne soit pas imminente. Finitude radicale : pour la première fois la fin de notre vie pourrait coïncider avec la fin du monde. Et cette première fois est première chaque fois. Or la fin du monde devrait être pensée comme absolument imminente. Telle est l’essence même de la pensée : la pensée ne peut avoir d’autre point de départ que l’expérience de la finitude radicale du monde. Le monde n’est la chair de la pensée que par l’imminence absolue de sa fin. Penser le monde donc non pas à partir de sa création toujours douteuse mais à partir de sa fin toujours présente dans son anticipation inévitable. C’est pourquoi la réflexion sur la fin du monde est non seulement un objet philosophique absolument légitime mais impérative. L’idée du monde n’est pas possible sans l’idée de la limite, c’est-à-dire de la fin du monde – ou bien de son néant, le terme, le gouffre, le vide. Ces deux idées se sont formées ensemble et sont co- substantielles. Nous ne pouvons pas penser le monde sans sa limite. Et pourtant, la fin du monde n’est pas la fiction à partir de laquelle on déduirait la substance du monde ; la fin du monde est le rythme même du cœur du monde.
La fin sans fin
Maurice Blanchot écrit dans L’espace littéraire au sujet du regard d’Orphée : « Lui-même, en ce regard, est absent, il n’est pas moins mort qu’elle [Eurydice], non pas mort de cette tranquille mort du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est mort sans fin, épreuve de l’absence sans fin. »
Le regard d’Orphée tourné vers Eurydice et repoussant la fiancée aux enfers est la poussée de l’effondrement du monde – l’effondrement du monde dans lequel seulement le monde apparaît. Tel est peut-être le sens le plus profond, le plus obscur du mythe grec. Le monde n’apparaît pas sur le fond du néant, il n’émerge pas de la source obscure de la négativité du non-être, mais il est une ambiguïté essentielle, pour parler avec Blanchot ; il n’est monde que dans la mesure où il est à la limite, il tremble à la limite, un regard-éclair et puis la nuit. L’intensité de la foudre. Plus le monde s’intensifie, plus il est un monde : le monde a lieu sous un mode ou sous un régime tensif. Le dehors, le hors du monde, est loin donc d’être un simple terme négatif – un non-être ; il est un vide radical, la nuit dans le cœur de la nuit, à la fois patience et impatience, trahison non-volontaire et fidélité sans limite d’Orphée. Le dehors inappropriable dans le cœur même du monde, à travers lequel le monde devient un monde : la sortie du monde sans fin.
Face à la fin du monde
Là, ici, devant la fin du monde – face à la fin du monde, le moment est venu de dire que l’idée du monde ne nous appartient plus – et qu’elle ne nous a jamais appartenue.
Nous ne savons rien du monde sans l’homme, peut-être cette ignorance même est le monde.
La fin du monde est comme la nuit blanche, comme le jour polaire – lumière qui blanchit sans rencontrer aucun obstacle sur son chemin, aucune limite.
Où est donc la limite du monde ? Sommes-nous à la limite du monde ou bien au-delà ?
Nous sommes donc à la limite du monde. Nous sommes cette limite même.
Pourtant, la limite est sans limite. Cette limite est le monde. Infinitif de la césure, pour parler avec Jean-Christophe.
Or ce qui nous survient ici et maintenant, toujours – « la fin du monde » – ce n’est que la fin de la fin. Il n’y a pas de fin du monde – la fin est infinie car la fin, la limite, le front qui se surpasse toujours, est son propre excès.
L’exode du monde est le monde lui-même – le vide du monde, qu’on a sur-peuplé sans pour autant réussir à l’habiter. Le monde comme le mouvement excessif de la sortie, la démesure de son altération, qui ne saura pas être saturée par la consommation du globe.
« Ce monde-ci, le même pour tous, que nul dieu ni homme n’a fait, mais qui a toujours été, qui est et qui sera toujours feu vivant, s’allumant par mesures et s’éteignant par mesures. » (Héraclite)
Il nous incombe de porter plus loin, ensemble, le poids de cet optimisme insoutenable, infiniment léger et sain sans la puissance écrasante du salut.
Boyan Manchev
///////////////////////////////// Autres documents
par Federico Ferrari
Les yeux d’A, ouverts sur nous. Ils nous regardent, même si le regard ne nous est pas adressé. Pour qui est ce regard ? Pour une caméra, pour une machine qui ne la regarde pas puisqu’elle n’a pas de regard. C’est le regard adressé à personne, abandonné à une technique, à un support qui est en même temps un art de la mémoire, comme tout art l’a toujours été. L’art est cette gravure du regard sur la peau du monde, sur la matière de ce monde.
Photographies de Nathalie Blanchard / Texte de Federico Ferrari
Nous vivons dans un manque de réel. C’est ce qu’on nous répète tous les jours. Et c’est peut être vrai.
Mais, en même temps, nous sommes plongés tout le temps dans un excès de réel, dans un réalisme étouffant.



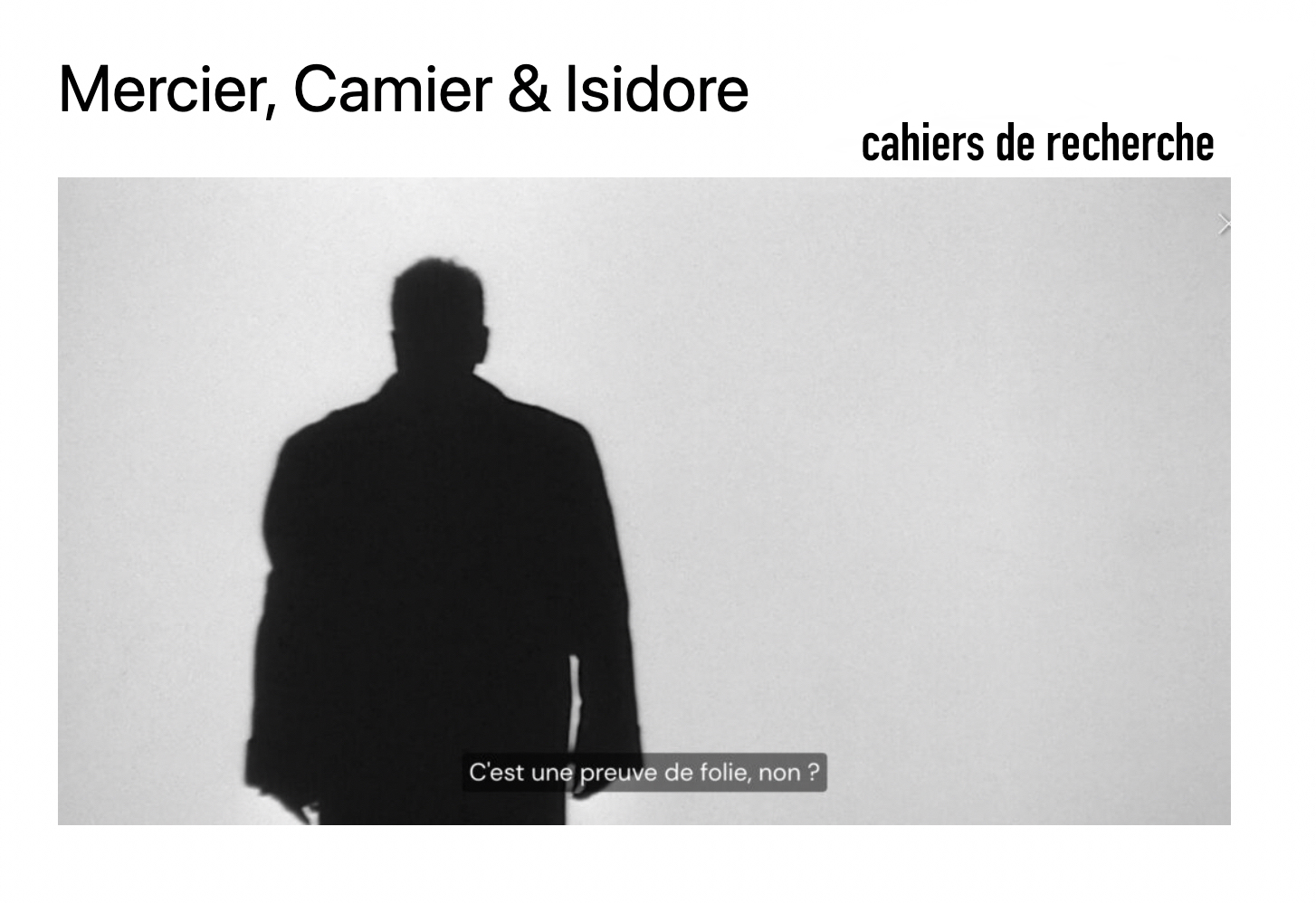




L’excès du monde
par Boyan Manchev
– Fragments pour Federico Ferrari –
Et voilà, je suis là, aux confins du monde. Mes notes de la fin du monde ont trempé d’humidité en moins d’une heure, pendant que je les feuilletais assis sous la treille du dernier hôtel, au-delà duquel est seulement le désert. Le vent est presque orageux, il meut des massifs d’air, lourds d’humidité, et pourtant tout a l’air figé. Tout se fige.
L’humidité est aussi dense qu’elle couvre le soleil, elle obscurcit le ciel. L’horizon n’est plus une limite. Il est l’espacement, la saturation qui me traverse.
Anywhere out of the world
Fuir le monde, toujours plus loin. Avec Baudelaire : anywhere out of the world. Ou bien, avec Bataille : toujours plus loin, là où est ton seul pays.
On parle ainsi depuis des siècles d’une fuite du monde – et il s’agit évidemment d’un lieu commun, d’une banalité intenable. On parle mieux d’un départ à la découverte de l’inconnu : du monde inconnu… Mais en vérité il y a plus que ça, beaucoup plus : il y a la traversée de l’espace.
Traverser l’espace, traverser la limite. Non pas s’inscrire dans la limite du monde, partir, sortir du monde, anywhere out of the world, mais aussi répondre à l’exigence de son excès, l’excès du monde – suivre le mouvement de son excès, ne pas finir sur aucune limite, être cette limite même, en expansion incessante, un front qui affronte le vide, tout en creusant un vide encore plus neutre et intense à la fois, au cœur même du vide.
Le monde ne tient pas sur place. Il n’y a pas de limite de l’être que l’on excède : l’être est son propre excès, il est l’excès même. Or le monde est son propre exode. Et les « maudits » ou les « possédés » – les derniers romantiques – sont ceux qui ont su répondre au mouvement souterrain, puissant, de son désir, le désir du monde qui est un désir immense, impersonnel, inimaginable et libre.
Il ne s’agit donc pas d’une fuite du monde mais d’une possession, la possession dont parle Tomás – il s’agit d’être possédé par la force de son excès : être le front du mouvement du monde qui est son propre excès. La limite n’est qu’un front qui se transforme.
Ainsi l’excès de notre corps, qui excède sa finitude, est un front. Et oui, nos corps sont toujours à la limite, hors de soi, la transfusion du sang, l’infusion du venin, cellules extatiques, toi, ton corps, excès illimité de mon corps, la limite du sans-limite, ta peau, ma peau, ce front continu, ce pli infini, l’exposition infinie de notre finitude dont parle Jean-Luc ; de notre nudité, nudité d’une humanité nue dont parle Fede.
L’objet ultime
Il n’y a pas de garantie, ni empirique ni métaphysique, que la fin du monde ne soit pas imminente. Finitude radicale : pour la première fois la fin de notre vie pourrait coïncider avec la fin du monde. Et cette première fois est première chaque fois. Or la fin du monde devrait être pensée comme absolument imminente. Telle est l’essence même de la pensée : la pensée ne peut avoir d’autre point de départ que l’expérience de la finitude radicale du monde. Le monde n’est la chair de la pensée que par l’imminence absolue de sa fin. Penser le monde donc non pas à partir de sa création toujours douteuse mais à partir de sa fin toujours présente dans son anticipation inévitable. C’est pourquoi la réflexion sur la fin du monde est non seulement un objet philosophique absolument légitime mais impérative. L’idée du monde n’est pas possible sans l’idée de la limite, c’est-à-dire de la fin du monde – ou bien de son néant, le terme, le gouffre, le vide. Ces deux idées se sont formées ensemble et sont co- substantielles. Nous ne pouvons pas penser le monde sans sa limite. Et pourtant, la fin du monde n’est pas la fiction à partir de laquelle on déduirait la substance du monde ; la fin du monde est le rythme même du cœur du monde.
La fin sans fin
Maurice Blanchot écrit dans L’espace littéraire au sujet du regard d’Orphée : « Lui-même, en ce regard, est absent, il n’est pas moins mort qu’elle [Eurydice], non pas mort de cette tranquille mort du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est mort sans fin, épreuve de l’absence sans fin. »
Le regard d’Orphée tourné vers Eurydice et repoussant la fiancée aux enfers est la poussée de l’effondrement du monde – l’effondrement du monde dans lequel seulement le monde apparaît. Tel est peut-être le sens le plus profond, le plus obscur du mythe grec. Le monde n’apparaît pas sur le fond du néant, il n’émerge pas de la source obscure de la négativité du non-être, mais il est une ambiguïté essentielle, pour parler avec Blanchot ; il n’est monde que dans la mesure où il est à la limite, il tremble à la limite, un regard-éclair et puis la nuit. L’intensité de la foudre. Plus le monde s’intensifie, plus il est un monde : le monde a lieu sous un mode ou sous un régime tensif. Le dehors, le hors du monde, est loin donc d’être un simple terme négatif – un non-être ; il est un vide radical, la nuit dans le cœur de la nuit, à la fois patience et impatience, trahison non-volontaire et fidélité sans limite d’Orphée. Le dehors inappropriable dans le cœur même du monde, à travers lequel le monde devient un monde : la sortie du monde sans fin.
Face à la fin du monde
Là, ici, devant la fin du monde – face à la fin du monde, le moment est venu de dire que l’idée du monde ne nous appartient plus – et qu’elle ne nous a jamais appartenue.
Nous ne savons rien du monde sans l’homme, peut-être cette ignorance même est le monde.
La fin du monde est comme la nuit blanche, comme le jour polaire – lumière qui blanchit sans rencontrer aucun obstacle sur son chemin, aucune limite.
Où est donc la limite du monde ? Sommes-nous à la limite du monde ou bien au-delà ?
Nous sommes donc à la limite du monde. Nous sommes cette limite même.
Pourtant, la limite est sans limite. Cette limite est le monde. Infinitif de la césure, pour parler avec Jean-Christophe.
Or ce qui nous survient ici et maintenant, toujours – « la fin du monde » – ce n’est que la fin de la fin. Il n’y a pas de fin du monde – la fin est infinie car la fin, la limite, le front qui se surpasse toujours, est son propre excès.
L’exode du monde est le monde lui-même – le vide du monde, qu’on a sur-peuplé sans pour autant réussir à l’habiter. Le monde comme le mouvement excessif de la sortie, la démesure de son altération, qui ne saura pas être saturée par la consommation du globe.
Il nous incombe de porter plus loin, ensemble, le poids de cet optimisme insoutenable, infiniment léger et sain sans la puissance écrasante du salut.
Boyan Manchev
///////////////////////////////// Autres documents
par Federico Ferrari
Les yeux d’A, ouverts sur nous. Ils nous regardent, même si le regard ne nous est pas adressé. Pour qui est ce regard ? Pour une caméra, pour une machine qui ne la regarde pas puisqu’elle n’a pas de regard. C’est le regard adressé à personne, abandonné à une technique, à un support qui est en même temps un art de la mémoire, comme tout art l’a toujours été. L’art est cette gravure du regard sur la peau du monde, sur la matière de ce monde.
Photographies de Nathalie Blanchard / Texte de Federico Ferrari
Nous vivons dans un manque de réel. C’est ce qu’on nous répète tous les jours. Et c’est peut être vrai.
Mais, en même temps, nous sommes plongés tout le temps dans un excès de réel, dans un réalisme étouffant.
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris