Les yeux d’A, ouverts sur nous. Ils nous regardent, même si le regard ne nous est pas adressé. Pour qui est ce regard ? Pour une caméra, pour une machine qui ne la regarde pas puisqu’elle n’a pas de regard. C’est le regard adressé à personne, abandonné à une technique, à un support qui est en même temps un art de la mémoire, comme tout art l’a toujours été. L’art est cette gravure du regard sur la peau du monde, sur la matière de ce monde.
Le regard d’A est le regard de l’art, ce regard qui survie, qui nous parle d’une survivance qui nous précède et nous excède. Excédence du regard. Ouverture du regard sur le royaume des morts. Regard d’Orphée, comme le disait Blanchot.
Mais les yeux d’A sont seulement ses yeux.
 Comme les yeux de cette femme qui en 140 av. J.-C., dans un Empire où tout se mêlait, se préparait à laisser ce monde, en lui laissant la seule chose qui ne le quitterait jamais : l’étonnante merveille de son regard. Yeux ouverts sur la démesure d’un monde qui ne sera jamais assez vu, qui ne pourra jamais entrer tout entier dans un regard, mais qui sera toujours disséminé dans une infinité de regards possibles, toujours dans les yeux de quelqu’un, d’un encore : n+1.
Comme les yeux de cette femme qui en 140 av. J.-C., dans un Empire où tout se mêlait, se préparait à laisser ce monde, en lui laissant la seule chose qui ne le quitterait jamais : l’étonnante merveille de son regard. Yeux ouverts sur la démesure d’un monde qui ne sera jamais assez vu, qui ne pourra jamais entrer tout entier dans un regard, mais qui sera toujours disséminé dans une infinité de regards possibles, toujours dans les yeux de quelqu’un, d’un encore : n+1.
Yeux avides, yeux étonnés, yeux extatiques.
Mais ces yeux – cette apostrophe muette, comme l’appelle Jean-Christophe, qui s’abîme dans l’éternité, qui s’expose et nous expose à cet instant qui suspend le temps et reste à jamais suspendu – s’adressent aussi à nous. Ils nous regardent à la recherche d’une phrase qui puisse articuler le rythme de la vision, qui puisse montrer la césure du temps, l’instant où la parole exprime inexprimablement l’inexprimable, comme nous le disait, sans presque rien dire, dans les cafés de Strasbourg Philippe, qui, à son tour, reprenait tout ça de Wittgenstein.
C’est la persistance du regard, comme le diraient Boyan et Tomás; ce qui ne cesse pas de venir et de faire venir, de nous faire venir au monde. Et c’est cette persistance qui nous lie les uns aux autres, au-delà de toute différence. Nous, les derniers romantiques, romantiques sans généalogie, sans nostalgie et sans communauté.
Ces yeux qui un jour ont pleuré, affrontant le vide qui est devant tout regard, devant la mort que l’art qui les saisit leur montre sans mensonges, ces yeux pleureront encore et à jamais. Et les larmes qui couleront ne les rendront pas aveugles, au contraire elles leur permettront d’avoir une vraie vision, elles leur donneront à voir ce qui n’est pas de l’ordre de la vue, comme le disait Derrida, ce qui nous fait voir les uns aux autres, au-delà de tout cliché; qui nous lie d’une génération à l’autre, qui lie nos corps et nos pensées, les corps de nos pensées et nos corps qui pensent, en existant, en sortant d’eux pour entrer dans l’autre. Nos corps qui se pénètrent en se faisant pénétrer, sans aucune fusion ni aucune confusion. Compénétration des corps et des regards, des vies et des existences, des (formes de) vies, comme le dirait peut-être Frédéric et, avec des autres mots encore, Jean-Luc.
 Laisser ces yeux, qu’ils puissent pleurer devant la merveille de ce monde, devant cette merveille, cette straziante meravigliosa bellezza del creato qui nous échappera, que nous perdrons enfin. Les yeux disparaitront avec nous, mais notre regard, notre regard d’Orphée sera encore là. Et c’est par là, par ce regard qui s’ouvre sur l’ouvert, sur l’extase de toute existence que tout recommencera, sans fin. Aussi, pour toi, qui nous regarderas un jour. Pour ceux qui viendront, comme nous sommes venus, même si, pour trop peu de temps, ici et maintenant.
Laisser ces yeux, qu’ils puissent pleurer devant la merveille de ce monde, devant cette merveille, cette straziante meravigliosa bellezza del creato qui nous échappera, que nous perdrons enfin. Les yeux disparaitront avec nous, mais notre regard, notre regard d’Orphée sera encore là. Et c’est par là, par ce regard qui s’ouvre sur l’ouvert, sur l’extase de toute existence que tout recommencera, sans fin. Aussi, pour toi, qui nous regarderas un jour. Pour ceux qui viendront, comme nous sommes venus, même si, pour trop peu de temps, ici et maintenant.
“Et pleurer donnerait-il le change à ce que nous avions été si mal si moindre si peu ensemble ? Que non. Et si cela donnait le change cela ne ferait pas moins qu’ensemble reste à venir. Finalement. Même mal, même de travers, même en boitant, ensemble reste à venir. Ce serait un bon début.”
Federico Ferrari
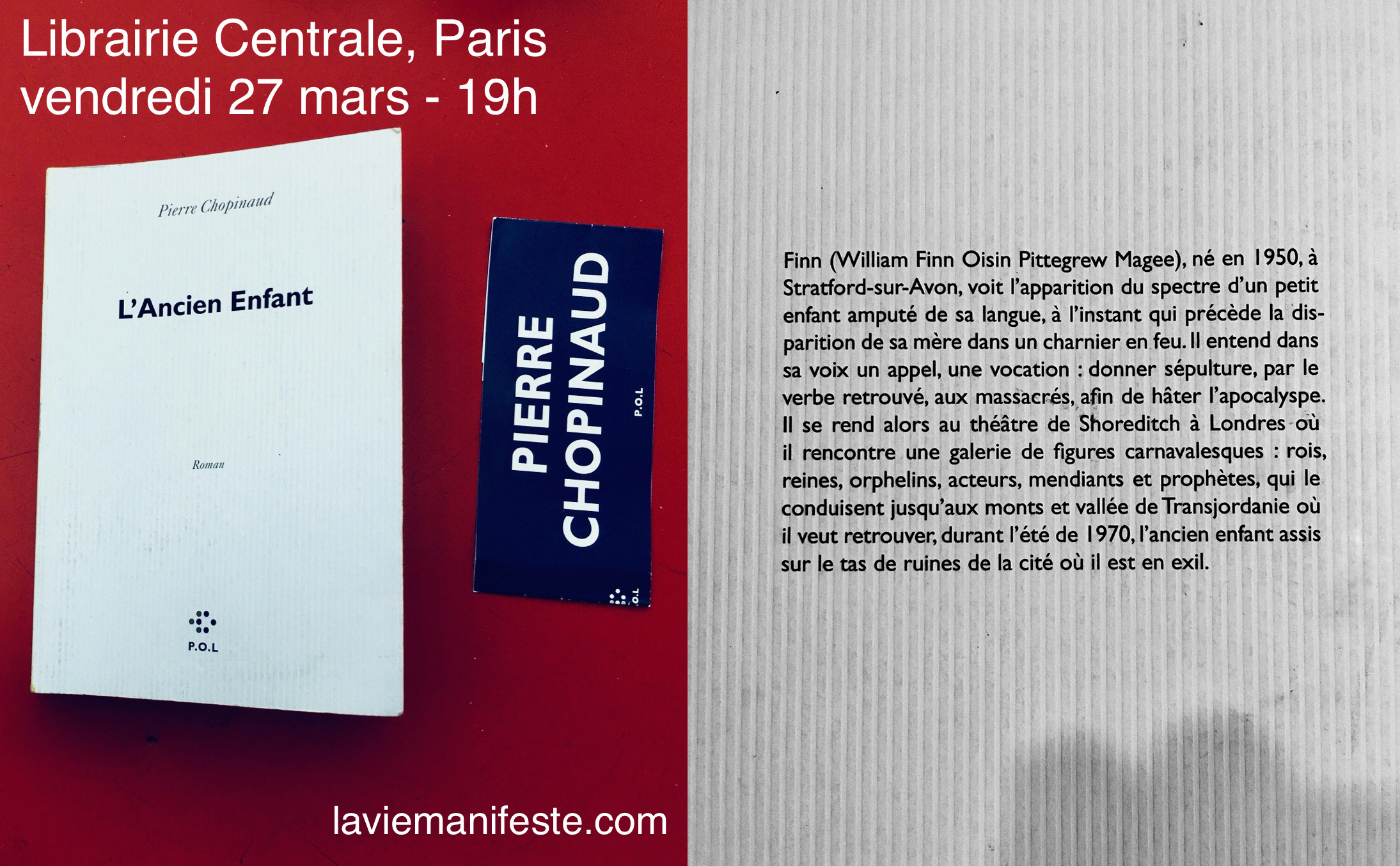

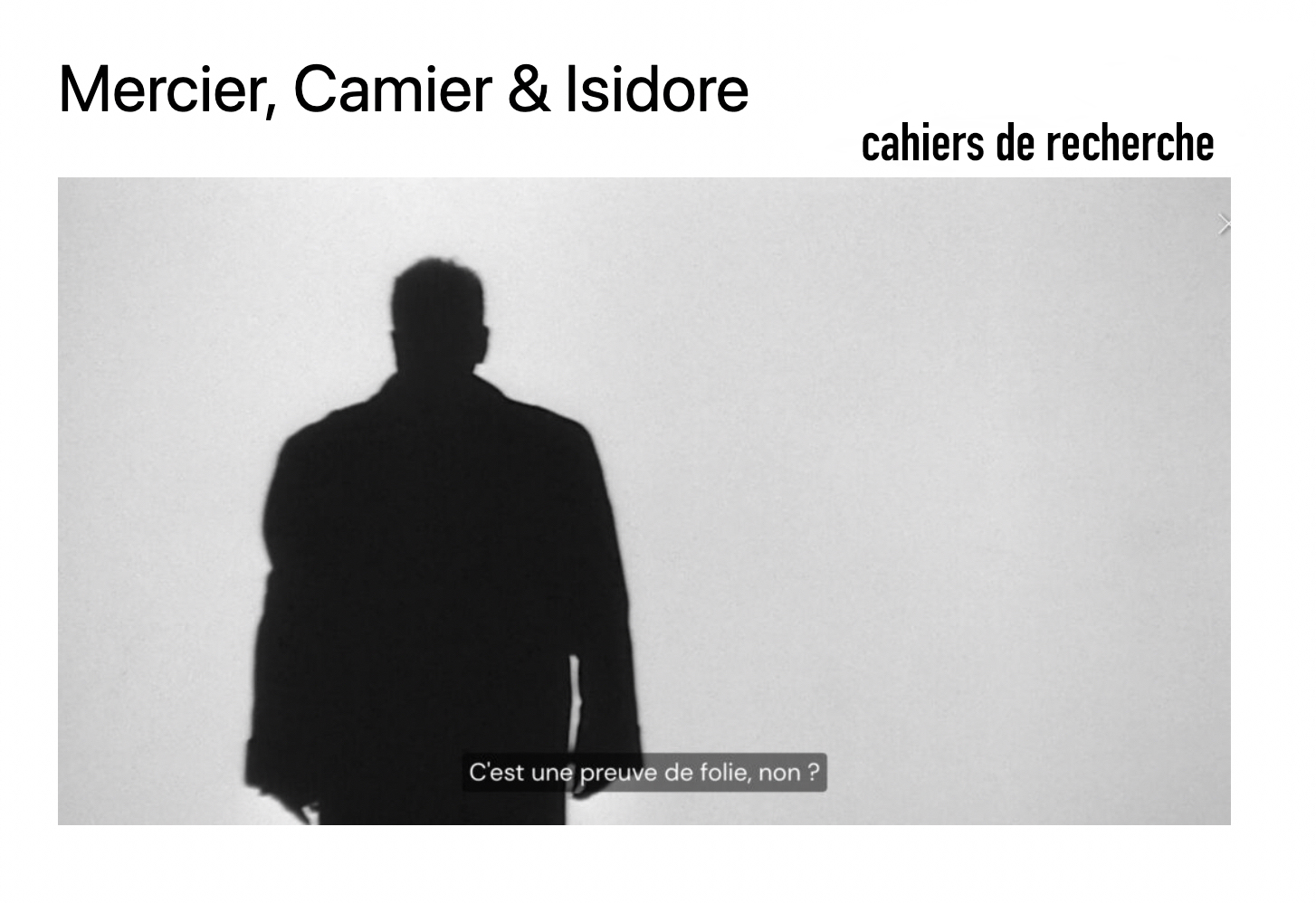



Les yeux d’A et le regard d’Orphée
Les yeux d’A, ouverts sur nous. Ils nous regardent, même si le regard ne nous est pas adressé. Pour qui est ce regard ? Pour une caméra, pour une machine qui ne la regarde pas puisqu’elle n’a pas de regard. C’est le regard adressé à personne, abandonné à une technique, à un support qui est en même temps un art de la mémoire, comme tout art l’a toujours été. L’art est cette gravure du regard sur la peau du monde, sur la matière de ce monde.
Le regard d’A est le regard de l’art, ce regard qui survie, qui nous parle d’une survivance qui nous précède et nous excède. Excédence du regard. Ouverture du regard sur le royaume des morts. Regard d’Orphée, comme le disait Blanchot.
Mais les yeux d’A sont seulement ses yeux.
Yeux avides, yeux étonnés, yeux extatiques.
Mais ces yeux – cette apostrophe muette, comme l’appelle Jean-Christophe, qui s’abîme dans l’éternité, qui s’expose et nous expose à cet instant qui suspend le temps et reste à jamais suspendu – s’adressent aussi à nous. Ils nous regardent à la recherche d’une phrase qui puisse articuler le rythme de la vision, qui puisse montrer la césure du temps, l’instant où la parole exprime inexprimablement l’inexprimable, comme nous le disait, sans presque rien dire, dans les cafés de Strasbourg Philippe, qui, à son tour, reprenait tout ça de Wittgenstein.
C’est la persistance du regard, comme le diraient Boyan et Tomás; ce qui ne cesse pas de venir et de faire venir, de nous faire venir au monde. Et c’est cette persistance qui nous lie les uns aux autres, au-delà de toute différence. Nous, les derniers romantiques, romantiques sans généalogie, sans nostalgie et sans communauté.
Ces yeux qui un jour ont pleuré, affrontant le vide qui est devant tout regard, devant la mort que l’art qui les saisit leur montre sans mensonges, ces yeux pleureront encore et à jamais. Et les larmes qui couleront ne les rendront pas aveugles, au contraire elles leur permettront d’avoir une vraie vision, elles leur donneront à voir ce qui n’est pas de l’ordre de la vue, comme le disait Derrida, ce qui nous fait voir les uns aux autres, au-delà de tout cliché; qui nous lie d’une génération à l’autre, qui lie nos corps et nos pensées, les corps de nos pensées et nos corps qui pensent, en existant, en sortant d’eux pour entrer dans l’autre. Nos corps qui se pénètrent en se faisant pénétrer, sans aucune fusion ni aucune confusion. Compénétration des corps et des regards, des vies et des existences, des (formes de) vies, comme le dirait peut-être Frédéric et, avec des autres mots encore, Jean-Luc.
“Et pleurer donnerait-il le change à ce que nous avions été si mal si moindre si peu ensemble ? Que non. Et si cela donnait le change cela ne ferait pas moins qu’ensemble reste à venir. Finalement. Même mal, même de travers, même en boitant, ensemble reste à venir. Ce serait un bon début.”
Federico Ferrari
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris