Entretien avec Boyan Manchev autour de L’Altération du monde. Pour une esthétique radicale (Lignes, avril 2009)
Cet été, Frédéric Neyrat nous a fait part d’un échange qu’il avait eu en mai 2009 avec Boyan Manchev à propos de son ouvrage L’altération du monde. C’est le contenu de cet entretien que nous publions ici et cela aussi pour prolonger un autre entretien – audio – que nous avions eu avec Boyan Manchev, toujours autours de cet ouvrage publié aux éditions Lignes.
***
F. N : Voilà, pour commencer, puisqu’il s’agira de vue et d’espace, du Dasein de la vue pour nous qui, précisément, ne nous voyons pas. Tu auras donc écrit un livre sur Bataille, et un livre qui lui est fidèle en un sens précis : c’est un livre excessif, un sur-Bataille en quelque sorte, et ce n’est pas pour rien que le sous-titre de ton livre invoque une esthétique “radicale”. Ma première question porterait sur ce motif de l’excès, de la radicalité, et du sur-, un préfixe fondamental dans cette recherche et dans le concept de “surcritique” que tu proposes. Car il s’agit pour toi de nous réveiller de notre sommeil immuno-esthétique. Mais ce sommeil n’est-il pas, d’une certaine manière, engendré par un excès d’images, de sons, de sollicitations électroniques ? Je pense ici à Mac Luhan, aux formes d’anesthésies qui succèderaient à des branchements technologiques trop brutaux, trop intenses…
B. M : Tu excèdes déjà avec cette première question le champ « étroit » du livre pour l’orienter dans la perspective de ce que Foucault appelle ontologie d’actualité. Mais tu as parfaitement raison de répondre à l’excès supposé de ce livre par un geste excessif, car en effet oui : tel est sans doute l’horizon et peut-être l’enjeu ultime du livre – penser l’altération de « notre » monde qui est une altération aisthétique. Tu y repères donc une situation de sur-esthésie (pour rester fidèles ainsi au préfixe « sur », si problématique, consciemment problématique). La condition dans laquelle nous vivons, sous les effets de l’exigence d’une croissance permanente, d’une effectivité, d’une con–sommation du monde (si j’ai recours à ton vocabulaire conceptuel), engage оu impose, en effet, une condition sur-esthétique : nous sommes jetés dans un flux intense d’images, de sons, d’écrans numériques, de prothèses techno-esthétiques ; nous y sommes surexposés, ou plutôt nous en sommes bombardés, absorbés. Nos sens n’arrivent plus à suivre nos prothèses – celles-ci se sont aventurées déjà beaucoup trop loin. Soit. Les faits et les effets sont incontestables, étouffants même. Sommes-nous donc en train de somnoler, ou peut-être de rester figés, abasourdis, hypnotisés par l’intensité techno-esthétique qui nous survient ?
Tentons d’abord de faire quelques distinctions. En désignant comme esthétique ou sur-esthétique cette situation qui trace le cadre de l’ontologie de l’actualité, on « complète » peut-être déjà par l’élément du sensible les « ontologies » du virtuel, de l’immatériel ou de l’inorganique, de Baudrillard à Perniola. Perniola parle par exemple de « la sexualité neutre de l’inorganique » comme d’un moment exemplaire de la transformation radicale de l’expérience sensible qui est en cours. Et cependant, cette densité, cette intensité, la sur-prothétisation de l’espace sensible qui fait violence à nos sens en les excédant et en leur imposant ainsi une condition transformée (qui s’échappe chaque jour du contrôle et de toute sorte de gouvernance vers l’imprévisible et l’incalculable et donc vers l’ouvert, l’ouvert du non-immun qui est peut-être, sans doute, un non-immun létal – pour reprendre ici tes motifs récents), est-elle aisthétique avant d’être sur-aisthétique ?
Or, c’est toi qui l’as affirmé en tentant de dépasser Heidegger : le nom ontologique actuel c’est la con–sommation du monde – qui est peut-être aussi sa consomption. La consommation est donc une réduction totale des modes du monde à la totalité, mais plus encore, elle est une réduction de la puissance ou du flux métamorphique à une production, à un mouvement dominé, réducteur, économique donc – en fin de compte c’est une « sublimation ». La consommation du monde serait ainsi le processus totalisant qui réduit les modes du monde – la pléthore des formes de vie ou d’être – à un réseau fonctionnel de types, dominés par la logique de la production, de la croissance et de la consommation : de la réduction du monde (l’appelle-t-on toujours « globalisation » ?)
Or, s’il s’agit d’une aisthétique, ce ne serait qu’une aisthétique ré-active : elle est toujours transcendée par un telos, le flux altérant y est réduit donc à un champ transcendant (ultimement, c’est la consommation – l’obsession par la présence totale de la chose, par l’accès immédiat, par une sorte d’orgasme absolu si l’on veut – avoir la chose comme présence ab-solue). Le champ aisthétique est réduit ainsi à une ressource et à un moyen, à des régimes d’usage qui sont des régimes d’exploitation et de domination. Si la condition actuelle est celle qui nous impose une sur-esthésie, ce ne serait pas au sens d’une augmentation radicale du champ aisthétique mais de sa réduction à une per-formance : il s’agit d’une totalisation privative – d’une privatisation – du champ du sensible, soumis à l’exigence de réagir à tous les stimuli d’ordre sensible. Il s’agit donc de politiques du sensible réactives voire réactionnaires, totalisantes voire totalitaires, qui réduisent le rythme politique immanent à l’aisthétique. Pour parler de leurs pulsions et impulsions, il faudrait sans doute revenir à ton Indemne. (Frédéric Neyrat, L’indemne. Heidegger et la destruction du monde, in Sens et Tonka, 2008) La panique esthétique actuelle qui déclenche des hystéries (et des catatonies) esthétiques ne serait donc, paradoxalement, qu’une limitation du champ aisthétique. Si on périphrase Benjamin, il s’agirait non pas de bio-esthétiser la politique mais de (re-)politiser la (bio-)aisthétique, ou plutôt de suivre son rythme politique immanent.
On peut prétendre dès lors que les nouvelles formes an-esthétiques, ces anesthésies nouvelles que tu évoques à la suite de Mac Luhan, sont également des formes de résistance de la puissance aisthétique, expressions de sa dureté, de sa persistance. Donc s’il s’agit d’une bataille, ce serait d’abord une bataille aisthétique, ou bien une bataille pour l’aisthétique. Contre l’hystérie aisthétique de l’actualité se dresse une an-esthétique – une aisthétique irréductible à un principe qui la transcende, expression altérante de la résistance propre à l’expérience sensible (dont je parle à travers Bataille dans le livre). Cette an-esthétique a ses modes contemporains singuliers : elle s’expérimente d’abord par des pratiques esthétiques au sens étroit du terme, qui tentent de transformer activement le champ de l’expérience sensible, en réaffirmant en fait sa puissance transformatrice tout en minant les tentatives réactionnaires de sa domination. Mais cette « ontologie (an)aisthétique de l’actualité » est l’horizon d’un prochain livre qui partira, cette fois-ci, de certaines pratiques de l’art contemporain, de la danse et la performance à la musique « noise » (quel oxymore !) Un article sur la « musique noise » que j’ai publié il y a deux ans dans Multitude en trace les contours. Mais je dois revenir ici sur le livre actuel.
Je n’aimerais surtout pas laisser l’impression que je suis en train d’affirmer l’image d’un champ aisthétique originaire, vierge, libre puisque vierge – une sorte d’âge d’or de la puissance aisthétique sauvage d’avant la condition techno-logique. Ici, il ne s’agit en aucun cas d’une vision rétro-utopique (et ce n’est d’ailleurs nullement la perspective de ma lecture de Bataille – je suis très loin de l’idée de « naturaliser » les figures de l’excès ou de la matière basse, et je suis en général extrêmement critique envers la tendance d’interprétation qui voit chez Bataille l’apologiste de la transgression et de l’excès : nulle tentation crypto-vitaliste !). Au contraire, il s’agit de penser la puissance techno-aisthétique comme immanente à toute expérience sensible et à toute l’expérience sensible qui apparaît dès lors, depuis « l’origine », comme une expérience technique. Et si les tekhnai aisthétiques sont les modes propres de la singularisation et de la trans-formation des formes de vie ou des modes du monde, ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui, c’est l’institution et le durcissement de régimes de pouvoir et de gouvernance techno-politico-économiques qui tentent de monopoliser le champ techno-aisthétique pour le soumettre à l’exigence de la per-formance totale, en réduisant ainsi radicalement les modes singuliers du devenir des formes de vie.
L’histoire de tous les nouveaux médias le montre nettement. Chaque nouveau média élargit le champ du sensible en ouvrant l’espace nécessaire pour expérimenter de nouvelles possibilités de subjectivation, politique y comprise – mais il succombe presque immédiatement après sa mise en marche sous les assauts corporatifs qui le transforment en champ profitable, c’est-à-dire le réduisent à une ressource, à une « matière première », peu importe la complexité de son dispositif : voici comment s’effectue l’opération rétro-grade. Pensons à l’histoire de la caméra depuis les frères Lumière jusqu’aux dispositifs contemporains de surveillance, ou aux spectacles terrifiants (prémonitoires ?) de ces camps télévisés – les « Big Brother »… Ainsi, le champ de bataille prolifère aujourd’hui dans tous les sens : dans tous les technologies et médias, dans tous les tekhnai – et dans tous les sens… Ballard est-il plus grand prophète que McLuhan ? Et Bataille ?
F. N : Il s’agirait donc de mener une bataille esthétique, c’est-à-dire une guerre de l’imaginaire. Il est dès lors essentiel de bien connaitre ses armes, et pour le coup de savoir ce qu’on entend par image, terme que tu choisis, et que j’ai aussi choisi dans L’image hors-l’image. Dans ton livre, tu définis toujours l’image à partir d’un quelque-chose-en-plus, tu écris par exemple que « l’image, c’est le plus-qu’un de la présence », tu affirmes que « rien ne manque à l’image » et tu t’opposes ainsi à « un certain iconoclasme nouveau », qui n’est d’ailleurs peut-être pas totalement nouveau d’ailleurs, « dont le geste principal se borne à la réduction de l’image à un moins que l’image (un vide, un défaut, un inimaginable, un sublime, un interdit de la représentation, etc.) ». Je suis entièrement d’accord sur le fait qu’il faut combattre toute théologisation de l’image, qui aura toujours pour effet de nous faire baisser les yeux dévotement en vue du Grand Transcendant, et de condamner ce qui se présentera artistiquement sous la forme du défaut de défaut, je pense ici à une philosophe qui condamnait Matthew Barney au prétexte de sa « perversion » et de son « fascisme »… Moraline que cela… Et je sais bien aussi qu’il s’agit de refuser un certain geste classique de critique des images comme reflets amoindris, qui manqueraient de réalité, etc. Mais, cependant, pourquoi répudier la présence du moins-un dans l’image, dans sa texture même, dans son procès de transformation ? N’ y-a-t’ il pas, dans les images de l’art, de la présentation de moins-un, comme mouvement de soustraction, défaut apparent, trou, fêlure, absence ? N’est-ce pas aussi avec cette arme du moins-un que l’on peut s’attaquer à la « privatisation » esthétique dont tu viens de parler ?
B. M : Oui, tout à fait d’accord au sujet du moins-un ! C’est sûr, absolument, il faut combattre non seulement les nouveaux anciens iconoclasmes qui creusent la chair de l’image pour extirper son cœur de vide transcendant et le poser dans leurs autels, mais aussi les tendances à réduire l’image à une plénitude expressive, identique à soi dans l’acte de la présentation ou de la performance, image pleine, bien formée et donc conforme aux codes économico-sémiotiques et aux impératifs de la con-sommation : un certain degré de l’accumulation du capital, selon la définition debordienne de la société du spectacle (« Le spectacle est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image »). Il faut sans doute s’opposer à cette plénitude-là, et à cette économie des images qui exploite leur visibilité en les réduisant à des signes ou à des stimuli esthétiques, en les figeant donc dans une forme, dans une signification, dans une transparence sans intensité, dans une valeur (d’échange), dans une marchandise, dans une per-formance de forme de vie. Or, en parlant de l’image en tant que « plus-qu’un de la présence », j’ai en vue précisément la puissance de l’image de résister à cette prise, de résister à sa propre production et fonctionnalisation, d’excéder l’économie esthétique restreinte. Oui, le plus-qu’un de l’image indique certainement un mouvement excessif mais ce n’est aucunement un excès de la plénitude, une énergie vitale, matérielle ou esthétique, qui déborde. En revanche, c’est une puissance mais aussi une énergie de trans-formation ; l’image en tant que plus-qu’un de la présence est la puissance de présenter autrement : en ce sens, l’image c’est le mouvement altérant de la présence, un « élément » du mouvement syncopé de l’altération. L’image comme un noeud d’intensité aisthétique.
En fait, l’iconodulie de la tradition de pensée qui est la nôtre est sans doute encore plus profonde et plus puissante que son iconoclasme. Et les tendances iconoclastes, exprimant l’intuition de la puissance dangereuse de l’image, n’en sont peut-être que le signe négatif. Cette iconodulie ou plutôt iconocentrisme est la conséquence logique de l’ocularcentrisme de l’Occident, qui est aussi un iconocentrisme esthétique. Nous avons toujours tendance à penser de « l’œuvre d’art » ou plutôt de la pratique d’art comme composée d’images. Mais est-ce toujours le cas ? Dans cette perspective « pratique » l’image hors-l’image est un concept stimulant. Voici un exemple radical, la pratique du collectif artistique viennois WochenKlausur. Je cite la manière dont le collectif présente sa propre activité sur son site : « Since 1993 and on invitation from different art institutions, the artist group WochenKlausur develops concrete proposals aimed at small, but nevertheless effective improvements to socio-political deficiencies. Proceeding even further and invariably translating these proposals into action, artistic creativity is no longer seen as a formal act but as an intervention into society. » Le résultat de leurs interventions, c’est par exemple la création d’un service d’aide médicale d’urgence pour des personnes sans assurance médicale et sans abri, ou bien d’un centre d’hébergement, etc. Il y a donc une situation donnée, situation de déficit ou de manque (manque de justice au fond) où une intervention critique a lieu. Cette intervention critique transforme la situation donnée et produit un effet. L’acte de cette intervention est singulier, c’est donc un acte artistique mais aussi une praxis aisthétique puisqu’on observe la recomposition d’un champ de forces (matérielles, sociales, politiques, subjectives) qui neutralise un déficit, qui est donc un acte affirmatif. Le moins-un de l’image de l’art que tu évoques, ne serait-ce donc pas avant tout ce mouvement altérant de la praxis artistique, l’autrement de la transformation, en d’autres termes de la possibilité d’émergence de l’événement ?
F. N : Permets-moi d’insister à nouveau sur la question de la négativité, et j’aurais envie de te poser la question de façon presque naïve : pourquoi, après tout, sortir de la logique de la négativité, et en quel sens ? Dans ton livre, tu dis que l’« on pourrait à juste titre reprocher à Bataille l’utilisation imprudente de ce mot », celui de « destruction », qui « présuppose l’ordre de la négativité », tu parles d’un « moment « négatif » qui n’est pas négatif puisqu’il n’est pas une suppression ». Mais pourquoi cela pose un problème, cet ordre de la négativité ? Sauf si c’est un Ordre surmoïque bien entendu… Tu définis l’image comme « l’intensité maximale de la présence du monde », et je pensais en te lisant à ce qu’écrit Nancy dans L’expérience de la liberté, où il parle de « l’intensification de la négativité jusqu’à l’affirmation », il parle d’une intensification du néant qui « ne nie pas sa néantité » mais « la porte jusqu’à son incandescence ». Il y a bien ici une sorte de logique paradialectique, qui dévie de la dialectique en substituant à une seconde négation une intensification, mais il y a bien aussi la reconnaissance de l’ordre de la négativité ! Or pour te dire les choses un peu trop vite, je me demande si notre époque ne tend pas à reculer devant le négatif … Ou, mais c’est la même chose, à se forclore de la puissance du négatif, au point que celui-ci ait toute latitude possible pour fabriquer du non-monde, de la dévastation. Le capitalisme se charge de la négativité qu’on a laissée sans emploi. Je ne dis pas que « regarder le négatif droit dans les yeux » fasse office d’inspiration créatrice, je dis simplement que l’émergence de l’événement, pour reprendre ce que tu dis, implique un rapport de grande proximité avec la négativité. Avec cela se pose la question de la transformation comme altération : être autrement, c’est risquer de ne pas se reconnaître, c’est risquer que l’on ne nous reconnaisse plus, c’est au moins éprouver ce que dit Beckett : « j’étais déjà ce que je suis, et je suis si différent de ce que j’étais », et cela c’est si ce n’est l’Ordre du négatif, tout du moins son insistante présence. Et je ne parle pas ici du Tout-Autre ! Je parle de ce qui peut arriver à même ce qui devient vraiment comme si on ne l’avait jamais vu, comme si on en n’avait jamais entendu parler, comme si jamais l’art et la politique n’avaient su ainsi faire noces. Peut-être suis-je romantique en art. Comme si j’étais resté fixé sur « et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir »… Ce qui peut se dire encore d’une troisième manière : si l’on supprime trop la dimension de la négativité, ou le risque de l’irreconnaissable, ne risque-t-on pas d’aboutir à des processus de transformations, sans véritable transformation … Je ne cherche pas ici à te provoquer, mais à savoir ce que tu pourrais dire du non-transformable et des pseudo-transformations, si cela existe. Être flexible, par exemple, n’est pas se transformer …
B. M : En effet, la question de la négativité est cruciale. C’est aussi sans doute un des leitmotive du livre. Je désigne les pensées ontologiques qui se situent dans la lignée hégélienne-heideggerienne comme ontologies de la négativité (ou bien, plus simplement, ontologies négatives). En simplifiant à l’extrême, on peut affirmer que ce sont des ontologies qui mettent à leur base une négativité constitutive qui serait la transposition sur le plan conceptuel de l’expérience de la finitude. L’héritage de la négativité apparaît comme un héritage théologique, et c’est un héritage structurel : la relève de la finitude par un événement absolu disruptif, Absolu ou Ereignis. L’événement de l’achèvement de l’être – du devenir de l’Esprit chez Hegel –, la négation de la négation finale est la relève de tout le régime fini, le régime du devenir. Il ne s’agit donc pas de se forclore de la négativité mais précisément d’aborder une négativité radicale, c’est-à-dire sans économie, ni ontologique ni dialectique, salutaire toujours, pour affronter « la logique de la négativité ». Bataille, Blanchot, Merleau-Ponty, Nancy en ont posé les jalons. (On peut rappeler par exemple la critique de la négativité dialectique chez le dernier Merleau-Ponty, dans Le visible et l’invisible). Pour évoquer à mon tour Nancy, je citerai une affirmation de son Être singulier pluriel, de laquelle je me sens très proche : “Le rien (pour garder ce mot sec et le rendre coupant envers tous les “abîmes” et toutes leurs profondeurs), le rien qui n’est rien “au fond” et qui n’est que le rien d’un saut dans rien, est la négativité qui n’est pas une ressource, mais qui est l’affirmation de la tension ek-sistante : son intensité, l’intensité ou le ton surprenant de l’existence. » Il s’agit donc de radicaliser, voire d’excéder la négativité fondatrice ou dialectique dans la voie d’une négativité « pure », « sans emploi » au sens de Bataille. Dans ma lecture de Nancy j’ai essayé de lire cette proposition en la juxtaposant à l’ « ontologie modale » développée dans Corpus, qui est une véritable ontologie de la métamorphose. Quand je me propose de critiquer la « logique de la négativité », j’ai en vue précisément la réduction totalisante ou la relève de ce vide par une économie « restreinte ». Il ne s’agit aucunement d’affirmer une plénitude sans vide : pas de transformation sans ce vide. Mais le vide n’est pas substantiel : il est modal. Il est la puissance de l’autrement. Tel est le lien entre la critique de la négativité et l’alternative que j’essaie de proposer avec le concept d’altération. Bataille lui-même a saisi les risques d’une surdétermination négative, c’est son concept de « matière basse » qui l’atteste : « Aussi, à ce qu’il faut bien appeler la matière, puisque cela existe en dehors de moi et de l’idée, je me soumets entièrement et, dans ce sens, je n’admets pas que ma raison devienne la limite de ce que j’ai dit, car si je procédais ainsi, la matière limitée par ma raison prendrait aussitôt la valeur d’un principe supérieur. » (« Le bas matérialisme et la gnose »).
De ce point de vue, la métamorphose serait ce qui excède la logique messianique de la négativité, ce qui persiste en tant que devenir à même l’événement : c’est une événementialité continue, c’est-à-dire la coïncidence du continu et du discontinu. Elle est tout autre chose que la fluidité et la flexibilité réductrice, « faible », productrice d’une substance fausse, c’est-à-dire d’une ressource. Évidemment, être flexible ce n’est pas se transformer. La fluidité prétendue du capitalisme de nos jours et de son Léviathan immatériel est tout autre chose que ce que j’appelle métamorphose ou altération. Inversement, celle-ci est la tentative de leur absorption, c’est-à-dire de leur réduction. Si la transformation actuelle est sans précédent dans sa radicalité, c’est parce que le biocapitalisme actuel approprie et marchandise le potentiel de transformation des formes de vie, leur transformabilité d’origine qui seule rend possible leur multiplicité irréductible. Ce n’est rien d’autre que l’appropriation économique du vide inappropriable entre les singularités, de l’an-archie d’origine du politique – et par conséquent la réduction et la soumission de la pléthore des formes de vie à l’impératif per-formant du capital.
Il faut poser à nouveaux frais la question de ce qui ne change pas dans un monde où tout est censé changer, comme tu l’écris dans « Désintégrer. Programme philosophique ». Sans chercher des proximités conceptuelles à tout prix, je pense que j’ai tâtonné dans la même voie avec la notion de la persistance. Or, la persistance, c’est changer et être changé tout en persistant dans le changement, ne pas se laisser emporter par la fluidité. Persister veut dire à la fois résister et aller toujours plus loin par et dans le changement, ou bien, transformer la transformation. Là où les forces de la nouvelle réaction engloutissent chaque jour davantage la puissance de transformation pour la soumettre aux impératifs de la production et de la croissance, ayant engagé l’altération de notre monde, cette transformation de la transformation est notre tâche : philosophique, politique.
C’est seulement en ce sens que la critique de la négativité fraye le chemin d’une pensée de la négativité radicale qui est aussi, oui, en effet, je le crois, une pensée affirmative.


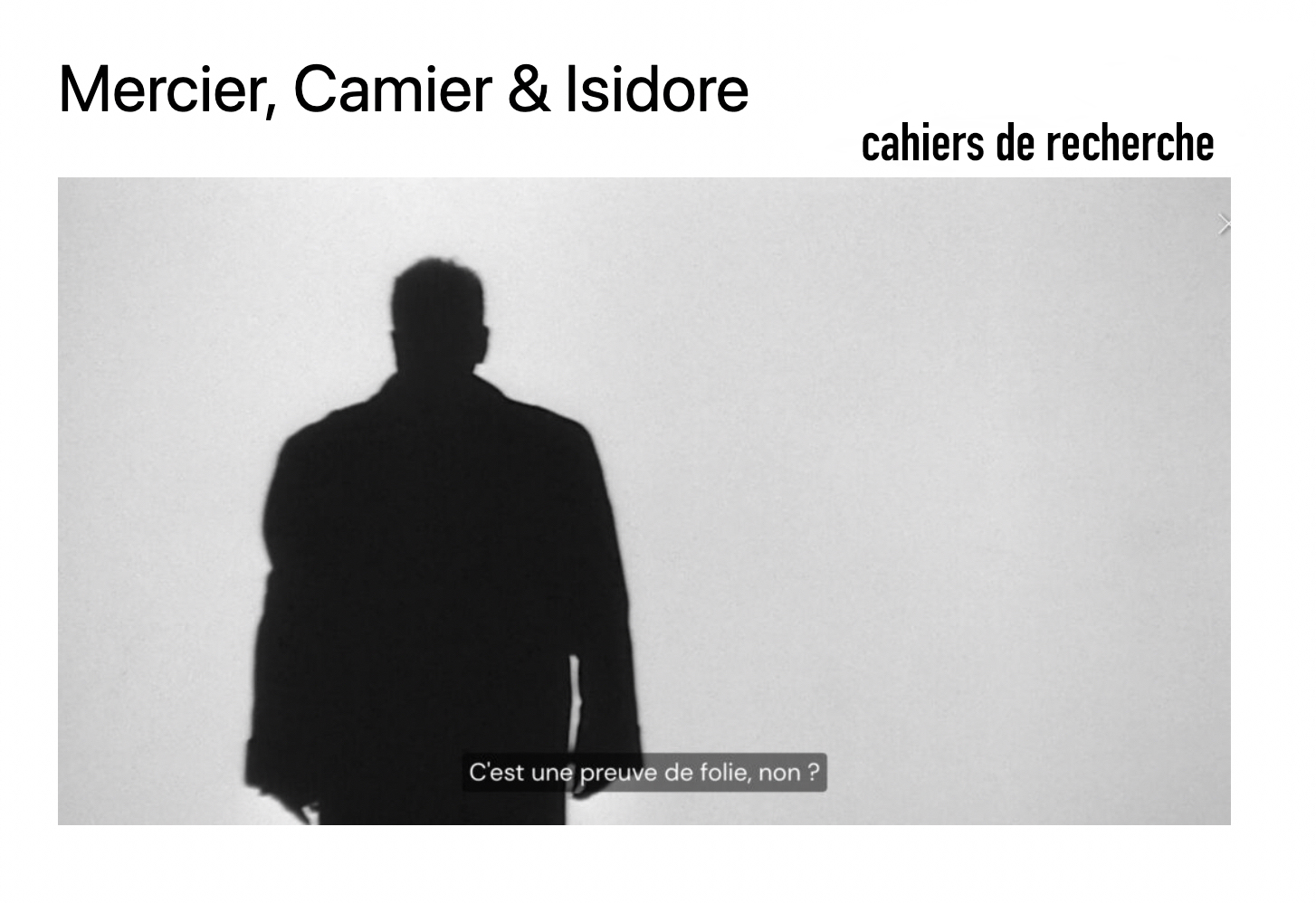



L’ image intense
Entretien avec Boyan Manchev autour de L’Altération du monde. Pour une esthétique radicale (Lignes, avril 2009)
Cet été, Frédéric Neyrat nous a fait part d’un échange qu’il avait eu en mai 2009 avec Boyan Manchev à propos de son ouvrage L’altération du monde. C’est le contenu de cet entretien que nous publions ici et cela aussi pour prolonger un autre entretien – audio – que nous avions eu avec Boyan Manchev, toujours autours de cet ouvrage publié aux éditions Lignes.
***
F. N : Voilà, pour commencer, puisqu’il s’agira de vue et d’espace, du Dasein de la vue pour nous qui, précisément, ne nous voyons pas. Tu auras donc écrit un livre sur Bataille, et un livre qui lui est fidèle en un sens précis : c’est un livre excessif, un sur-Bataille en quelque sorte, et ce n’est pas pour rien que le sous-titre de ton livre invoque une esthétique “radicale”. Ma première question porterait sur ce motif de l’excès, de la radicalité, et du sur-, un préfixe fondamental dans cette recherche et dans le concept de “surcritique” que tu proposes. Car il s’agit pour toi de nous réveiller de notre sommeil immuno-esthétique. Mais ce sommeil n’est-il pas, d’une certaine manière, engendré par un excès d’images, de sons, de sollicitations électroniques ? Je pense ici à Mac Luhan, aux formes d’anesthésies qui succèderaient à des branchements technologiques trop brutaux, trop intenses…
B. M : Tu excèdes déjà avec cette première question le champ « étroit » du livre pour l’orienter dans la perspective de ce que Foucault appelle ontologie d’actualité. Mais tu as parfaitement raison de répondre à l’excès supposé de ce livre par un geste excessif, car en effet oui : tel est sans doute l’horizon et peut-être l’enjeu ultime du livre – penser l’altération de « notre » monde qui est une altération aisthétique. Tu y repères donc une situation de sur-esthésie (pour rester fidèles ainsi au préfixe « sur », si problématique, consciemment problématique). La condition dans laquelle nous vivons, sous les effets de l’exigence d’une croissance permanente, d’une effectivité, d’une con–sommation du monde (si j’ai recours à ton vocabulaire conceptuel), engage оu impose, en effet, une condition sur-esthétique : nous sommes jetés dans un flux intense d’images, de sons, d’écrans numériques, de prothèses techno-esthétiques ; nous y sommes surexposés, ou plutôt nous en sommes bombardés, absorbés. Nos sens n’arrivent plus à suivre nos prothèses – celles-ci se sont aventurées déjà beaucoup trop loin. Soit. Les faits et les effets sont incontestables, étouffants même. Sommes-nous donc en train de somnoler, ou peut-être de rester figés, abasourdis, hypnotisés par l’intensité techno-esthétique qui nous survient ?
Tentons d’abord de faire quelques distinctions. En désignant comme esthétique ou sur-esthétique cette situation qui trace le cadre de l’ontologie de l’actualité, on « complète » peut-être déjà par l’élément du sensible les « ontologies » du virtuel, de l’immatériel ou de l’inorganique, de Baudrillard à Perniola. Perniola parle par exemple de « la sexualité neutre de l’inorganique » comme d’un moment exemplaire de la transformation radicale de l’expérience sensible qui est en cours. Et cependant, cette densité, cette intensité, la sur-prothétisation de l’espace sensible qui fait violence à nos sens en les excédant et en leur imposant ainsi une condition transformée (qui s’échappe chaque jour du contrôle et de toute sorte de gouvernance vers l’imprévisible et l’incalculable et donc vers l’ouvert, l’ouvert du non-immun qui est peut-être, sans doute, un non-immun létal – pour reprendre ici tes motifs récents), est-elle aisthétique avant d’être sur-aisthétique ?
Or, c’est toi qui l’as affirmé en tentant de dépasser Heidegger : le nom ontologique actuel c’est la con–sommation du monde – qui est peut-être aussi sa consomption. La consommation est donc une réduction totale des modes du monde à la totalité, mais plus encore, elle est une réduction de la puissance ou du flux métamorphique à une production, à un mouvement dominé, réducteur, économique donc – en fin de compte c’est une « sublimation ». La consommation du monde serait ainsi le processus totalisant qui réduit les modes du monde – la pléthore des formes de vie ou d’être – à un réseau fonctionnel de types, dominés par la logique de la production, de la croissance et de la consommation : de la réduction du monde (l’appelle-t-on toujours « globalisation » ?)
Or, s’il s’agit d’une aisthétique, ce ne serait qu’une aisthétique ré-active : elle est toujours transcendée par un telos, le flux altérant y est réduit donc à un champ transcendant (ultimement, c’est la consommation – l’obsession par la présence totale de la chose, par l’accès immédiat, par une sorte d’orgasme absolu si l’on veut – avoir la chose comme présence ab-solue). Le champ aisthétique est réduit ainsi à une ressource et à un moyen, à des régimes d’usage qui sont des régimes d’exploitation et de domination. Si la condition actuelle est celle qui nous impose une sur-esthésie, ce ne serait pas au sens d’une augmentation radicale du champ aisthétique mais de sa réduction à une per-formance : il s’agit d’une totalisation privative – d’une privatisation – du champ du sensible, soumis à l’exigence de réagir à tous les stimuli d’ordre sensible. Il s’agit donc de politiques du sensible réactives voire réactionnaires, totalisantes voire totalitaires, qui réduisent le rythme politique immanent à l’aisthétique. Pour parler de leurs pulsions et impulsions, il faudrait sans doute revenir à ton Indemne. (Frédéric Neyrat, L’indemne. Heidegger et la destruction du monde, in Sens et Tonka, 2008) La panique esthétique actuelle qui déclenche des hystéries (et des catatonies) esthétiques ne serait donc, paradoxalement, qu’une limitation du champ aisthétique. Si on périphrase Benjamin, il s’agirait non pas de bio-esthétiser la politique mais de (re-)politiser la (bio-)aisthétique, ou plutôt de suivre son rythme politique immanent.
On peut prétendre dès lors que les nouvelles formes an-esthétiques, ces anesthésies nouvelles que tu évoques à la suite de Mac Luhan, sont également des formes de résistance de la puissance aisthétique, expressions de sa dureté, de sa persistance. Donc s’il s’agit d’une bataille, ce serait d’abord une bataille aisthétique, ou bien une bataille pour l’aisthétique. Contre l’hystérie aisthétique de l’actualité se dresse une an-esthétique – une aisthétique irréductible à un principe qui la transcende, expression altérante de la résistance propre à l’expérience sensible (dont je parle à travers Bataille dans le livre). Cette an-esthétique a ses modes contemporains singuliers : elle s’expérimente d’abord par des pratiques esthétiques au sens étroit du terme, qui tentent de transformer activement le champ de l’expérience sensible, en réaffirmant en fait sa puissance transformatrice tout en minant les tentatives réactionnaires de sa domination. Mais cette « ontologie (an)aisthétique de l’actualité » est l’horizon d’un prochain livre qui partira, cette fois-ci, de certaines pratiques de l’art contemporain, de la danse et la performance à la musique « noise » (quel oxymore !) Un article sur la « musique noise » que j’ai publié il y a deux ans dans Multitude en trace les contours. Mais je dois revenir ici sur le livre actuel.
Je n’aimerais surtout pas laisser l’impression que je suis en train d’affirmer l’image d’un champ aisthétique originaire, vierge, libre puisque vierge – une sorte d’âge d’or de la puissance aisthétique sauvage d’avant la condition techno-logique. Ici, il ne s’agit en aucun cas d’une vision rétro-utopique (et ce n’est d’ailleurs nullement la perspective de ma lecture de Bataille – je suis très loin de l’idée de « naturaliser » les figures de l’excès ou de la matière basse, et je suis en général extrêmement critique envers la tendance d’interprétation qui voit chez Bataille l’apologiste de la transgression et de l’excès : nulle tentation crypto-vitaliste !). Au contraire, il s’agit de penser la puissance techno-aisthétique comme immanente à toute expérience sensible et à toute l’expérience sensible qui apparaît dès lors, depuis « l’origine », comme une expérience technique. Et si les tekhnai aisthétiques sont les modes propres de la singularisation et de la trans-formation des formes de vie ou des modes du monde, ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui, c’est l’institution et le durcissement de régimes de pouvoir et de gouvernance techno-politico-économiques qui tentent de monopoliser le champ techno-aisthétique pour le soumettre à l’exigence de la per-formance totale, en réduisant ainsi radicalement les modes singuliers du devenir des formes de vie.
L’histoire de tous les nouveaux médias le montre nettement. Chaque nouveau média élargit le champ du sensible en ouvrant l’espace nécessaire pour expérimenter de nouvelles possibilités de subjectivation, politique y comprise – mais il succombe presque immédiatement après sa mise en marche sous les assauts corporatifs qui le transforment en champ profitable, c’est-à-dire le réduisent à une ressource, à une « matière première », peu importe la complexité de son dispositif : voici comment s’effectue l’opération rétro-grade. Pensons à l’histoire de la caméra depuis les frères Lumière jusqu’aux dispositifs contemporains de surveillance, ou aux spectacles terrifiants (prémonitoires ?) de ces camps télévisés – les « Big Brother »… Ainsi, le champ de bataille prolifère aujourd’hui dans tous les sens : dans tous les technologies et médias, dans tous les tekhnai – et dans tous les sens… Ballard est-il plus grand prophète que McLuhan ? Et Bataille ?
F. N : Il s’agirait donc de mener une bataille esthétique, c’est-à-dire une guerre de l’imaginaire. Il est dès lors essentiel de bien connaitre ses armes, et pour le coup de savoir ce qu’on entend par image, terme que tu choisis, et que j’ai aussi choisi dans L’image hors-l’image. Dans ton livre, tu définis toujours l’image à partir d’un quelque-chose-en-plus, tu écris par exemple que « l’image, c’est le plus-qu’un de la présence », tu affirmes que « rien ne manque à l’image » et tu t’opposes ainsi à « un certain iconoclasme nouveau », qui n’est d’ailleurs peut-être pas totalement nouveau d’ailleurs, « dont le geste principal se borne à la réduction de l’image à un moins que l’image (un vide, un défaut, un inimaginable, un sublime, un interdit de la représentation, etc.) ». Je suis entièrement d’accord sur le fait qu’il faut combattre toute théologisation de l’image, qui aura toujours pour effet de nous faire baisser les yeux dévotement en vue du Grand Transcendant, et de condamner ce qui se présentera artistiquement sous la forme du défaut de défaut, je pense ici à une philosophe qui condamnait Matthew Barney au prétexte de sa « perversion » et de son « fascisme »… Moraline que cela… Et je sais bien aussi qu’il s’agit de refuser un certain geste classique de critique des images comme reflets amoindris, qui manqueraient de réalité, etc. Mais, cependant, pourquoi répudier la présence du moins-un dans l’image, dans sa texture même, dans son procès de transformation ? N’ y-a-t’ il pas, dans les images de l’art, de la présentation de moins-un, comme mouvement de soustraction, défaut apparent, trou, fêlure, absence ? N’est-ce pas aussi avec cette arme du moins-un que l’on peut s’attaquer à la « privatisation » esthétique dont tu viens de parler ?
B. M : Oui, tout à fait d’accord au sujet du moins-un ! C’est sûr, absolument, il faut combattre non seulement les nouveaux anciens iconoclasmes qui creusent la chair de l’image pour extirper son cœur de vide transcendant et le poser dans leurs autels, mais aussi les tendances à réduire l’image à une plénitude expressive, identique à soi dans l’acte de la présentation ou de la performance, image pleine, bien formée et donc conforme aux codes économico-sémiotiques et aux impératifs de la con-sommation : un certain degré de l’accumulation du capital, selon la définition debordienne de la société du spectacle (« Le spectacle est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image »). Il faut sans doute s’opposer à cette plénitude-là, et à cette économie des images qui exploite leur visibilité en les réduisant à des signes ou à des stimuli esthétiques, en les figeant donc dans une forme, dans une signification, dans une transparence sans intensité, dans une valeur (d’échange), dans une marchandise, dans une per-formance de forme de vie. Or, en parlant de l’image en tant que « plus-qu’un de la présence », j’ai en vue précisément la puissance de l’image de résister à cette prise, de résister à sa propre production et fonctionnalisation, d’excéder l’économie esthétique restreinte. Oui, le plus-qu’un de l’image indique certainement un mouvement excessif mais ce n’est aucunement un excès de la plénitude, une énergie vitale, matérielle ou esthétique, qui déborde. En revanche, c’est une puissance mais aussi une énergie de trans-formation ; l’image en tant que plus-qu’un de la présence est la puissance de présenter autrement : en ce sens, l’image c’est le mouvement altérant de la présence, un « élément » du mouvement syncopé de l’altération. L’image comme un noeud d’intensité aisthétique.
En fait, l’iconodulie de la tradition de pensée qui est la nôtre est sans doute encore plus profonde et plus puissante que son iconoclasme. Et les tendances iconoclastes, exprimant l’intuition de la puissance dangereuse de l’image, n’en sont peut-être que le signe négatif. Cette iconodulie ou plutôt iconocentrisme est la conséquence logique de l’ocularcentrisme de l’Occident, qui est aussi un iconocentrisme esthétique. Nous avons toujours tendance à penser de « l’œuvre d’art » ou plutôt de la pratique d’art comme composée d’images. Mais est-ce toujours le cas ? Dans cette perspective « pratique » l’image hors-l’image est un concept stimulant. Voici un exemple radical, la pratique du collectif artistique viennois WochenKlausur. Je cite la manière dont le collectif présente sa propre activité sur son site : « Since 1993 and on invitation from different art institutions, the artist group WochenKlausur develops concrete proposals aimed at small, but nevertheless effective improvements to socio-political deficiencies. Proceeding even further and invariably translating these proposals into action, artistic creativity is no longer seen as a formal act but as an intervention into society. » Le résultat de leurs interventions, c’est par exemple la création d’un service d’aide médicale d’urgence pour des personnes sans assurance médicale et sans abri, ou bien d’un centre d’hébergement, etc. Il y a donc une situation donnée, situation de déficit ou de manque (manque de justice au fond) où une intervention critique a lieu. Cette intervention critique transforme la situation donnée et produit un effet. L’acte de cette intervention est singulier, c’est donc un acte artistique mais aussi une praxis aisthétique puisqu’on observe la recomposition d’un champ de forces (matérielles, sociales, politiques, subjectives) qui neutralise un déficit, qui est donc un acte affirmatif. Le moins-un de l’image de l’art que tu évoques, ne serait-ce donc pas avant tout ce mouvement altérant de la praxis artistique, l’autrement de la transformation, en d’autres termes de la possibilité d’émergence de l’événement ?
F. N : Permets-moi d’insister à nouveau sur la question de la négativité, et j’aurais envie de te poser la question de façon presque naïve : pourquoi, après tout, sortir de la logique de la négativité, et en quel sens ? Dans ton livre, tu dis que l’« on pourrait à juste titre reprocher à Bataille l’utilisation imprudente de ce mot », celui de « destruction », qui « présuppose l’ordre de la négativité », tu parles d’un « moment « négatif » qui n’est pas négatif puisqu’il n’est pas une suppression ». Mais pourquoi cela pose un problème, cet ordre de la négativité ? Sauf si c’est un Ordre surmoïque bien entendu… Tu définis l’image comme « l’intensité maximale de la présence du monde », et je pensais en te lisant à ce qu’écrit Nancy dans L’expérience de la liberté, où il parle de « l’intensification de la négativité jusqu’à l’affirmation », il parle d’une intensification du néant qui « ne nie pas sa néantité » mais « la porte jusqu’à son incandescence ». Il y a bien ici une sorte de logique paradialectique, qui dévie de la dialectique en substituant à une seconde négation une intensification, mais il y a bien aussi la reconnaissance de l’ordre de la négativité ! Or pour te dire les choses un peu trop vite, je me demande si notre époque ne tend pas à reculer devant le négatif … Ou, mais c’est la même chose, à se forclore de la puissance du négatif, au point que celui-ci ait toute latitude possible pour fabriquer du non-monde, de la dévastation. Le capitalisme se charge de la négativité qu’on a laissée sans emploi. Je ne dis pas que « regarder le négatif droit dans les yeux » fasse office d’inspiration créatrice, je dis simplement que l’émergence de l’événement, pour reprendre ce que tu dis, implique un rapport de grande proximité avec la négativité. Avec cela se pose la question de la transformation comme altération : être autrement, c’est risquer de ne pas se reconnaître, c’est risquer que l’on ne nous reconnaisse plus, c’est au moins éprouver ce que dit Beckett : « j’étais déjà ce que je suis, et je suis si différent de ce que j’étais », et cela c’est si ce n’est l’Ordre du négatif, tout du moins son insistante présence. Et je ne parle pas ici du Tout-Autre ! Je parle de ce qui peut arriver à même ce qui devient vraiment comme si on ne l’avait jamais vu, comme si on en n’avait jamais entendu parler, comme si jamais l’art et la politique n’avaient su ainsi faire noces. Peut-être suis-je romantique en art. Comme si j’étais resté fixé sur « et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir »… Ce qui peut se dire encore d’une troisième manière : si l’on supprime trop la dimension de la négativité, ou le risque de l’irreconnaissable, ne risque-t-on pas d’aboutir à des processus de transformations, sans véritable transformation … Je ne cherche pas ici à te provoquer, mais à savoir ce que tu pourrais dire du non-transformable et des pseudo-transformations, si cela existe. Être flexible, par exemple, n’est pas se transformer …
B. M : En effet, la question de la négativité est cruciale. C’est aussi sans doute un des leitmotive du livre. Je désigne les pensées ontologiques qui se situent dans la lignée hégélienne-heideggerienne comme ontologies de la négativité (ou bien, plus simplement, ontologies négatives). En simplifiant à l’extrême, on peut affirmer que ce sont des ontologies qui mettent à leur base une négativité constitutive qui serait la transposition sur le plan conceptuel de l’expérience de la finitude. L’héritage de la négativité apparaît comme un héritage théologique, et c’est un héritage structurel : la relève de la finitude par un événement absolu disruptif, Absolu ou Ereignis. L’événement de l’achèvement de l’être – du devenir de l’Esprit chez Hegel –, la négation de la négation finale est la relève de tout le régime fini, le régime du devenir. Il ne s’agit donc pas de se forclore de la négativité mais précisément d’aborder une négativité radicale, c’est-à-dire sans économie, ni ontologique ni dialectique, salutaire toujours, pour affronter « la logique de la négativité ». Bataille, Blanchot, Merleau-Ponty, Nancy en ont posé les jalons. (On peut rappeler par exemple la critique de la négativité dialectique chez le dernier Merleau-Ponty, dans Le visible et l’invisible). Pour évoquer à mon tour Nancy, je citerai une affirmation de son Être singulier pluriel, de laquelle je me sens très proche : “Le rien (pour garder ce mot sec et le rendre coupant envers tous les “abîmes” et toutes leurs profondeurs), le rien qui n’est rien “au fond” et qui n’est que le rien d’un saut dans rien, est la négativité qui n’est pas une ressource, mais qui est l’affirmation de la tension ek-sistante : son intensité, l’intensité ou le ton surprenant de l’existence. » Il s’agit donc de radicaliser, voire d’excéder la négativité fondatrice ou dialectique dans la voie d’une négativité « pure », « sans emploi » au sens de Bataille. Dans ma lecture de Nancy j’ai essayé de lire cette proposition en la juxtaposant à l’ « ontologie modale » développée dans Corpus, qui est une véritable ontologie de la métamorphose. Quand je me propose de critiquer la « logique de la négativité », j’ai en vue précisément la réduction totalisante ou la relève de ce vide par une économie « restreinte ». Il ne s’agit aucunement d’affirmer une plénitude sans vide : pas de transformation sans ce vide. Mais le vide n’est pas substantiel : il est modal. Il est la puissance de l’autrement. Tel est le lien entre la critique de la négativité et l’alternative que j’essaie de proposer avec le concept d’altération. Bataille lui-même a saisi les risques d’une surdétermination négative, c’est son concept de « matière basse » qui l’atteste : « Aussi, à ce qu’il faut bien appeler la matière, puisque cela existe en dehors de moi et de l’idée, je me soumets entièrement et, dans ce sens, je n’admets pas que ma raison devienne la limite de ce que j’ai dit, car si je procédais ainsi, la matière limitée par ma raison prendrait aussitôt la valeur d’un principe supérieur. » (« Le bas matérialisme et la gnose »).
De ce point de vue, la métamorphose serait ce qui excède la logique messianique de la négativité, ce qui persiste en tant que devenir à même l’événement : c’est une événementialité continue, c’est-à-dire la coïncidence du continu et du discontinu. Elle est tout autre chose que la fluidité et la flexibilité réductrice, « faible », productrice d’une substance fausse, c’est-à-dire d’une ressource. Évidemment, être flexible ce n’est pas se transformer. La fluidité prétendue du capitalisme de nos jours et de son Léviathan immatériel est tout autre chose que ce que j’appelle métamorphose ou altération. Inversement, celle-ci est la tentative de leur absorption, c’est-à-dire de leur réduction. Si la transformation actuelle est sans précédent dans sa radicalité, c’est parce que le biocapitalisme actuel approprie et marchandise le potentiel de transformation des formes de vie, leur transformabilité d’origine qui seule rend possible leur multiplicité irréductible. Ce n’est rien d’autre que l’appropriation économique du vide inappropriable entre les singularités, de l’an-archie d’origine du politique – et par conséquent la réduction et la soumission de la pléthore des formes de vie à l’impératif per-formant du capital.
Il faut poser à nouveaux frais la question de ce qui ne change pas dans un monde où tout est censé changer, comme tu l’écris dans « Désintégrer. Programme philosophique ». Sans chercher des proximités conceptuelles à tout prix, je pense que j’ai tâtonné dans la même voie avec la notion de la persistance. Or, la persistance, c’est changer et être changé tout en persistant dans le changement, ne pas se laisser emporter par la fluidité. Persister veut dire à la fois résister et aller toujours plus loin par et dans le changement, ou bien, transformer la transformation. Là où les forces de la nouvelle réaction engloutissent chaque jour davantage la puissance de transformation pour la soumettre aux impératifs de la production et de la croissance, ayant engagé l’altération de notre monde, cette transformation de la transformation est notre tâche : philosophique, politique.
C’est seulement en ce sens que la critique de la négativité fraye le chemin d’une pensée de la négativité radicale qui est aussi, oui, en effet, je le crois, une pensée affirmative.
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris