Texte paru la première fois in La Revue Internationale des Livres et des Idées, numéro 15, en date du 06/01/2010. Article reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteur.
Et s’il fallait concevoir la politique comme relevant d’une réponse forcément maladroite, à une question dont on ne sait jamais si elle se pose vraiment, ni à qui ? Et si l’incertitude dont témoigne cette question pouvait être perçue, dans l’Europe d’aujourd’hui, avec autre chose que de la tristesse, de la culpabilité ou du dépit ? Et si l’on essayait de redéfinir la conscience de « gauche » par le fait d’être « mal-à-droite » ?
C’est d’une façon remarquablement désespérée qu’ont été célébrés, cet automne, les vingt ans de la chute du Mur. Alors que les quarante ans de mai 1968 avaient au moins été l’occasion de réchauffer quelques vieilles polémiques, l’effondrement du Rideau de fer a fait l’objet d’une jubilation parfaitement paralysée : bien sûr que personne – à part quelques vieux Ostalgiques observés avec un amusement condescendant – ne regrette l’avant ; bien sûr que tout le monde repense avec émotion à la délicieuse surprise éprouvée sur le moment, à la vue d’un effondrement aussi rapide et irénique. Quant à en tirer quelque chose à espérer pour l’avenir, ou même pour le présent, il aurait sans doute été considéré comme naïf d’en exprimer le désir. La droite se contente d’y voir le triomphe de la « liberté » sur le «totalitarisme» . La gauche ne peut ni revendiquer un passé (« socialiste démocratique ») peu glorieux, ni se retenir d’idéaliser l’époque d’avant-la-Chute (les «Trente glorieuses»), au cours de laquelle la peur du rouge permettait quand même de contenir la domination aujourd’hui effrénée du capitalisme conquérant.
Un philosophe passe à travers le mur
Quelques livres récents enjambent heureusement la (vraie) frontière qui continue à séparer la France et l’Allemagne pour repeupler ce no man’s land de la pensée qui paraît avoir entouré le Berlin de ces derniers mois. Les deux premiers percent le mur du silence qui a entouré l’oeuvre d’un des grands philosophes allemands vivants, dont l’oeuvre a été fortement nourrie par les années de jeunesse qu’il a passées à Paris, mais dont les écrits n’ont encore été diffusés dans le domaine francophone que de façon confidentielle . Bernhard Waldenfels, né en 1934 et professeur de philosophie pendant une vingtaine d’années à l’université de Bochum, a publié outre-Rhin une trentaine de livres, approfondissant une réflexion phénoménologique inspirée de Husserl et de Merleau-Ponty, dont il fut l’étudiant au début des années 1960 et dont il a traduit plusieurs oeuvres en allemand.
Ce sont des philosophes lausannois, réunis au sein du Groupe de la Riponne, qui ont entrepris depuis plusieurs années déjà de faire passer sa pensée dans le monde francophone et qui viennent de publier une splendide traduction d’un de ses ouvrages, Topographie de l’étranger (datant de 1996). L’ouvrage sollicite l’approche phénoménologique pour analyser les multiples formes de manifestation que prennent l’étranger et l’étrangeté dans notre expérience du monde. Du frère que je croyais connaître et qui me surprend soudainement par une parole inattendue jusqu’à « l’étrangeté absolue » que je rencontre au cours d’expériences-limites, ce sont toutes les variétés et les gradations d’intensité de l’étrangeté qu’explore le livre. Les lecteurs allergiques à la phénoménologie (allemande) risquent d’être parfois agacés par une certaine tendance à parler de « l’étranger » comme d’une forme d’expérience subsumable sous un seul et même concept : même si l’auteur rappelle sagement qu’«on ne rencontre jamais l’étranger ou les étrangers, mais toujours certains étrangers déterminés », et les impatients souhaiteront parfois qu’on en arrive plus vite à des analyses ancrées dans des situations historiques (et dans des rapports socio-politiques) plus précisément définies.
Comment protéger l’étrangeté ?
Les autres (ou les mêmes) trouveront toutefois une vertu très particulière dans l’apparente « naïveté » politique de ces analyses phénoménologiques. Dans ce volume au moins , et même s’il revient souvent sur les drames de l’ex-Yougoslavie qui se déroulaient au moment de la rédaction de l’ouvrage, Bernhard Waldenfels débarrasse « l’étranger » de toute la fantasmatique obsidionale qui l’entoure dans la plupart des discours politiques et philosophiques actuels. Au lieu de nous peindre – nous autres Européens vivant après la chute du Mur – dans une forteresse assiégée de hordes d’envahisseurs venant de l’Est ou du Sud, impatients de réclamer leur part du gâteau de notre prospérité, il décale drastiquement la perspective pour étudier comment nous pouvons faire mouvement vers l’étranger qui vient à nous.
À la suite de Husserl, Bernhard Waldenfels se demande longuement comment rendre accessible l’inaccessibilité qui caractérise l’étranger. Il fait fortement sentir en quoi la menace elle-même que perçoit notre mentalité obsidionale participe d’une (mauvaise) façon de réagir à l’étrangeté intime que l’étranger révèle en nous. Au lieu de voir en cette inaccessibilité ou en cette intimité une source d’angoisse, il nous invite à y voir une occasion de découverte, qui peut être profondément inquiétante, mais qui est ici traitée sur le mode actif de l’exploration plutôt que sur le mode passif de l’invasion subie : « l’expérience de l’étranger signifie plus qu’un accroissement d’expérience, elle se renverse en un devenir-étranger de l’expérience et un devenir-étranger à soi-même pour celui qui en fait l’expérience » (p. 16).
En insistant sur la dimension topographique de l’étrangeté, Bernard Waldenfels esquisse quelque chose qui pourrait ressembler à « l’utopie d’un socialisme des distances » rêvé par Roland Barthes dans sa première année de cours au Collège de France sur le « vivre ensemble » : « l’étranger doit d’abord être pensé à partir des-lieux-de l’étranger, comme un ailleurs, un extra-ordinaire qui n’a pas de place originairement dévolue et qui se dérobe à toute mise en ordre. Inversement, l’espace topique doit être pensé de telle sorte qu’il autorise des lieux propres et des lieux étrangers sans pour autant niveler et circonscrire d’emblée la différence entre le propre et l’étranger» (p. 18).
C’est bien l’ébauche d’une politique de gauche qui prend forme dans ce type d’approche. Alors que la droite surfe sur les angoisses xénophobes en se demandant comment se protéger des étrangers (perçus comme des envahisseurs), il serait définitoire de la gauche, face à la chute de certains murs, de se demander comment protéger les étrangers en nous, comment aménager des lieux d’éclosion de l’étrangeté au sein d’un univers globalement familier. Cette topographie débouche donc sur un premier enseignement : la gauche a bien raison d’être mal-à-droite dans tous les lieux où l’étranger est perçu comme une menace contre laquelle il faut se protéger ; elle devrait en revanche se trouver bien-à-gauche partout où l’on s’efforce de protéger l’étrangeté contre une familiarité envahissante.
Phénoménologie et politique
C’est sans doute un paradoxe de cet ouvrage qu’il ait reçu une traduction absolument exemplaire, aussi fluide que dense, aussi claire que consistante . Cela lui confère la propriété miraculeuse de passer à travers le mur de la différence linguistique en paraissant être absolument chez lui dans une langue française qui lui est totalement familière. Du même coup, toutefois, cet exploit tend à effacer la dénivellation « entre le propre et l’étranger », dénivellation dont l’ouvrage souligne pourtant le caractère fécond. Aurait-il donc fallu multiplier les germanismes pour protéger l’étrangeté de la pensée allemande, et conformer l’expression au contenu ?
Si une telle question est, bien entendu, oiseuse, « purement rhétorique », c’est qu’elle ne s’articule à aucun enjeu pratique, et n’entraîne aucune implication politique. Or la phénoménologie de Bernhard Waldenfels contient le noyau d’une théorie politique remarquablement fine et pertinente au sein de nos débats les plus actuels. Plus qu’à travers Topographie de l’étranger, c’est à travers un livre rédigé par l’un des traducteurs de cet ouvrage, qui comme ses collaborateurs, est par ailleurs lui-même philosophe de plein droit, qu’apparaît le mieux la portée politique de la phénoménologie waldenfelsienne. Dans L’Adresse du politique. Essai d’approche responsive, Michel Vanni commence par présenter de façon méthodique et synthétique la théorie de la responsivité échafaudée au cours des dernières décennies par Bernhard Waldenfels, avant de la faire entrer dans un dialogue serré avec la philosophie française contemporaine, les parties ultérieures se concluant sur une confrontation avec Jean-Luc Nancy sur la question de la communauté, avec Jacques Rancière sur celle des institutions, avec Jacques Derrida sur celle des transformations sociales et avec Alain Badiou sur celle de la fidélité militante. Michel Vanni se livre donc à une politicisation radicale (quoique toujours « douce », on y reviendra) de la phénoménologie waldenfelsienne. L’entreprise est passionnante et importante : il vaut la peine de la suivre pas à pas.
La responsivité selon Bernhard Waldenfels
Plutôt que de la théorisation de l’étranger proposée par Bernard Waldenfels, Michel Vanni s’appuie sur la façon dont le philosophe allemand conçoit « le schème de la réponse » : « toute signification, tout geste pratique constitue une réponse déjà donnée, ou déjà en train de se donner, à une requête étrangère, c’est-à-dire irrécupérable par une saisie quelconque. Toute identification, ou toute constitution de sens, ne s’effectue qu’à partir de ce mouvement de répondre déjà engagé, et la requête qui l’anime ou l’aiguillonne n’est elle-même lisible – toujours imparfaitement – qu’à partir de lui . » Contrairement à nos habitudes, qui nous font concevoir la réponse comme faisant suite à une question préalable, l’approche responsive nous invite à penser que « c’est toujours la réponse qui est première, et ce à quoi elle répond ne se révèle qu’après coup et qu’imparfaitement à travers des gestes plus ou moins maladroits qui se seront déjà initiés » (p. 89).
On commence donc par répondre, sans encore savoir précisément à quoi ou à qui. Autrement dit : on se sent faire face à des requêtes, dont la plupart ne sont pas explicitement formulées comme telles. Une femme enceinte porte une valise dans un escalier de métro : elle ne me demande rien, et pourtant je peux avoir envie de répondre à son effort en l’aidant à porter sa valise. On répond donc à des situations dans lesquelles on se trouve immergé, sans avoir forcément choisi de l’être. On peut souvent se tromper sur l’existence de la demande : peut-être que la femme enceinte préfère affirmer son autonomie en portant elle-même sa valise plutôt qu’en voyant des inconnus la traiter comme une invalide. Même dans les cas apparemment plus clairs où un ami me demande explicitement un service, n’est-ce pas autre chose qu’il me demande en réalité ? Ne cherche-t-il pas à être rassuré, plutôt qu’aidé ?
C’est dès ce stade que Michel Vanni introduit la notion centrale de maladresse, à comprendre ici comme une incertitude sur l’adresse, l’adressage, la bonne identification de la requête perçue par celui qui répond : «je propose de parler ici d’une essentielle maladresse de la réponse ou du répondre, au sens d’une incertitude dans l’adressage de la réponse et de la requête qui l’anime, ainsi que d’une essentielle fragilité du geste même de réponse, une certaine forme de « gaucherie » dans les gestes. Incertain de sa légitimité, le geste de réponse s’avance déjà, fragile et maladroit, au sein d’une pluralité conflictuelle de requêtes qu’il ne parvient pas à épuiser, mais qui le maintiennent dans un déséquilibre perpétuel qui n’est qu’un autre nom pour dire réinvention et fécondité » (p. 79).
Cette fragilité essentielle n’empêche nullement certaines requêtes d’apparaître comme « incontournables » (p. 51). Plus généralement, sitôt qu’une requête se fait sentir, elle témoigne de l’insuffisance des réponses antérieures, qui n’ont pas réussi à la résorber. Cela impose du même coup à chaque réponse l’exigence de faire oeuvre d’invention, puisque les réponses déjà existantes, « toutes faites », ne se sont pas révélées adéquates. D’où un constant déplacement des réponses au fil du temps : « l’insuffisance des réponses face aux requêtes qui les aiguillonnent implique qu’elles se trouvent constamment déplacées et remises en cause par de nouvelles réponses, qui viennent en reprendre l’enjeu. […] Je suis contraint dans l’urgence d’inventer des réponses partiellement nouvelles, car les anciennes ne suffisent pas, elles ne sont jamais totalement adaptées, et surtout elles arrivent trop tard face à l’urgence pratique née de la situation » (p. 54-56).
L’approche responsive nous fait donc envisager le monde humain comme tramé de requêtes perçues dans l’incertitude de leur adresse, de réponses toujours précipitées, toujours en quête de renouvellement et d’ajustement, toujours décalées et décalantes.
Un monde de gestes et de frayages
Si la source, l’objet et l’adresse des requêtes restent toujours incertains, la nature des réponses et des répondants nous invitent, elles aussi, à questionner nos fausses évidences. Le monde de la responsivité est moins peuplé de personnes (individualisées) que de gestes (transindividuels) (p. 144) : « les répondants sont des corps individuels ou collectifs, qui ne préexistent pas à leurs actes et à leurs réponses, mais qui se concrétisent au contraire comme corps dans et par leurs réponses, agrégés pour ainsi dire aux carrefours des requêtes multiples qui s’entrecroisent dans le champ. Il faut encore ajouter que cette agrégation ou cette condensation matérielle n’est pas simplement passive, pur effet mécanique d’un corps sur un autre, mais reprise créatrice comme corps en mouvements, gestes se constituant dans leur matérialité dans le mouvement même de leur action » (p. 249).
Loin d’être des données premières, les individus qui ont pris corps dans ce monde résultent de la coagulation de certaines formes stabilisées de réponses. Chacun de nous est à concevoir comme constitué par un « carrefour de requêtes multiples », comme la « concrétisation » de leur entrecroisement répété. C’est bien sûr le fond d’une ontologie du traçage et du frayage que Michel Vanni dessine la responsivité waldenfelsienne : chaque corps individuel et collectif apparaît comme une « ornière traditionnelle », qui « se creuse en tant que trajet de réponses, constamment reprises au sein d’un même espace de jeu : c’est précisément le trajet formé par des séries de déplacements, d’écarts et de remises en cause. […] « Nous » sommes obligés, moins par la contrainte d’un héritage figé à assumer tel quel, sans contestation, que par l’implication d’une série d’enjeux, de remises en cause, dont la portée ou la virulence s’impose à nous d’autant plus fortement que ces séries de déplacements ont été importantes, radicales » (p. 72).
Tirons-en deux enseignements supplémentaires pour une (re)définition de la gauche. D’une part, les politiques (progressistes) de gauche sont des « ornières traditionnelles », au même titre que les politiques (conservatrices) de droite. Leur prégnance et leur force relèvent de l’inertie de certaines habitudes, de la reprise de certains trajets déjà frayés sous la pression de poussées relativement constantes. La « radicalité » d’une transformation sociale – d’une Révolution – ne vient pas tant de ce qu’elle arrache toutes les racines du passé que des nouvelles ornières qu’elle parvient à creuser pour orienter durablement les développements à venir.
D’autre part, à l’heure où c’est la droite qui est affectée d’une fièvre de réformite aiguë, les politiques ne doivent pas être jugées par leur prétention à l’innovation, mais par le type de sillon qu’elles creusent, selon que les personnes et les collectivités s’y trouvent bien (à gauche) ou mal (à droite).
Une pensée des institutions
Ce que frayent les gestes de réponses a pour nom institution. « Par institution, on entendra donc la fixation progressive des traits constituant la forme commune à toute une série de réponses qui traversent une portion du champ pratique » (p. 130). C’est l’un des grands mérites de l’approche responsive que de nous doter d’une pensée des institutions, rare dans un paysage intellectuel français où l’on paraît critiquer d’autant plus radicalement les institutions qu’on entérine aveuglément leur fonctionnement quotidien.
En même temps qu’il montre les forts parallélismes entre la responsivité waldenfelsienne et certaines pensées politiques françaises contemporaines, Michel Vanni insiste sur une différence fondamentale qui sépare une gauche inspirée de Bernhard Waldenfels et une gauche inspirée par Jacques Rancière ou Alain Badiou. Contrairement au « dualisme » qui structure profondément les systèmes proposés par ces deux penseurs (police/politique, événement/état de la situation), Michel Vanni nous invite à percevoir les deux pôles comme résultant de tensions entre diverses séries de requêtes et de réponses tissées au sein d’une même trame : « la réponse instituée et son moment instituant ne représentent pas deux instances hétérogènes, mais deux moments d’un même processus de différenciation. Aussi dans ce cadre, l’État ne saurait s’opposer simplement et conflictuellement aux nouvelles réponses sociales qui viennent le déplacer, parce qu’il constitue lui-même une ancienne réponse » (p. 307) .
Si l’on se sent mal-à-droite en subissant les pressions effrénées de la logique marchande, en observant les dérives sécuritaires des appareils étatiques ou en constatant le creusement des sillons souverainistes et xénophobes, une politique de gauche n’est pas condamnée à devoir agir à partir d’une position d’extériorité envers la « police » (à entendre ici au sens ranciérien de « gestion administrative ») ou envers l’État (au sens badiousien des « données de la situation»). Indépendamment du fait que le statut d’une telle extériorité pose un problème théorique, il est possible aussi de concevoir des gestes qui s’efforcent plus modestement de tirer vers la gauche la trame sociale des réponses entrecroisées. Cette gauche-là n’a pas besoin d’ériger le tréteau d’un théâtre politique pour s’y livrer à des gesticulations spectaculaires : c’est dans ses gestes quotidiens qu’elle se retire des lieux où elle se trouve mal-à-droite et qu’elle pousse ses trajets de réponses, ses frayages, ses ornières vers la gauche.
Chaque subjectivation (vous, moi), chaque collectif (une famille, une ville, une nation), chaque organisation (une entreprise, une administration, une revue, un parti) apparaissent ainsi comme des institutions simultanément portées par et porteuses de la multiplicité des gestes de réponses qui s’entrecroisent pour s’effectuer en elles. L’institution n’est rien d’autre que cette répétition de gestes, lesquels ne sont bien entendu pas le fait de choix individuels, mais de relations sociales. Dans la mesure où ces gestes résultent de relations durables, visent à satisfaire à des besoins relativement stables et tendent à suivre des frayages déjà tracés, l’institution persiste dans son être ; dans la mesure où chacune des réponses qui la constituent fait toujours l’objet de déplacements (généralement infinitésimaux, parfois significatifs), toute institution est en évolution constante, grouillante.
L’insuffisance du commun
Cette conception immanentiste et tramée des institutions permet à Michel Vanni d’éclairer de façon originale la question du « commun ». Première caractéristique : « ce commun est toujours insuffisant », « comme un ouvrage à remettre constamment sur le métier », « miné par une exigence insatisfaisable » (p. 149). En variation sur la « communauté désoeuvrée » de Jean-Luc Nancy – mais aussi peut-être du « peuple qui manque » de Deleuze –, le commun apparaît dans la phénoménologie responsive comme toujours-à-construire, comme un projet perpétuellement en chantier, qui progresse sans plan ni architecte central, mais qui se tisse au fur et à mesure des besoins ressentis par les participants.
Deuxième caractéristique, liée à la première : même si les ornières qui orientent nos comportements nous inscrivent dans une « tradition » collective, le commun ne relève pas tant du donné hérité, dont l’unité viendrait du passé, que d’un appel d’air venant d’une pluralité hétérogène de requêtes à venir. « Le commun n’est pas posé comme un requisit préalable, mais il résulte au contraire – toujours imparfaitement – d’une requête plurielle qui lui est hétérogène, et qui l’inquiète perpétuellement en l’excédant » (p. 151).
Troisième caractéristique : parce qu’il est à situer dans la relation, et parce que la relation est ce qui me constitue, le commun n’est pas tant à chercher dans la plénitude du collectif que dans un vide que je ressens intérieurement, et qui m’appelle à le remplir par ma réponse : « j’engage le commun à travers mon répondre, se reprenant ici et maintenant, parce que ce commun fait défaut. C’est précisément à partir de ce défaut du commun qu’une rencontre est possible » (p. 152). Autrement dit, le commun est la valeur constitutive de la gauche, en ce qu’il émane des manquements éprouvés par les réponses qui se sentent mal-à-droite.
Percer le mur des ornières
Si le sentiment subjectif de se trouver mal-à-droite est bien le moteur des réponses qui tirent notre trame sociale vers la gauche, Michel Vanni nous aide également à identifier deux gestes qui pourraient fournir la base d’une (re)définition des politiques de gauche. Le premier de ces gestes concerne l’attitude à adopter au sein des institutions qui/que frayent nos comportements. Michel Vanni montre que ces institutions sont inévitablement soumises à des processus de mythologisation, qui fossilisent leur origine dans des généalogies mystifiantes (p. 132), ainsi qu’à des processus de normalisation, par lesquels « les structures instituées tendent à soumettre a priori tout geste pratique et toute parole à des règles et à des buts prédéterminés » (p. 61), étouffant la nature inventive et adaptative de la réponse.
Quoique la mythologisation et la normalisation aient généralement des effets pervers et regrettables, ce sont deux dimensions inhérentes à la persévérance dans l’être de toute institution, constitutives de toute « ornière traditionnelle ». Il est donc vain de s’en plaindre au nom d’une nostalgie romantique de l’âge d’or d’un autonomisme idéal ou d’une spontanéité perdue. Il est en revanche très important de combattre les effets de clôture sur soi entraînés par ces deux processus. Pour le dire autrement, et pour en tirer un quatrième enseignement : si tout devenir institutionnel passe nécessairement par le creusage d’une ornière, une politique se réclamant de la gauche s’efforcera de percer le mur de telles ornières, en autant de points que possible, afin de les ouvrir sur ce qui leur est extérieur.
On retrouve ici la problématique traitée dans Topographie de l’étrangeté : « l’enjeu politique consiste donc pour Waldenfels dans l’ouverture des institutions à leur propre mise en demeure sous l’aiguillon d’une étrangeté irréductible. Le danger est constitué ici par la rigidification mortifère de ces institutions autour du déni ou de l’exclusion plus ou moins violente de cette stimulation fécondante » (p. 63). Tout le monde admet qu’il faut des institutions – au double sens où nous en avons besoin et où elles sont toujours en défaut par rapport aux exigences (à venir) du commun. Toute institution est une ornière rigidifiée : le véritable problème n’est pas cette rigidification elle-même, mais bien plutôt la direction dans laquelle nous pousse l’ornière, ainsi que l’imperméabilité du mur qui la borde.
Ce qui tire vers la droite donne à cette rigidification un caractère « mortifère » en « déniant et en excluant de façon plus ou moins violente la stimulation fécondante » née du contact avec ce qui est « étranger » à la nature et au fonctionnement de l’institution. Ce qui tire vers la gauche travaille l’institution de l’intérieur pour la mettre en relation fécondante avec son extérieur, pour en nourrir son devenir, pour en questionner les frontières. Non pour en abattre les murs et remettre tout à plat. Mais pour y ouvrir des brèches, qui permettent aux différentiels de pression de faire sentir leurs effets, d’ajuster certaines inégalités, d’ouvrir de nouvelles voies de développement.
Le soin des brèches migratoires
Exemple concret : dans le traitement des pressions migratoires, la droite tend simultanément à monter en épingle (dans sa xénophobie obsidionale), à dénier et à exclure (dans ses pratiques gouvernementales) la réalité d’un dehors où s’accumulent pauvreté, exploitation, oppression et dégradation du milieu vital. Par le même geste, elle rigidifie notre forteresse en entourant son extérieur de barbelés et de surveillance policière aussi imperméables que possible, tandis qu’elle produit, à l’intérieur, un statut de sans-papiers qui exacerbe les possibilités d’exploitation néo-esclavagiste.
Une réponse de gauche face au noeud (terriblement complexe) de requêtes issues des phénomènes migratoires ne consisterait ni à poursuivre les politiques de droite (comme l’ont fait nombre de dirigeants socialistes), ni à abolir du jour au lendemain toutes les frontières nationales (comme personne ne le préconise), mais à multiplier les brèches à travers lesquelles l’intérieur (économiquement privilégié) de l’ornière européenne entre en contact avec son extérieur.
L’aiguillon d’étrangeté qui « ouvre les institutions à leur propre mise en demeure » passe ici par la reconnaissance, problématique mais « incontournable », des requêtes légitimes qui n’opposent pas tant les Européens aux pays du Sud ou de l’Est que les privilégiés aux démunis (à l’intérieur de chaque pays comme sur leurs frontières). Seule la mentalité obsidionale nous fait craindre des hordes de miséreux « envahissant » de leurs élans chaotiques nos pays bien rangés. Ce dont sont mises en demeure nos institutions, ce n’est pas d’un nivellement qui nomadise toute l’humanité, mais d’une correction des inégalités historiques qui minent notre topographie actuelle de l’étrangeté, en écrasant la plupart des cultures sous des pressions qui leur interdisent d’agencer une mise en communication « stimulante et fécondante » des lieux propres et des lieux étrangers.
Éloge de la maladresse
Agir sur les brèches : c’est très précisément ce que font les associations de (la gauche de la) gauche. On ne manquera pas de sommer celle-ci de proposer son plan miracle qui résoudrait « le problème de l’immigration ». Or, indépendamment même du contenu d’un tel plan, c’est la sommation elle-même qui est à percevoir comme relevant d’une posture de droite. Le second geste que suggère Michel Vanni pour définir les politiques de gauche est en effet celui par lequel nous sommes amenés à nous soustraire à l’exigence intimidante (et paralysante) d’une telle sommation. Ce geste récuse l’ambition de maîtrise, pour valoriser l’aveu de maladresse.
L’« ethos propre à la démocratie », écrit-il, « consisterait à pouvoir se maintenir dans la fragilité et la maladresse inhérentes aux réponses pratiques, sans chercher à les fuir comme un défaut ou un risque inquiétant, mais bien plutôt à les assumer comme une dimension consubstantielle, non seulement nécessaire mais féconde. L’ethos démocratique consisterait donc en somme à revendiquer cette maladresse contre l’hybris de la maîtrise totale et de l’assurance garantie face à toute incertitude » (p. 211).
Agir sur les brèches, toujours en retard sur l’urgence des requêtes et en avance sur une compréhension suffisante de la situation, cela condamne nécessairement à faire des gestes maladroits. « La maladresse est le moteur du changement » (p. 183), en ce que c’est à travers elle que passent les déplacements et les décalages qui reconfigurent et redirigent les frayages institutionnels – avec à chaque fois des risques de « dérapages », d’« écarts de langage », d’« effets secondaires » immaîtrisés. Au lieu de subir comme une malédiction (ou dans la honte) la précipitation, l’incertitude et la mal-adresse inhérentes à toute réponse (est-ce à moi de répondre ? à qui exactement ? au nom de quoi ?), Michel Vanni nous invite à « revendiquer cette maladresse » comme un antidote à l’arrogance commune aux détenteurs de pouvoir. Face au règne des dirigeants sans peur et sans reproche, des chevaliers d’industrie, des as de la finance et de toutes leurs cohortes d’experts confortablement assis sur leur parfaite maîtrise des dossiers, l’essence d’une politique de gauche devrait peut-être consister en « une certaine forme de « gaucherie » dans les gestes » (p. 79).
De la gauche(rie) comme mode d’énonciation
« Militer pour l’incertitude ou pour la maladresse » (p. 309) implique de chercher à réformer (en permanence) les institutions, de façon à assouplir les réponses fatalement ossifiées (bureaucratisées) qu’elles apportent aux requêtes de leurs participants et de leurs utilisateurs. Le coefficient de gaucherie se mesurerait ici au « degré d’ouverture des institutions à la maladresse de leurs propres réponses » (p. 268). Comme le suggère toutefois Michel Vanni lui-même, c’est aussi en termes de « posture subjective » que doit être abordée la gaucherie. Au lieu de se définir principalement par certains contenus idéologiques (être contre les privatisations, pour l’impôt sur les grandes fortunes, etc.), l’imaginaire de gauche mérite sans doute de se caractériser par certains modes d’énonciation. Une subjectivité est (au moins un peu) de « gauche » dès lors qu’elle se trouve mal-à-droite face au manager qui joue au petit chef ou face à l’expert qui assène ses vérités en les appuyant de tout le poids de son autorité scientifique. Dès lors qu’on ressent le besoin de « lutter contre toute une mythologie de l’adresse et de l’efficacité, largement dominante à l’âge du capitalisme mondialisé » (p. 258), l’ennemi n’est bien entendu pas à dénoncer dans l’expert ou le manager eux-mêmes, qui ne font sans doute que répondre de leur mieux à « la pluralité conflictuelle de requêtes » où ils se trouvent enchevêtrés. Si ennemi il y a, il faut le repérer dans certaines façons de mettre en scène le geste de la réponse et de l’énonciation.
Il convient donc de distinguer « deux « postures » subjectives différentes : la fidélité à la maladresse constitutive des réponses d’une part, et le déni de celle-ci d’autre part » (p. 257). Dès lors que nul ne saurait échapper à la maladresse, ce qui est décisif, c’est le rapport (de fidélité ou de déni) qu’on entretient avec elle. La gauche, si elle veut bien tirer les conséquences de son sentiment d’être « mal-à-droite », doit apprendre à se montrer fidèle à une certaine gaucherie constitutive.
Confiance dans la maladresse et fidélité à l’expérimentation
On sent immédiatement le problème « de communication » inhérent à cette (re)définition de la gauche : il est peu réaliste de se faire élire aux postes de responsabilité en exhibant fièrement sa maladresse, sa gaucherie, ses incertitudes, son insuffisance… Le plus grand défi pour la gauche serait d’apprendre à tirer de sa maladresse un spectacle doté d’une force de conviction propre. En devenant des « apôtres de la maladresse », des politiciens new look devraient s’entraîner à faire de leur gaucherie l’objet d’une pratique virtuose, afin d’instaurer cette « confiance dans la maladresse » esquissée dans les dernières pages du livre de Michel Vanni (p. 302).
Une telle « gaucherie » peut toutefois se réclamer d’une notion qui paraît bénéficier d’un certain retour en force (profitant habilement des innombrables slogans nous enjoignant à l’« innovation »), la notion d’expérimentation . Comme le montre parfaitement l’approche responsive, parmi tous les gestes pratiques, qui relèvent tous de la maladresse, la décision politique, de par la complexité des requêtes et des conditions auxquelles elle doit faire face, relève nécessairement et dans tous les cas de la gaucherie, du bricolage, du plan sur la comète, du coup de dés, du pari, du ballon d’essai. Les « réformes » de la droite sarkoziste (sur l’assurance-chômage, l’éducation, l’Université, la TVA des restaurants, etc.) ont un caractère improvisé, mal ficelé, qui inquiète légitimement tous ceux qui ont à les subir. De réelles réformes (de gauche), authentiquement audacieuses et progressistes, pourraient difficilement faire pire dans le bricolage expérimental et l’improvisation hasardeuse.
La grande différence est que la droite fait passer (en force) ces « réformes » au nom de l’« expertise », de la bonne « gouvernance », de la « transparence statistique », bref du savoir, de la maîtrise et de l’adresse – en déniant leur caractère expérimental, leurs incertitudes et leur maladresse constitutive. Les multiples déréglementations du système bancaire et financier ont été promues (à la fois par tous les hommes du président et par certains gouvernements socialistes) au nom des lois économiques et de la science managériale : on a vu les résultats calamiteux de cette sorcellerie, qui n’a réduit que très brièvement la morgue des apprentis sorciers. Par contraste, la gaucherie consiste donc à rejeter le déni du caractère nécessairement expérimental de la politique, pour s’en réclamer ouvertement, afin d’en tirer des conséquences dégrisantes, mais surtout afin d’en valoriser les potentiels émancipateurs.
Ébrécher l’ornière de la mnémocratie
Un autre livre récent, se réclamant lui aussi d’un fort lien à l’Allemagne, aborde le nouage entre fidélité à l’expérimentation et audace de la maladresse. Dans Le Hêtre et le Bouleau, Camille de Toledo nous convie à une promenade dans le Berlin qui célèbre si tristement les vingt ans de la chute du Mur. Lui aussi tente de nous désenvoûter (de notre désenchantement même), lui aussi réfléchit sur les brèches, lui aussi nous appelle à inventer une « pédagogie du vertige » qui est la soeur jumelle de la « confiance en la maladresse » évoquée par Michel Vanni. À la fois romancier et essayiste, Camille de Toledo nous promène autant dans la langue française que dans la ville allemande : ce sont des jeux de polysémie (l’« aspiration » comme désir et comme souffle), des diffractions poétiques de définitions de dictionnaire (le mot « hêtre »), des homophonies (« hêtre » – « être ») qui servent de passages secrets d’un quartier à l’autre de sa pensée. Loin de se complaire dans le vain jeu des mots, il en fait un outil heuristique des plus puissants, pour articuler une thèse à la fois douce et ferme.
Traduite en termes vanniens, cette thèse pourrait prendre la forme suivante : la « tristesse européenne », dont témoigne emblématiquement Berlin vingt ans après la chute du Mur, consiste en un durcissement de l’ornière mémorielle, qui en est arrivée à obstruer toutes les brèches par lesquelles nous pourrions encore envisager d’expérimenter l’advenir d’un autre monde possible. Les dernières décennies ont été plombées par une « inertie mémorielle » qui a « borné notre esprit » et « bridé tout élan spirituel » en direction d’une « idée d’utopie », soupçonnée de « porter en germes les crimes de masse et les rouages d’une déshumanisation » .
C’est sous la chape de cette mnémocratie – triplement hantée par les crimes du nazisme, par ceux du communisme et par une équivalence simpliste établie entre les deux – que s’est construit « l’édifice institutionnel européen : non pas le dêmos (pouvoir d’un peuple cherchant à se libérer d’un tyran ou d’une métropole coloniale), mais le mnêmos, la mémoire et la honte d’une culture qui, par deux fois, s’est renversée en barbarie » (p. 83). Avec pour résultat principal que « le rêve, l’imagination, le désir de transformation ont été tenus en laisse » (p. 118), étouffés, atrophiés.
H
Cette triste paralysie de notre imaginaire politique sous le poids de la mnémocratie, Camille de Toledo l’épingle à travers le jeu d’une lettre – H. L’ornière mémorielle a d’abord été frayée par la honte, une honte éprouvée, de façon bien compréhensible, envers les divers « crimes du XXe siècle ». Il reprend à Jacques Lacan le mot-valise d’hontologie qui transforme la philosophie de l’être en un discours de la honte. Cette honte a engendré à son tour une hantise, celle de ne pas pouvoir respecter la promesse du « plus jamais ça », nous plongeant dans le registre d’un autre mot-valise, repris cette fois de Jacques Derrida, l’hantologie. À la puissance de devenir qui anime l’être s’est substitué un monde de spectres, à la fois moralisateurs et démoralisants, qui « font parler les morts, ventriloquent au nom des charniers, des assassinés, et se permettent comme des possédés de juger le présent au nom des cendres » (p. 60).
Au dynamisme de l’être, nous avons substitué la tristesse du h-être. Camille de Toledo sourit de trouver cette définition de notre époque dans l’innocence d’un dictionnaire : « le hêtre européen est une espèce d’arbres à feuilles caduques ». Il ne peut s’empêcher « d’entendre dans le sens de « caduques », passées, flétries, qui sont sur le point de cadere, tomber » (p. 64). Les feuilles, les murs, les condamnations, les rideaux d’inauguration de monuments mémoriels tombent – en creusant à chaque fois l’ornière qui nous obstrue la perspective d’un autre avenir. D’où l’appel central de l’ouvrage : « Qui osera entailler cet ordre du passé dont l’antitotalitarisme a fait un engagement héroïque ? Qui osera dire enfin qu’il faut, pour guérir de la hantise, non pas défendre infiniment le Devoir de Mémoire, mais reconnaître le travail proprement humain de l’oubli ? » (p. 71).
Ce que bloque le h du hêtre, de la hantise et de la honte, c’est en effet cela même que la graphie et la phonétique paraissent lui faire exprimer : une puissance d’oubli (on ne sait jamais très bien où le mettre, ce foutu h muet), mais aussi et surtout, une puissance d’aspiration – une puissance de désir (d’un autre monde possible), une puissance de souffle (dans le sens où un geste audacieux peut être qualifié de « soufflé »), une puissance relevant proprement de l’esprit, de ce spiritus qui, comme le vent, souffle où il veut, renverse les montagnes et fait déborder les ornières. Malgré toutes les exploitations douteuses dont il a fait l’objet, Camille de Toledo revendique (avec quelques autres et à juste titre) une réappropriation de la notion d’esprit : « à force de contenir l’espoir du paradis en souvenir des enfers passés, nous avons détruit le levier spirituel de l’être. Ce levier qui nous fait espérer autre chose que ce qui est » (p. 34) .
Le banian et la pédagogie du vertige
Derrière le bouleau, qui était l’arbre hantant les récits des camps, et le hêtre, qui emblématique la tristesse honteuse du XXe siècle finissant, Camille de Toledo nous propose le banian pour stimuler notre capacité à imaginer un XXIe siècle enfin commençant. L’évolution du hêtre au banian entraînerait toute une série de transformations : on passerait du devoir de mémoire au travail de l’oubli et de la création, de l’hantologie au désenvoûtement, du commun des deux totalitarismes au commun de la coupure et de l’exil, de la consolation patrimoniale au devenir fictionnel du monde, bref, du monument et de la conservation à l’utopie et à la transformation (p. 168-169).
Le banian symbolise ce que Camille de Toledo appelle une « pédagogie du vertige », dont le funambule est le virtuose et dont les échos sont nombreux à la fois avec la « vision maladroite et fragile du politique » promue par Michel Vanni, avec la Topographie de l’étranger de Bernard Waldenfels et avec le travail de traduction mené par le Groupe de la Riponne. Camille de Toledo décrit en effet « le foyer de la maison de l’h-être, son antre instable, inconfortable » comme requérant une confiance et une virtuosité dans la maladresse, pour se bricoler une place, toujours fragile et incertaine, « comme la corde sur laquelle s’élance le funambule », au-dessus « de l’entre-deux des langues, de cet interstice d’erreurs, de malentendus et d’intraduisibles » qui relève de « l’effort proprement humain du traducteur pour tenter de faire entrer l’étranger dans la langue » (p. 146).
Des virtuoses de la gaucherie
Une pédagogie du vertige est sans doute nécessaire à toutes les forces de gauche pour apprivoiser leur gaucherie, pour s’en faire une force de vérité plutôt qu’un boulet de honte et de hantise. C’est toutefois peut-être sur ce point qu’un autre clivage pourrait s’instaurer au sein des sensibilités politiques qui se trouvent aujourd’hui être mal-à-droite – entre, d’une part, les apôtres de la gaucherie et, d’autre part, les adeptes du saccage.
L’enchantement stylistique produit par la richesse littéraire de l’essai de Camille de Toledo, la clarté et la précision exemplaires du traité de Michel Vanni, le somptueux travail de traduction accompli par les membres du Groupe de la Riponne confèrent tous à leurs auteurs une paradoxale position de maîtrise et de territorialisation dans leur apologie de l’étrangeté, de la maladresse et du vertige… L’engagement (indéniablement politique) de ces trois ouvrages se caractérise par une remarquable douceur. Il me paraît significatif qu’à la fois Michel Vanni (avec ses amis du Groupe de la Riponne ), et Camille de Toledo (avec ses associés de la Société européenne des Auteurs ) cultivent des modes de socialité qui parviennent à relever simultanément de la militance, de l’autonomie, voire d’une certaine radicalité, et d’une admirable convivialité. Cette sensibilité mal-à-droite s’efforce de créer des micro-environnements où l’on soit aussi bien-à-gauche que possible, dans des espaces aux angles polis et accueillants, débarrassés de toute agressivité inutile, de toute testostérone débordante. Des espaces de politesse et d’honnêteté, de sollicitude et d’esthétisation comparables peut-être aux salons du XVIIIe siècle.
C’est dans un tel espace de convivialité que nous convient les différentes formes de virtuosités dont font preuve les trois ouvrages discutés jusqu’à présent. J’aimerais conclure cette discussion en évoquant brièvement un traitement de la maladresse qui, au contraire, l’exacerbe dans son expression même, faisant exploser toute honte et toute hantise dans un joyeux saccage de toute forme de maîtrise – esquissant par là même une autre figure possible, bien plus inquiétante, d’une certaine gaucherie.
Le saccage comme résistance à la traduction
Un autre sous-groupe de travail au sein du Groupe de la Riponne (où l’on retrouve Francesco Gregorio accompagné cette fois de Christian Indermuhle et de Thibault Walter) vient de faire paraître un admirable petit livre (accompagnés d’un CD inédit, publié chez le même courageux éditeur Van Dieren, dans un tirage limité à 450 exemplaires) présentant le parcours et traduisant quelques textes du musicien de harsh noise GX Jupitter-Larsen, sous le titre Saccages. Le projet en est à la fois dans la continuité et en contraste absolu avec les trois livres précédents.
Imaginons qu’au lieu de polir et de peaufiner leur traduction de façon à la rendre parfaitement claire et parfaitement familière au lecteur francophone, les traducteurs de la Topographie de l’étranger y aient multiplié les germanismes, pour lui conserver son « étrangeté » constitutive, au point de le rendre incompréhensible à la fois à celui qui ne lit pas l’allemand, puisque tout y serait radicalement littéral, et à la fois au lecteur germanophone, puisque l’original aurait été néanmoins irréversiblement corrompu pour sa translittération en français.
Voilà à peu près le type de travail qu’accomplit GX Jupitter-Larsen. Le CD qui accompagne le livre en donne une illustration exemplaire : des voix (dont les plus discernables ont l’air de parler une langue extrême-orientale) sont superposées au point de se neutraliser les unes les autres, pour ne former qu’un agrégat saturé de toutes parts, un flux inaudible, c’est-à-dire incompréhensible – donc audible en tant que flux (et non paroles), en tant que son, « poly-onde », bruit, noise.
Un musicien casse les murs (du son)
Avec son groupe d’encagoulés peu convivialement intitulé The Haters (« les Haïsseurs »), GX Jupitter-Larsen s’est spécialisé dans l’exploration des bruits générés par des processus de destruction . À Paris, en 1992, cela consistait à « pousser lentement un microphone allumé dans une broyeuse pour l’abraser lentement jusqu’à n’en laisser qu’un moignon ». Ailleurs, il a utilisé « l’amplification du bruit produit par un entonnoir suspendu de façon à s’abraser sur un plateau tournant de papier de verre » (p. 48). La friction, le frottement, « l’érosion comme pénétration du vide » (p. 47) jouent un rôle central dans son univers de performances à la fois visuelles et sonores : « la majeure partie de mon oeuvre a consisté en l’amplification d’égrènements et de broiements » (p. 86). C’est bien sûr la brèche que l’artiste place ses micros : là où ça frotte, là où ça grince, là où ça coince, là où ça creuse, là où ça casse, là où ça fait mal (à droite, aux choses ou aux oreilles).
Plus radicalement, les Haters se sont rendus (in)famous – et se sont sans doute fait copieusement haïr en retour par les organisateurs de spectacles – pour leur habitude de prendre pour objet de destruction la salle même où ils étaient appelés à se produire (voir l’encadré). Au cours de ces saccages, il s’agissait bien de casser les murs et d’éroder les ornières : casser les murs du son et des convenances, des objets et des propriétés – et enregistrer (mentalement) le bruit que ça peut faire… La chute du Mur, pour peu qu’on ait eu l’idée de mettre des micros sur les pioches, les masses et les canifs qui l’ont attaqué (au lieu de jouer bêtement du violoncelle), aurait pu perfor(m)er un saccage très digne de GX Jupitter-Larsen .
On voit qu’on est à la fois très proche de la notion de frayage perçue comme centrale chez Michel Vanni (frayer vient du latin fricare, « frotter »), et très loin des attitudes de douceur promues par les trois auteurs précédents. Aucune marque de virtuosité, aucun appel à la pédagogie dans ce cas : on est dans la plus brutale maladresse, dans le vertige de la pure destruction. Aucune politesse ni convivialité dans les rapports sociaux : on est dans la libération d’énergie ravageuse, la spectacularisation de la haine (le catch est une référence fréquente au cours du livre), la provocation incontrôlée. Les frictions ne tendent pas ici à construire des trajectoires mais à détruire des formes – et pourtant c’est bien une trajectoire artistique que retrace ce livre, et ce sont bien des formes sonores qui sont produites par la destruction.
Écouter de la noise pour résister au déferlement du bruit
D’où un sentiment d’ambivalence face à ce livre profondément inquiétant. On y entrevoit l’horizon d’une pensée qui prend les risques de sortir des ornières (en les faisant éclater). C’est bien dans le domaine de l’expérimentation qu’on se situe ici, dans ce qu’elle a de plus « osé » et de plus hasardeux. Les écrits de GX Jupitter-Larsen déploient une réflexion riche et stimulante, qui grouille de formules éclatantes, troublantes, fulgurantes, injectant une précieuse dose de noise dans nos habitudes de pensée. « C’est ça, la culture noise » : « provoquer chez l’auditeur une stimulation intensive s’opposant à la torpeur due à l’hyper-sollicitation par les mass-médias, et lui offrir l’opportunité de choquer son corps par le biais de vibrations inconnues » (p. 85).
Cette culture déborde largement le cadre des seules pratiques musicales pour fournir des intuitions sur l’ensemble de notre expérience : « nous sommes à la technologie ce que le ver est à la terre » (p. 73) ; « la défiance vous ajuste à vous-même » (p. 63); « la connaissance est l’épave du mystère » (p. 78). Comme Camille de Toledo, GX Jupitter-Larsen fait d’ailleurs jouer un rôle central à la notion d’esprit au sein de sa pensée (un esprit conçu selon un rapport à la matière qui se conforme de façon frappante avec le parallélisme spinoziste).
Malgré ces mérites, et même si eux aussi se définissent par l’exacerbation d’une expérience historique caractérisée par le fait d’être mal-à-droite, les adeptes du saccage apparaissent toutefois comme l’envers de la gaucherie (prudente et conviviale) prônée à partir des livres précédents. On y sent en effet pointer la terreur d’un monde sans frayage, sans institution, sans adresse, sans écoute des requêtes environnantes, occupé seulement à l’expression d’une réponse écrasante envers autrui. « Qui ne prend pas de plaisir à faire sauter les choses ? » (p. 78). À cette (mauvaise) question, qui constitue un dangereux court-circuit envers les requêtes qui nous entourent et nous constituent en tant que sujets politiques, on peut répondre par une autre question : Qui souhaiterait vraiment vivre dans un monde où déferlerait un tel plaisir ?
La stimulation du noise vaut pour autant qu’elle nous aide à nous préserver des bruits de la destruction. Une gaucherie désirable tenterait précisément de maintenir son cap entre les deux extrêmes, également dommageables, que sont, d’un côté, la fossilisation de l’ornière (sous le poids de la rigidification des institutions ou de la pression mnémocratique) et, de l’autre, son abrasion complète par l’éclatement des énergies trop longtemps contenues en son sein.
Ne pas lâcher sur la souciance
Les forces qui peuvent se réclamer de la gauche (de la gauche) ont donc au moins deux façons d’être mal-à-droite. Celles qui agencent le saccage, même si elles peuvent produire des effets esthétiques stimulants comme c’est le cas de GX Jupitter-Larsen, s’engagent sur la voie d’une défaite politique sitôt qu’elles s’abandonnent à des pratiques relevant de l’abrasion. Il n’est pas besoin d’être prophète pour deviner que les banlieues, les inner cities, et autres territoires occupés sont appelés à se ré-enflammer dans un avenir proche : malgré les efforts menés sur d’innombrables brèches par des myriades d’associations, le feu des inégalités et des injustices maintenu en permanence sous de telles marmites à vapeur doit nécessairement les pousser à l’explosion. En porteront la première responsabilité non pas ceux qui lanceront maladroitement des cailloux, des cocktails Molotov ou des rockets, mais ceux dont l’insouciance aura préalablement contribué à exacerber ces inégalités et ces injustices.
Même si, chez ceux qui ont été poussés à bout, le geste de l’abrasion destructrice – le saccage – peut sans doute s’expliquer et s’excuser, il ne saurait pourtant se justifier. On ne gagne jamais rien (de bon) à vouloir tout remettre à plat. C’est toujours contre l’abrasion que doivent se définir les politiques de gauche. Des deux formes de maladresse évoquées ici, la première se caractérise en effet par une certaine insouciance (à la fois libératrice et potentiellement destructrice) : lorsque les opprimés se trouvent acculés au saccage dans l’insouciance de ses conséquences, ils ne font que renvoyer à leur oppresseur le mépris abrasif dont il les a couverts.
Les apôtres de la gaucherie, au contraire, sans doute parce qu’ils se trouvent dans une situation moins désespérée, s’efforcent de se soucier des conséquences de leurs gestes – et c’est bien cette souciance qui donne à ceux-ci leur caractère maladroit. En période de crise, leur objectif n’est pas de « tout remettre à plat », ni de jouir du bruit que ça fait lorsque ça s’effondre, mais de traduire les pulsions de saccages abrasifs en espoirs instituants et en frayage de brèches conviviales.
Pour des politiques de l’égalité qui ébrèchent sans abraser
Deux choses émergent au terme de ce parcours maladroit entre quatre livres virtuoses : une formule et un silence. La formule résume la façon dont une gaucherie conviviale pourrait concevoir ses interventions politiques : ébrécher les ornières sans les abraser.
Le silence touche à la question centrale de l’égalité, dont aucun de ces livres, justement occupés à réfléchir sur des politiques de la différence, ne fait une préoccupation majeure de son propos. Or la gauche aujourd’hui doit impérativement se rassembler autour d’une nouvelle pensée de l’égalité, ou, plus précisément, d’une nouvelle articulation entre une liberté qui favorise la différence et une égalité qui lui assure un terreau nourricier commun . Ce qui abrase et détruit les formes de vie, ce sont toujours des inégalités insoutenables. Les trente dernières années ont été marquées par l’exacerbation de ces inégalités (et même temps que par leur redistribution géopolitique), sur les multiples plans des revenus, des droits sociaux, des destructions environnementales. Cette exacerbation, qui abrase quotidiennement les perspectives existentielles de milliards d’êtres humains (ce qui suffit à la condamner d’un point de vue éthique), va inéluctablement, si elle se poursuit, détruire en retour les modes de vie des plus privilégiés eux-mêmes (ce qui en appelle à leur instinct de survie autant qu’à leur sens moral).
Le défi est donc aujourd’hui de savoir protéger à la fois les ornières et les brèches, à la fois les dénivellations qui donnent à notre vie sociale son relief en lui permettant de cultiver les différences, et une égalité fondamentale qui encapacite chacun à profiter de ce relief, à y circuler aussi librement que possible, pour s’y construire une niche à la fois habitable et singularisante. Ce qui nous menace aujourd’hui d’abrasion, ce ne sont pas les saccages esthétisés de GX Jupitter-Larsen : ce sont à la fois les murs que nos gouvernements construisent pour préserver des îlots d’inégalités insoutenables et les déferlantes dont la pression monte tout autour de ces fortifications rigidifiées. La chute de ces murs-là est (pour nous, « Européens de l’Ouest ») autant à craindre qu’à souhaiter.
Les politiques de gauche pourraient alors se concevoir comme une alternative à la fois au mur et à sa chute : ébrécher sans abraser. Cette formule ne débouche sur aucune solution miracle, ni aucune maîtrise surplombante. Si la faucille, trop coupante, mérite d’être mise au rancart, le marteau pourrait s’avérer utile – et emblématique : instrument de maladresse plutôt que de précision, il a tous les défauts et peu de vertus propres, sinon d’être moins destructeur que la dynamite ou le raz-de-marée.
Yves Citton
Yves Citton enseigne la littérature française du XVIIIe siècle à l’université de Grenoble au sein de l’umr LIRE (CNRS 5611). Membre du comité de rédaction de la revue Multitudes, il a récemment publié chez éditions Amsterdam Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? ainsi que L’Envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières. Il a co-édité, avec Frédéric Lordon, Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects et, avec Martial Poirson et Christian Biet, Les Frontières littéraires de l’économie.
Lectures : Michel Vanni, L’Adresse du politique. Essai d’approche responsive, Bernard Waldenfels, Topographie de l’étranger, Camille de Toledo, Le Hêtre et le Bouleau. Essai sur la tristesse européenne, suivi de L’Utopie linguistique ou pédagogie du vertige, GX Jupitter-Larsen, Saccages. Textes 1978-2009

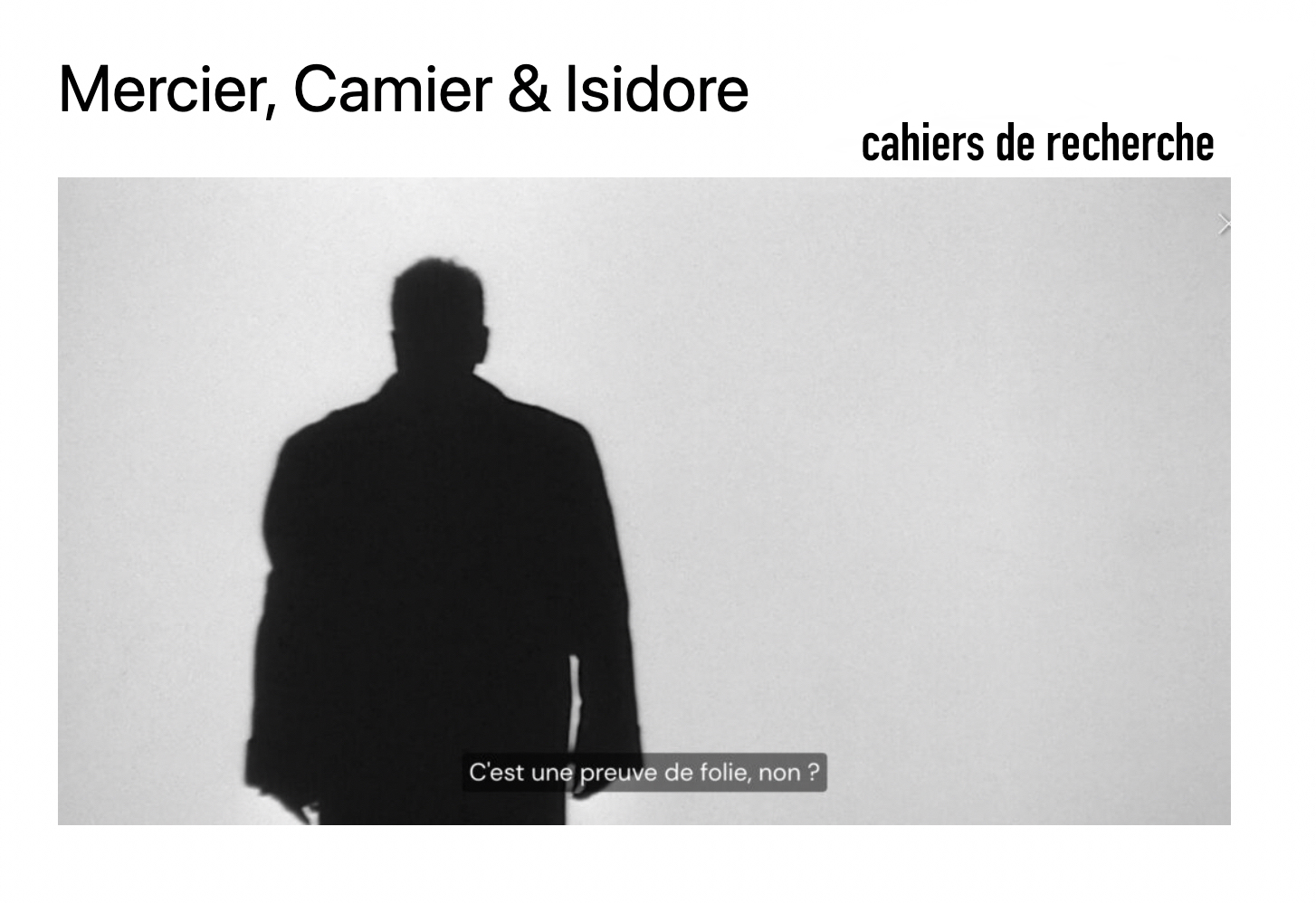



Pour que la gauche n’ait plus honte d’être mal-à-droite, par Yves Citton
Texte paru la première fois in La Revue Internationale des Livres et des Idées, numéro 15, en date du 06/01/2010. Article reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteur.
Et s’il fallait concevoir la politique comme relevant d’une réponse forcément maladroite, à une question dont on ne sait jamais si elle se pose vraiment, ni à qui ? Et si l’incertitude dont témoigne cette question pouvait être perçue, dans l’Europe d’aujourd’hui, avec autre chose que de la tristesse, de la culpabilité ou du dépit ? Et si l’on essayait de redéfinir la conscience de « gauche » par le fait d’être « mal-à-droite » ?
C’est d’une façon remarquablement désespérée qu’ont été célébrés, cet automne, les vingt ans de la chute du Mur. Alors que les quarante ans de mai 1968 avaient au moins été l’occasion de réchauffer quelques vieilles polémiques, l’effondrement du Rideau de fer a fait l’objet d’une jubilation parfaitement paralysée : bien sûr que personne – à part quelques vieux Ostalgiques observés avec un amusement condescendant – ne regrette l’avant ; bien sûr que tout le monde repense avec émotion à la délicieuse surprise éprouvée sur le moment, à la vue d’un effondrement aussi rapide et irénique. Quant à en tirer quelque chose à espérer pour l’avenir, ou même pour le présent, il aurait sans doute été considéré comme naïf d’en exprimer le désir. La droite se contente d’y voir le triomphe de la « liberté » sur le «totalitarisme» . La gauche ne peut ni revendiquer un passé (« socialiste démocratique ») peu glorieux, ni se retenir d’idéaliser l’époque d’avant-la-Chute (les «Trente glorieuses»), au cours de laquelle la peur du rouge permettait quand même de contenir la domination aujourd’hui effrénée du capitalisme conquérant.
Un philosophe passe à travers le mur
Quelques livres récents enjambent heureusement la (vraie) frontière qui continue à séparer la France et l’Allemagne pour repeupler ce no man’s land de la pensée qui paraît avoir entouré le Berlin de ces derniers mois. Les deux premiers percent le mur du silence qui a entouré l’oeuvre d’un des grands philosophes allemands vivants, dont l’oeuvre a été fortement nourrie par les années de jeunesse qu’il a passées à Paris, mais dont les écrits n’ont encore été diffusés dans le domaine francophone que de façon confidentielle . Bernhard Waldenfels, né en 1934 et professeur de philosophie pendant une vingtaine d’années à l’université de Bochum, a publié outre-Rhin une trentaine de livres, approfondissant une réflexion phénoménologique inspirée de Husserl et de Merleau-Ponty, dont il fut l’étudiant au début des années 1960 et dont il a traduit plusieurs oeuvres en allemand.
Ce sont des philosophes lausannois, réunis au sein du Groupe de la Riponne, qui ont entrepris depuis plusieurs années déjà de faire passer sa pensée dans le monde francophone et qui viennent de publier une splendide traduction d’un de ses ouvrages, Topographie de l’étranger (datant de 1996). L’ouvrage sollicite l’approche phénoménologique pour analyser les multiples formes de manifestation que prennent l’étranger et l’étrangeté dans notre expérience du monde. Du frère que je croyais connaître et qui me surprend soudainement par une parole inattendue jusqu’à « l’étrangeté absolue » que je rencontre au cours d’expériences-limites, ce sont toutes les variétés et les gradations d’intensité de l’étrangeté qu’explore le livre. Les lecteurs allergiques à la phénoménologie (allemande) risquent d’être parfois agacés par une certaine tendance à parler de « l’étranger » comme d’une forme d’expérience subsumable sous un seul et même concept : même si l’auteur rappelle sagement qu’«on ne rencontre jamais l’étranger ou les étrangers, mais toujours certains étrangers déterminés », et les impatients souhaiteront parfois qu’on en arrive plus vite à des analyses ancrées dans des situations historiques (et dans des rapports socio-politiques) plus précisément définies.
Comment protéger l’étrangeté ?
Les autres (ou les mêmes) trouveront toutefois une vertu très particulière dans l’apparente « naïveté » politique de ces analyses phénoménologiques. Dans ce volume au moins , et même s’il revient souvent sur les drames de l’ex-Yougoslavie qui se déroulaient au moment de la rédaction de l’ouvrage, Bernhard Waldenfels débarrasse « l’étranger » de toute la fantasmatique obsidionale qui l’entoure dans la plupart des discours politiques et philosophiques actuels. Au lieu de nous peindre – nous autres Européens vivant après la chute du Mur – dans une forteresse assiégée de hordes d’envahisseurs venant de l’Est ou du Sud, impatients de réclamer leur part du gâteau de notre prospérité, il décale drastiquement la perspective pour étudier comment nous pouvons faire mouvement vers l’étranger qui vient à nous.
À la suite de Husserl, Bernhard Waldenfels se demande longuement comment rendre accessible l’inaccessibilité qui caractérise l’étranger. Il fait fortement sentir en quoi la menace elle-même que perçoit notre mentalité obsidionale participe d’une (mauvaise) façon de réagir à l’étrangeté intime que l’étranger révèle en nous. Au lieu de voir en cette inaccessibilité ou en cette intimité une source d’angoisse, il nous invite à y voir une occasion de découverte, qui peut être profondément inquiétante, mais qui est ici traitée sur le mode actif de l’exploration plutôt que sur le mode passif de l’invasion subie : « l’expérience de l’étranger signifie plus qu’un accroissement d’expérience, elle se renverse en un devenir-étranger de l’expérience et un devenir-étranger à soi-même pour celui qui en fait l’expérience » (p. 16).
En insistant sur la dimension topographique de l’étrangeté, Bernard Waldenfels esquisse quelque chose qui pourrait ressembler à « l’utopie d’un socialisme des distances » rêvé par Roland Barthes dans sa première année de cours au Collège de France sur le « vivre ensemble » : « l’étranger doit d’abord être pensé à partir des-lieux-de l’étranger, comme un ailleurs, un extra-ordinaire qui n’a pas de place originairement dévolue et qui se dérobe à toute mise en ordre. Inversement, l’espace topique doit être pensé de telle sorte qu’il autorise des lieux propres et des lieux étrangers sans pour autant niveler et circonscrire d’emblée la différence entre le propre et l’étranger» (p. 18).
C’est bien l’ébauche d’une politique de gauche qui prend forme dans ce type d’approche. Alors que la droite surfe sur les angoisses xénophobes en se demandant comment se protéger des étrangers (perçus comme des envahisseurs), il serait définitoire de la gauche, face à la chute de certains murs, de se demander comment protéger les étrangers en nous, comment aménager des lieux d’éclosion de l’étrangeté au sein d’un univers globalement familier. Cette topographie débouche donc sur un premier enseignement : la gauche a bien raison d’être mal-à-droite dans tous les lieux où l’étranger est perçu comme une menace contre laquelle il faut se protéger ; elle devrait en revanche se trouver bien-à-gauche partout où l’on s’efforce de protéger l’étrangeté contre une familiarité envahissante.
Phénoménologie et politique
C’est sans doute un paradoxe de cet ouvrage qu’il ait reçu une traduction absolument exemplaire, aussi fluide que dense, aussi claire que consistante . Cela lui confère la propriété miraculeuse de passer à travers le mur de la différence linguistique en paraissant être absolument chez lui dans une langue française qui lui est totalement familière. Du même coup, toutefois, cet exploit tend à effacer la dénivellation « entre le propre et l’étranger », dénivellation dont l’ouvrage souligne pourtant le caractère fécond. Aurait-il donc fallu multiplier les germanismes pour protéger l’étrangeté de la pensée allemande, et conformer l’expression au contenu ?
Si une telle question est, bien entendu, oiseuse, « purement rhétorique », c’est qu’elle ne s’articule à aucun enjeu pratique, et n’entraîne aucune implication politique. Or la phénoménologie de Bernhard Waldenfels contient le noyau d’une théorie politique remarquablement fine et pertinente au sein de nos débats les plus actuels. Plus qu’à travers Topographie de l’étranger, c’est à travers un livre rédigé par l’un des traducteurs de cet ouvrage, qui comme ses collaborateurs, est par ailleurs lui-même philosophe de plein droit, qu’apparaît le mieux la portée politique de la phénoménologie waldenfelsienne. Dans L’Adresse du politique. Essai d’approche responsive, Michel Vanni commence par présenter de façon méthodique et synthétique la théorie de la responsivité échafaudée au cours des dernières décennies par Bernhard Waldenfels, avant de la faire entrer dans un dialogue serré avec la philosophie française contemporaine, les parties ultérieures se concluant sur une confrontation avec Jean-Luc Nancy sur la question de la communauté, avec Jacques Rancière sur celle des institutions, avec Jacques Derrida sur celle des transformations sociales et avec Alain Badiou sur celle de la fidélité militante. Michel Vanni se livre donc à une politicisation radicale (quoique toujours « douce », on y reviendra) de la phénoménologie waldenfelsienne. L’entreprise est passionnante et importante : il vaut la peine de la suivre pas à pas.
La responsivité selon Bernhard Waldenfels
Plutôt que de la théorisation de l’étranger proposée par Bernard Waldenfels, Michel Vanni s’appuie sur la façon dont le philosophe allemand conçoit « le schème de la réponse » : « toute signification, tout geste pratique constitue une réponse déjà donnée, ou déjà en train de se donner, à une requête étrangère, c’est-à-dire irrécupérable par une saisie quelconque. Toute identification, ou toute constitution de sens, ne s’effectue qu’à partir de ce mouvement de répondre déjà engagé, et la requête qui l’anime ou l’aiguillonne n’est elle-même lisible – toujours imparfaitement – qu’à partir de lui . » Contrairement à nos habitudes, qui nous font concevoir la réponse comme faisant suite à une question préalable, l’approche responsive nous invite à penser que « c’est toujours la réponse qui est première, et ce à quoi elle répond ne se révèle qu’après coup et qu’imparfaitement à travers des gestes plus ou moins maladroits qui se seront déjà initiés » (p. 89).
On commence donc par répondre, sans encore savoir précisément à quoi ou à qui. Autrement dit : on se sent faire face à des requêtes, dont la plupart ne sont pas explicitement formulées comme telles. Une femme enceinte porte une valise dans un escalier de métro : elle ne me demande rien, et pourtant je peux avoir envie de répondre à son effort en l’aidant à porter sa valise. On répond donc à des situations dans lesquelles on se trouve immergé, sans avoir forcément choisi de l’être. On peut souvent se tromper sur l’existence de la demande : peut-être que la femme enceinte préfère affirmer son autonomie en portant elle-même sa valise plutôt qu’en voyant des inconnus la traiter comme une invalide. Même dans les cas apparemment plus clairs où un ami me demande explicitement un service, n’est-ce pas autre chose qu’il me demande en réalité ? Ne cherche-t-il pas à être rassuré, plutôt qu’aidé ?
C’est dès ce stade que Michel Vanni introduit la notion centrale de maladresse, à comprendre ici comme une incertitude sur l’adresse, l’adressage, la bonne identification de la requête perçue par celui qui répond : «je propose de parler ici d’une essentielle maladresse de la réponse ou du répondre, au sens d’une incertitude dans l’adressage de la réponse et de la requête qui l’anime, ainsi que d’une essentielle fragilité du geste même de réponse, une certaine forme de « gaucherie » dans les gestes. Incertain de sa légitimité, le geste de réponse s’avance déjà, fragile et maladroit, au sein d’une pluralité conflictuelle de requêtes qu’il ne parvient pas à épuiser, mais qui le maintiennent dans un déséquilibre perpétuel qui n’est qu’un autre nom pour dire réinvention et fécondité » (p. 79).
Cette fragilité essentielle n’empêche nullement certaines requêtes d’apparaître comme « incontournables » (p. 51). Plus généralement, sitôt qu’une requête se fait sentir, elle témoigne de l’insuffisance des réponses antérieures, qui n’ont pas réussi à la résorber. Cela impose du même coup à chaque réponse l’exigence de faire oeuvre d’invention, puisque les réponses déjà existantes, « toutes faites », ne se sont pas révélées adéquates. D’où un constant déplacement des réponses au fil du temps : « l’insuffisance des réponses face aux requêtes qui les aiguillonnent implique qu’elles se trouvent constamment déplacées et remises en cause par de nouvelles réponses, qui viennent en reprendre l’enjeu. […] Je suis contraint dans l’urgence d’inventer des réponses partiellement nouvelles, car les anciennes ne suffisent pas, elles ne sont jamais totalement adaptées, et surtout elles arrivent trop tard face à l’urgence pratique née de la situation » (p. 54-56).
L’approche responsive nous fait donc envisager le monde humain comme tramé de requêtes perçues dans l’incertitude de leur adresse, de réponses toujours précipitées, toujours en quête de renouvellement et d’ajustement, toujours décalées et décalantes.
Un monde de gestes et de frayages
Si la source, l’objet et l’adresse des requêtes restent toujours incertains, la nature des réponses et des répondants nous invitent, elles aussi, à questionner nos fausses évidences. Le monde de la responsivité est moins peuplé de personnes (individualisées) que de gestes (transindividuels) (p. 144) : « les répondants sont des corps individuels ou collectifs, qui ne préexistent pas à leurs actes et à leurs réponses, mais qui se concrétisent au contraire comme corps dans et par leurs réponses, agrégés pour ainsi dire aux carrefours des requêtes multiples qui s’entrecroisent dans le champ. Il faut encore ajouter que cette agrégation ou cette condensation matérielle n’est pas simplement passive, pur effet mécanique d’un corps sur un autre, mais reprise créatrice comme corps en mouvements, gestes se constituant dans leur matérialité dans le mouvement même de leur action » (p. 249).
Loin d’être des données premières, les individus qui ont pris corps dans ce monde résultent de la coagulation de certaines formes stabilisées de réponses. Chacun de nous est à concevoir comme constitué par un « carrefour de requêtes multiples », comme la « concrétisation » de leur entrecroisement répété. C’est bien sûr le fond d’une ontologie du traçage et du frayage que Michel Vanni dessine la responsivité waldenfelsienne : chaque corps individuel et collectif apparaît comme une « ornière traditionnelle », qui « se creuse en tant que trajet de réponses, constamment reprises au sein d’un même espace de jeu : c’est précisément le trajet formé par des séries de déplacements, d’écarts et de remises en cause. […] « Nous » sommes obligés, moins par la contrainte d’un héritage figé à assumer tel quel, sans contestation, que par l’implication d’une série d’enjeux, de remises en cause, dont la portée ou la virulence s’impose à nous d’autant plus fortement que ces séries de déplacements ont été importantes, radicales » (p. 72).
Tirons-en deux enseignements supplémentaires pour une (re)définition de la gauche. D’une part, les politiques (progressistes) de gauche sont des « ornières traditionnelles », au même titre que les politiques (conservatrices) de droite. Leur prégnance et leur force relèvent de l’inertie de certaines habitudes, de la reprise de certains trajets déjà frayés sous la pression de poussées relativement constantes. La « radicalité » d’une transformation sociale – d’une Révolution – ne vient pas tant de ce qu’elle arrache toutes les racines du passé que des nouvelles ornières qu’elle parvient à creuser pour orienter durablement les développements à venir.
D’autre part, à l’heure où c’est la droite qui est affectée d’une fièvre de réformite aiguë, les politiques ne doivent pas être jugées par leur prétention à l’innovation, mais par le type de sillon qu’elles creusent, selon que les personnes et les collectivités s’y trouvent bien (à gauche) ou mal (à droite).
Une pensée des institutions
Ce que frayent les gestes de réponses a pour nom institution. « Par institution, on entendra donc la fixation progressive des traits constituant la forme commune à toute une série de réponses qui traversent une portion du champ pratique » (p. 130). C’est l’un des grands mérites de l’approche responsive que de nous doter d’une pensée des institutions, rare dans un paysage intellectuel français où l’on paraît critiquer d’autant plus radicalement les institutions qu’on entérine aveuglément leur fonctionnement quotidien.
En même temps qu’il montre les forts parallélismes entre la responsivité waldenfelsienne et certaines pensées politiques françaises contemporaines, Michel Vanni insiste sur une différence fondamentale qui sépare une gauche inspirée de Bernhard Waldenfels et une gauche inspirée par Jacques Rancière ou Alain Badiou. Contrairement au « dualisme » qui structure profondément les systèmes proposés par ces deux penseurs (police/politique, événement/état de la situation), Michel Vanni nous invite à percevoir les deux pôles comme résultant de tensions entre diverses séries de requêtes et de réponses tissées au sein d’une même trame : « la réponse instituée et son moment instituant ne représentent pas deux instances hétérogènes, mais deux moments d’un même processus de différenciation. Aussi dans ce cadre, l’État ne saurait s’opposer simplement et conflictuellement aux nouvelles réponses sociales qui viennent le déplacer, parce qu’il constitue lui-même une ancienne réponse » (p. 307) .
Si l’on se sent mal-à-droite en subissant les pressions effrénées de la logique marchande, en observant les dérives sécuritaires des appareils étatiques ou en constatant le creusement des sillons souverainistes et xénophobes, une politique de gauche n’est pas condamnée à devoir agir à partir d’une position d’extériorité envers la « police » (à entendre ici au sens ranciérien de « gestion administrative ») ou envers l’État (au sens badiousien des « données de la situation»). Indépendamment du fait que le statut d’une telle extériorité pose un problème théorique, il est possible aussi de concevoir des gestes qui s’efforcent plus modestement de tirer vers la gauche la trame sociale des réponses entrecroisées. Cette gauche-là n’a pas besoin d’ériger le tréteau d’un théâtre politique pour s’y livrer à des gesticulations spectaculaires : c’est dans ses gestes quotidiens qu’elle se retire des lieux où elle se trouve mal-à-droite et qu’elle pousse ses trajets de réponses, ses frayages, ses ornières vers la gauche.
Chaque subjectivation (vous, moi), chaque collectif (une famille, une ville, une nation), chaque organisation (une entreprise, une administration, une revue, un parti) apparaissent ainsi comme des institutions simultanément portées par et porteuses de la multiplicité des gestes de réponses qui s’entrecroisent pour s’effectuer en elles. L’institution n’est rien d’autre que cette répétition de gestes, lesquels ne sont bien entendu pas le fait de choix individuels, mais de relations sociales. Dans la mesure où ces gestes résultent de relations durables, visent à satisfaire à des besoins relativement stables et tendent à suivre des frayages déjà tracés, l’institution persiste dans son être ; dans la mesure où chacune des réponses qui la constituent fait toujours l’objet de déplacements (généralement infinitésimaux, parfois significatifs), toute institution est en évolution constante, grouillante.
L’insuffisance du commun
Cette conception immanentiste et tramée des institutions permet à Michel Vanni d’éclairer de façon originale la question du « commun ». Première caractéristique : « ce commun est toujours insuffisant », « comme un ouvrage à remettre constamment sur le métier », « miné par une exigence insatisfaisable » (p. 149). En variation sur la « communauté désoeuvrée » de Jean-Luc Nancy – mais aussi peut-être du « peuple qui manque » de Deleuze –, le commun apparaît dans la phénoménologie responsive comme toujours-à-construire, comme un projet perpétuellement en chantier, qui progresse sans plan ni architecte central, mais qui se tisse au fur et à mesure des besoins ressentis par les participants.
Deuxième caractéristique, liée à la première : même si les ornières qui orientent nos comportements nous inscrivent dans une « tradition » collective, le commun ne relève pas tant du donné hérité, dont l’unité viendrait du passé, que d’un appel d’air venant d’une pluralité hétérogène de requêtes à venir. « Le commun n’est pas posé comme un requisit préalable, mais il résulte au contraire – toujours imparfaitement – d’une requête plurielle qui lui est hétérogène, et qui l’inquiète perpétuellement en l’excédant » (p. 151).
Troisième caractéristique : parce qu’il est à situer dans la relation, et parce que la relation est ce qui me constitue, le commun n’est pas tant à chercher dans la plénitude du collectif que dans un vide que je ressens intérieurement, et qui m’appelle à le remplir par ma réponse : « j’engage le commun à travers mon répondre, se reprenant ici et maintenant, parce que ce commun fait défaut. C’est précisément à partir de ce défaut du commun qu’une rencontre est possible » (p. 152). Autrement dit, le commun est la valeur constitutive de la gauche, en ce qu’il émane des manquements éprouvés par les réponses qui se sentent mal-à-droite.
Percer le mur des ornières
Si le sentiment subjectif de se trouver mal-à-droite est bien le moteur des réponses qui tirent notre trame sociale vers la gauche, Michel Vanni nous aide également à identifier deux gestes qui pourraient fournir la base d’une (re)définition des politiques de gauche. Le premier de ces gestes concerne l’attitude à adopter au sein des institutions qui/que frayent nos comportements. Michel Vanni montre que ces institutions sont inévitablement soumises à des processus de mythologisation, qui fossilisent leur origine dans des généalogies mystifiantes (p. 132), ainsi qu’à des processus de normalisation, par lesquels « les structures instituées tendent à soumettre a priori tout geste pratique et toute parole à des règles et à des buts prédéterminés » (p. 61), étouffant la nature inventive et adaptative de la réponse.
Quoique la mythologisation et la normalisation aient généralement des effets pervers et regrettables, ce sont deux dimensions inhérentes à la persévérance dans l’être de toute institution, constitutives de toute « ornière traditionnelle ». Il est donc vain de s’en plaindre au nom d’une nostalgie romantique de l’âge d’or d’un autonomisme idéal ou d’une spontanéité perdue. Il est en revanche très important de combattre les effets de clôture sur soi entraînés par ces deux processus. Pour le dire autrement, et pour en tirer un quatrième enseignement : si tout devenir institutionnel passe nécessairement par le creusage d’une ornière, une politique se réclamant de la gauche s’efforcera de percer le mur de telles ornières, en autant de points que possible, afin de les ouvrir sur ce qui leur est extérieur.
On retrouve ici la problématique traitée dans Topographie de l’étrangeté : « l’enjeu politique consiste donc pour Waldenfels dans l’ouverture des institutions à leur propre mise en demeure sous l’aiguillon d’une étrangeté irréductible. Le danger est constitué ici par la rigidification mortifère de ces institutions autour du déni ou de l’exclusion plus ou moins violente de cette stimulation fécondante » (p. 63). Tout le monde admet qu’il faut des institutions – au double sens où nous en avons besoin et où elles sont toujours en défaut par rapport aux exigences (à venir) du commun. Toute institution est une ornière rigidifiée : le véritable problème n’est pas cette rigidification elle-même, mais bien plutôt la direction dans laquelle nous pousse l’ornière, ainsi que l’imperméabilité du mur qui la borde.
Ce qui tire vers la droite donne à cette rigidification un caractère « mortifère » en « déniant et en excluant de façon plus ou moins violente la stimulation fécondante » née du contact avec ce qui est « étranger » à la nature et au fonctionnement de l’institution. Ce qui tire vers la gauche travaille l’institution de l’intérieur pour la mettre en relation fécondante avec son extérieur, pour en nourrir son devenir, pour en questionner les frontières. Non pour en abattre les murs et remettre tout à plat. Mais pour y ouvrir des brèches, qui permettent aux différentiels de pression de faire sentir leurs effets, d’ajuster certaines inégalités, d’ouvrir de nouvelles voies de développement.
Le soin des brèches migratoires
Exemple concret : dans le traitement des pressions migratoires, la droite tend simultanément à monter en épingle (dans sa xénophobie obsidionale), à dénier et à exclure (dans ses pratiques gouvernementales) la réalité d’un dehors où s’accumulent pauvreté, exploitation, oppression et dégradation du milieu vital. Par le même geste, elle rigidifie notre forteresse en entourant son extérieur de barbelés et de surveillance policière aussi imperméables que possible, tandis qu’elle produit, à l’intérieur, un statut de sans-papiers qui exacerbe les possibilités d’exploitation néo-esclavagiste.
Une réponse de gauche face au noeud (terriblement complexe) de requêtes issues des phénomènes migratoires ne consisterait ni à poursuivre les politiques de droite (comme l’ont fait nombre de dirigeants socialistes), ni à abolir du jour au lendemain toutes les frontières nationales (comme personne ne le préconise), mais à multiplier les brèches à travers lesquelles l’intérieur (économiquement privilégié) de l’ornière européenne entre en contact avec son extérieur.
L’aiguillon d’étrangeté qui « ouvre les institutions à leur propre mise en demeure » passe ici par la reconnaissance, problématique mais « incontournable », des requêtes légitimes qui n’opposent pas tant les Européens aux pays du Sud ou de l’Est que les privilégiés aux démunis (à l’intérieur de chaque pays comme sur leurs frontières). Seule la mentalité obsidionale nous fait craindre des hordes de miséreux « envahissant » de leurs élans chaotiques nos pays bien rangés. Ce dont sont mises en demeure nos institutions, ce n’est pas d’un nivellement qui nomadise toute l’humanité, mais d’une correction des inégalités historiques qui minent notre topographie actuelle de l’étrangeté, en écrasant la plupart des cultures sous des pressions qui leur interdisent d’agencer une mise en communication « stimulante et fécondante » des lieux propres et des lieux étrangers.
Éloge de la maladresse
Agir sur les brèches : c’est très précisément ce que font les associations de (la gauche de la) gauche. On ne manquera pas de sommer celle-ci de proposer son plan miracle qui résoudrait « le problème de l’immigration ». Or, indépendamment même du contenu d’un tel plan, c’est la sommation elle-même qui est à percevoir comme relevant d’une posture de droite. Le second geste que suggère Michel Vanni pour définir les politiques de gauche est en effet celui par lequel nous sommes amenés à nous soustraire à l’exigence intimidante (et paralysante) d’une telle sommation. Ce geste récuse l’ambition de maîtrise, pour valoriser l’aveu de maladresse.
L’« ethos propre à la démocratie », écrit-il, « consisterait à pouvoir se maintenir dans la fragilité et la maladresse inhérentes aux réponses pratiques, sans chercher à les fuir comme un défaut ou un risque inquiétant, mais bien plutôt à les assumer comme une dimension consubstantielle, non seulement nécessaire mais féconde. L’ethos démocratique consisterait donc en somme à revendiquer cette maladresse contre l’hybris de la maîtrise totale et de l’assurance garantie face à toute incertitude » (p. 211).
Agir sur les brèches, toujours en retard sur l’urgence des requêtes et en avance sur une compréhension suffisante de la situation, cela condamne nécessairement à faire des gestes maladroits. « La maladresse est le moteur du changement » (p. 183), en ce que c’est à travers elle que passent les déplacements et les décalages qui reconfigurent et redirigent les frayages institutionnels – avec à chaque fois des risques de « dérapages », d’« écarts de langage », d’« effets secondaires » immaîtrisés. Au lieu de subir comme une malédiction (ou dans la honte) la précipitation, l’incertitude et la mal-adresse inhérentes à toute réponse (est-ce à moi de répondre ? à qui exactement ? au nom de quoi ?), Michel Vanni nous invite à « revendiquer cette maladresse » comme un antidote à l’arrogance commune aux détenteurs de pouvoir. Face au règne des dirigeants sans peur et sans reproche, des chevaliers d’industrie, des as de la finance et de toutes leurs cohortes d’experts confortablement assis sur leur parfaite maîtrise des dossiers, l’essence d’une politique de gauche devrait peut-être consister en « une certaine forme de « gaucherie » dans les gestes » (p. 79).
De la gauche(rie) comme mode d’énonciation
« Militer pour l’incertitude ou pour la maladresse » (p. 309) implique de chercher à réformer (en permanence) les institutions, de façon à assouplir les réponses fatalement ossifiées (bureaucratisées) qu’elles apportent aux requêtes de leurs participants et de leurs utilisateurs. Le coefficient de gaucherie se mesurerait ici au « degré d’ouverture des institutions à la maladresse de leurs propres réponses » (p. 268). Comme le suggère toutefois Michel Vanni lui-même, c’est aussi en termes de « posture subjective » que doit être abordée la gaucherie. Au lieu de se définir principalement par certains contenus idéologiques (être contre les privatisations, pour l’impôt sur les grandes fortunes, etc.), l’imaginaire de gauche mérite sans doute de se caractériser par certains modes d’énonciation. Une subjectivité est (au moins un peu) de « gauche » dès lors qu’elle se trouve mal-à-droite face au manager qui joue au petit chef ou face à l’expert qui assène ses vérités en les appuyant de tout le poids de son autorité scientifique. Dès lors qu’on ressent le besoin de « lutter contre toute une mythologie de l’adresse et de l’efficacité, largement dominante à l’âge du capitalisme mondialisé » (p. 258), l’ennemi n’est bien entendu pas à dénoncer dans l’expert ou le manager eux-mêmes, qui ne font sans doute que répondre de leur mieux à « la pluralité conflictuelle de requêtes » où ils se trouvent enchevêtrés. Si ennemi il y a, il faut le repérer dans certaines façons de mettre en scène le geste de la réponse et de l’énonciation.
Il convient donc de distinguer « deux « postures » subjectives différentes : la fidélité à la maladresse constitutive des réponses d’une part, et le déni de celle-ci d’autre part » (p. 257). Dès lors que nul ne saurait échapper à la maladresse, ce qui est décisif, c’est le rapport (de fidélité ou de déni) qu’on entretient avec elle. La gauche, si elle veut bien tirer les conséquences de son sentiment d’être « mal-à-droite », doit apprendre à se montrer fidèle à une certaine gaucherie constitutive.
Confiance dans la maladresse et fidélité à l’expérimentation
On sent immédiatement le problème « de communication » inhérent à cette (re)définition de la gauche : il est peu réaliste de se faire élire aux postes de responsabilité en exhibant fièrement sa maladresse, sa gaucherie, ses incertitudes, son insuffisance… Le plus grand défi pour la gauche serait d’apprendre à tirer de sa maladresse un spectacle doté d’une force de conviction propre. En devenant des « apôtres de la maladresse », des politiciens new look devraient s’entraîner à faire de leur gaucherie l’objet d’une pratique virtuose, afin d’instaurer cette « confiance dans la maladresse » esquissée dans les dernières pages du livre de Michel Vanni (p. 302).
Une telle « gaucherie » peut toutefois se réclamer d’une notion qui paraît bénéficier d’un certain retour en force (profitant habilement des innombrables slogans nous enjoignant à l’« innovation »), la notion d’expérimentation . Comme le montre parfaitement l’approche responsive, parmi tous les gestes pratiques, qui relèvent tous de la maladresse, la décision politique, de par la complexité des requêtes et des conditions auxquelles elle doit faire face, relève nécessairement et dans tous les cas de la gaucherie, du bricolage, du plan sur la comète, du coup de dés, du pari, du ballon d’essai. Les « réformes » de la droite sarkoziste (sur l’assurance-chômage, l’éducation, l’Université, la TVA des restaurants, etc.) ont un caractère improvisé, mal ficelé, qui inquiète légitimement tous ceux qui ont à les subir. De réelles réformes (de gauche), authentiquement audacieuses et progressistes, pourraient difficilement faire pire dans le bricolage expérimental et l’improvisation hasardeuse.
La grande différence est que la droite fait passer (en force) ces « réformes » au nom de l’« expertise », de la bonne « gouvernance », de la « transparence statistique », bref du savoir, de la maîtrise et de l’adresse – en déniant leur caractère expérimental, leurs incertitudes et leur maladresse constitutive. Les multiples déréglementations du système bancaire et financier ont été promues (à la fois par tous les hommes du président et par certains gouvernements socialistes) au nom des lois économiques et de la science managériale : on a vu les résultats calamiteux de cette sorcellerie, qui n’a réduit que très brièvement la morgue des apprentis sorciers. Par contraste, la gaucherie consiste donc à rejeter le déni du caractère nécessairement expérimental de la politique, pour s’en réclamer ouvertement, afin d’en tirer des conséquences dégrisantes, mais surtout afin d’en valoriser les potentiels émancipateurs.
Ébrécher l’ornière de la mnémocratie
Un autre livre récent, se réclamant lui aussi d’un fort lien à l’Allemagne, aborde le nouage entre fidélité à l’expérimentation et audace de la maladresse. Dans Le Hêtre et le Bouleau, Camille de Toledo nous convie à une promenade dans le Berlin qui célèbre si tristement les vingt ans de la chute du Mur. Lui aussi tente de nous désenvoûter (de notre désenchantement même), lui aussi réfléchit sur les brèches, lui aussi nous appelle à inventer une « pédagogie du vertige » qui est la soeur jumelle de la « confiance en la maladresse » évoquée par Michel Vanni. À la fois romancier et essayiste, Camille de Toledo nous promène autant dans la langue française que dans la ville allemande : ce sont des jeux de polysémie (l’« aspiration » comme désir et comme souffle), des diffractions poétiques de définitions de dictionnaire (le mot « hêtre »), des homophonies (« hêtre » – « être ») qui servent de passages secrets d’un quartier à l’autre de sa pensée. Loin de se complaire dans le vain jeu des mots, il en fait un outil heuristique des plus puissants, pour articuler une thèse à la fois douce et ferme.
Traduite en termes vanniens, cette thèse pourrait prendre la forme suivante : la « tristesse européenne », dont témoigne emblématiquement Berlin vingt ans après la chute du Mur, consiste en un durcissement de l’ornière mémorielle, qui en est arrivée à obstruer toutes les brèches par lesquelles nous pourrions encore envisager d’expérimenter l’advenir d’un autre monde possible. Les dernières décennies ont été plombées par une « inertie mémorielle » qui a « borné notre esprit » et « bridé tout élan spirituel » en direction d’une « idée d’utopie », soupçonnée de « porter en germes les crimes de masse et les rouages d’une déshumanisation » .
C’est sous la chape de cette mnémocratie – triplement hantée par les crimes du nazisme, par ceux du communisme et par une équivalence simpliste établie entre les deux – que s’est construit « l’édifice institutionnel européen : non pas le dêmos (pouvoir d’un peuple cherchant à se libérer d’un tyran ou d’une métropole coloniale), mais le mnêmos, la mémoire et la honte d’une culture qui, par deux fois, s’est renversée en barbarie » (p. 83). Avec pour résultat principal que « le rêve, l’imagination, le désir de transformation ont été tenus en laisse » (p. 118), étouffés, atrophiés.
H
Cette triste paralysie de notre imaginaire politique sous le poids de la mnémocratie, Camille de Toledo l’épingle à travers le jeu d’une lettre – H. L’ornière mémorielle a d’abord été frayée par la honte, une honte éprouvée, de façon bien compréhensible, envers les divers « crimes du XXe siècle ». Il reprend à Jacques Lacan le mot-valise d’hontologie qui transforme la philosophie de l’être en un discours de la honte. Cette honte a engendré à son tour une hantise, celle de ne pas pouvoir respecter la promesse du « plus jamais ça », nous plongeant dans le registre d’un autre mot-valise, repris cette fois de Jacques Derrida, l’hantologie. À la puissance de devenir qui anime l’être s’est substitué un monde de spectres, à la fois moralisateurs et démoralisants, qui « font parler les morts, ventriloquent au nom des charniers, des assassinés, et se permettent comme des possédés de juger le présent au nom des cendres » (p. 60).
Au dynamisme de l’être, nous avons substitué la tristesse du h-être. Camille de Toledo sourit de trouver cette définition de notre époque dans l’innocence d’un dictionnaire : « le hêtre européen est une espèce d’arbres à feuilles caduques ». Il ne peut s’empêcher « d’entendre dans le sens de « caduques », passées, flétries, qui sont sur le point de cadere, tomber » (p. 64). Les feuilles, les murs, les condamnations, les rideaux d’inauguration de monuments mémoriels tombent – en creusant à chaque fois l’ornière qui nous obstrue la perspective d’un autre avenir. D’où l’appel central de l’ouvrage : « Qui osera entailler cet ordre du passé dont l’antitotalitarisme a fait un engagement héroïque ? Qui osera dire enfin qu’il faut, pour guérir de la hantise, non pas défendre infiniment le Devoir de Mémoire, mais reconnaître le travail proprement humain de l’oubli ? » (p. 71).
Ce que bloque le h du hêtre, de la hantise et de la honte, c’est en effet cela même que la graphie et la phonétique paraissent lui faire exprimer : une puissance d’oubli (on ne sait jamais très bien où le mettre, ce foutu h muet), mais aussi et surtout, une puissance d’aspiration – une puissance de désir (d’un autre monde possible), une puissance de souffle (dans le sens où un geste audacieux peut être qualifié de « soufflé »), une puissance relevant proprement de l’esprit, de ce spiritus qui, comme le vent, souffle où il veut, renverse les montagnes et fait déborder les ornières. Malgré toutes les exploitations douteuses dont il a fait l’objet, Camille de Toledo revendique (avec quelques autres et à juste titre) une réappropriation de la notion d’esprit : « à force de contenir l’espoir du paradis en souvenir des enfers passés, nous avons détruit le levier spirituel de l’être. Ce levier qui nous fait espérer autre chose que ce qui est » (p. 34) .
Le banian et la pédagogie du vertige
Derrière le bouleau, qui était l’arbre hantant les récits des camps, et le hêtre, qui emblématique la tristesse honteuse du XXe siècle finissant, Camille de Toledo nous propose le banian pour stimuler notre capacité à imaginer un XXIe siècle enfin commençant. L’évolution du hêtre au banian entraînerait toute une série de transformations : on passerait du devoir de mémoire au travail de l’oubli et de la création, de l’hantologie au désenvoûtement, du commun des deux totalitarismes au commun de la coupure et de l’exil, de la consolation patrimoniale au devenir fictionnel du monde, bref, du monument et de la conservation à l’utopie et à la transformation (p. 168-169).
Le banian symbolise ce que Camille de Toledo appelle une « pédagogie du vertige », dont le funambule est le virtuose et dont les échos sont nombreux à la fois avec la « vision maladroite et fragile du politique » promue par Michel Vanni, avec la Topographie de l’étranger de Bernard Waldenfels et avec le travail de traduction mené par le Groupe de la Riponne. Camille de Toledo décrit en effet « le foyer de la maison de l’h-être, son antre instable, inconfortable » comme requérant une confiance et une virtuosité dans la maladresse, pour se bricoler une place, toujours fragile et incertaine, « comme la corde sur laquelle s’élance le funambule », au-dessus « de l’entre-deux des langues, de cet interstice d’erreurs, de malentendus et d’intraduisibles » qui relève de « l’effort proprement humain du traducteur pour tenter de faire entrer l’étranger dans la langue » (p. 146).
Des virtuoses de la gaucherie
Une pédagogie du vertige est sans doute nécessaire à toutes les forces de gauche pour apprivoiser leur gaucherie, pour s’en faire une force de vérité plutôt qu’un boulet de honte et de hantise. C’est toutefois peut-être sur ce point qu’un autre clivage pourrait s’instaurer au sein des sensibilités politiques qui se trouvent aujourd’hui être mal-à-droite – entre, d’une part, les apôtres de la gaucherie et, d’autre part, les adeptes du saccage.
L’enchantement stylistique produit par la richesse littéraire de l’essai de Camille de Toledo, la clarté et la précision exemplaires du traité de Michel Vanni, le somptueux travail de traduction accompli par les membres du Groupe de la Riponne confèrent tous à leurs auteurs une paradoxale position de maîtrise et de territorialisation dans leur apologie de l’étrangeté, de la maladresse et du vertige… L’engagement (indéniablement politique) de ces trois ouvrages se caractérise par une remarquable douceur. Il me paraît significatif qu’à la fois Michel Vanni (avec ses amis du Groupe de la Riponne ), et Camille de Toledo (avec ses associés de la Société européenne des Auteurs ) cultivent des modes de socialité qui parviennent à relever simultanément de la militance, de l’autonomie, voire d’une certaine radicalité, et d’une admirable convivialité. Cette sensibilité mal-à-droite s’efforce de créer des micro-environnements où l’on soit aussi bien-à-gauche que possible, dans des espaces aux angles polis et accueillants, débarrassés de toute agressivité inutile, de toute testostérone débordante. Des espaces de politesse et d’honnêteté, de sollicitude et d’esthétisation comparables peut-être aux salons du XVIIIe siècle.
C’est dans un tel espace de convivialité que nous convient les différentes formes de virtuosités dont font preuve les trois ouvrages discutés jusqu’à présent. J’aimerais conclure cette discussion en évoquant brièvement un traitement de la maladresse qui, au contraire, l’exacerbe dans son expression même, faisant exploser toute honte et toute hantise dans un joyeux saccage de toute forme de maîtrise – esquissant par là même une autre figure possible, bien plus inquiétante, d’une certaine gaucherie.
Le saccage comme résistance à la traduction
Un autre sous-groupe de travail au sein du Groupe de la Riponne (où l’on retrouve Francesco Gregorio accompagné cette fois de Christian Indermuhle et de Thibault Walter) vient de faire paraître un admirable petit livre (accompagnés d’un CD inédit, publié chez le même courageux éditeur Van Dieren, dans un tirage limité à 450 exemplaires) présentant le parcours et traduisant quelques textes du musicien de harsh noise GX Jupitter-Larsen, sous le titre Saccages. Le projet en est à la fois dans la continuité et en contraste absolu avec les trois livres précédents.
Imaginons qu’au lieu de polir et de peaufiner leur traduction de façon à la rendre parfaitement claire et parfaitement familière au lecteur francophone, les traducteurs de la Topographie de l’étranger y aient multiplié les germanismes, pour lui conserver son « étrangeté » constitutive, au point de le rendre incompréhensible à la fois à celui qui ne lit pas l’allemand, puisque tout y serait radicalement littéral, et à la fois au lecteur germanophone, puisque l’original aurait été néanmoins irréversiblement corrompu pour sa translittération en français.
Voilà à peu près le type de travail qu’accomplit GX Jupitter-Larsen. Le CD qui accompagne le livre en donne une illustration exemplaire : des voix (dont les plus discernables ont l’air de parler une langue extrême-orientale) sont superposées au point de se neutraliser les unes les autres, pour ne former qu’un agrégat saturé de toutes parts, un flux inaudible, c’est-à-dire incompréhensible – donc audible en tant que flux (et non paroles), en tant que son, « poly-onde », bruit, noise.
Un musicien casse les murs (du son)
Avec son groupe d’encagoulés peu convivialement intitulé The Haters (« les Haïsseurs »), GX Jupitter-Larsen s’est spécialisé dans l’exploration des bruits générés par des processus de destruction . À Paris, en 1992, cela consistait à « pousser lentement un microphone allumé dans une broyeuse pour l’abraser lentement jusqu’à n’en laisser qu’un moignon ». Ailleurs, il a utilisé « l’amplification du bruit produit par un entonnoir suspendu de façon à s’abraser sur un plateau tournant de papier de verre » (p. 48). La friction, le frottement, « l’érosion comme pénétration du vide » (p. 47) jouent un rôle central dans son univers de performances à la fois visuelles et sonores : « la majeure partie de mon oeuvre a consisté en l’amplification d’égrènements et de broiements » (p. 86). C’est bien sûr la brèche que l’artiste place ses micros : là où ça frotte, là où ça grince, là où ça coince, là où ça creuse, là où ça casse, là où ça fait mal (à droite, aux choses ou aux oreilles).
Plus radicalement, les Haters se sont rendus (in)famous – et se sont sans doute fait copieusement haïr en retour par les organisateurs de spectacles – pour leur habitude de prendre pour objet de destruction la salle même où ils étaient appelés à se produire (voir l’encadré). Au cours de ces saccages, il s’agissait bien de casser les murs et d’éroder les ornières : casser les murs du son et des convenances, des objets et des propriétés – et enregistrer (mentalement) le bruit que ça peut faire… La chute du Mur, pour peu qu’on ait eu l’idée de mettre des micros sur les pioches, les masses et les canifs qui l’ont attaqué (au lieu de jouer bêtement du violoncelle), aurait pu perfor(m)er un saccage très digne de GX Jupitter-Larsen .
On voit qu’on est à la fois très proche de la notion de frayage perçue comme centrale chez Michel Vanni (frayer vient du latin fricare, « frotter »), et très loin des attitudes de douceur promues par les trois auteurs précédents. Aucune marque de virtuosité, aucun appel à la pédagogie dans ce cas : on est dans la plus brutale maladresse, dans le vertige de la pure destruction. Aucune politesse ni convivialité dans les rapports sociaux : on est dans la libération d’énergie ravageuse, la spectacularisation de la haine (le catch est une référence fréquente au cours du livre), la provocation incontrôlée. Les frictions ne tendent pas ici à construire des trajectoires mais à détruire des formes – et pourtant c’est bien une trajectoire artistique que retrace ce livre, et ce sont bien des formes sonores qui sont produites par la destruction.
Écouter de la noise pour résister au déferlement du bruit
D’où un sentiment d’ambivalence face à ce livre profondément inquiétant. On y entrevoit l’horizon d’une pensée qui prend les risques de sortir des ornières (en les faisant éclater). C’est bien dans le domaine de l’expérimentation qu’on se situe ici, dans ce qu’elle a de plus « osé » et de plus hasardeux. Les écrits de GX Jupitter-Larsen déploient une réflexion riche et stimulante, qui grouille de formules éclatantes, troublantes, fulgurantes, injectant une précieuse dose de noise dans nos habitudes de pensée. « C’est ça, la culture noise » : « provoquer chez l’auditeur une stimulation intensive s’opposant à la torpeur due à l’hyper-sollicitation par les mass-médias, et lui offrir l’opportunité de choquer son corps par le biais de vibrations inconnues » (p. 85).
Cette culture déborde largement le cadre des seules pratiques musicales pour fournir des intuitions sur l’ensemble de notre expérience : « nous sommes à la technologie ce que le ver est à la terre » (p. 73) ; « la défiance vous ajuste à vous-même » (p. 63); « la connaissance est l’épave du mystère » (p. 78). Comme Camille de Toledo, GX Jupitter-Larsen fait d’ailleurs jouer un rôle central à la notion d’esprit au sein de sa pensée (un esprit conçu selon un rapport à la matière qui se conforme de façon frappante avec le parallélisme spinoziste).
Malgré ces mérites, et même si eux aussi se définissent par l’exacerbation d’une expérience historique caractérisée par le fait d’être mal-à-droite, les adeptes du saccage apparaissent toutefois comme l’envers de la gaucherie (prudente et conviviale) prônée à partir des livres précédents. On y sent en effet pointer la terreur d’un monde sans frayage, sans institution, sans adresse, sans écoute des requêtes environnantes, occupé seulement à l’expression d’une réponse écrasante envers autrui. « Qui ne prend pas de plaisir à faire sauter les choses ? » (p. 78). À cette (mauvaise) question, qui constitue un dangereux court-circuit envers les requêtes qui nous entourent et nous constituent en tant que sujets politiques, on peut répondre par une autre question : Qui souhaiterait vraiment vivre dans un monde où déferlerait un tel plaisir ?
La stimulation du noise vaut pour autant qu’elle nous aide à nous préserver des bruits de la destruction. Une gaucherie désirable tenterait précisément de maintenir son cap entre les deux extrêmes, également dommageables, que sont, d’un côté, la fossilisation de l’ornière (sous le poids de la rigidification des institutions ou de la pression mnémocratique) et, de l’autre, son abrasion complète par l’éclatement des énergies trop longtemps contenues en son sein.
Ne pas lâcher sur la souciance
Les forces qui peuvent se réclamer de la gauche (de la gauche) ont donc au moins deux façons d’être mal-à-droite. Celles qui agencent le saccage, même si elles peuvent produire des effets esthétiques stimulants comme c’est le cas de GX Jupitter-Larsen, s’engagent sur la voie d’une défaite politique sitôt qu’elles s’abandonnent à des pratiques relevant de l’abrasion. Il n’est pas besoin d’être prophète pour deviner que les banlieues, les inner cities, et autres territoires occupés sont appelés à se ré-enflammer dans un avenir proche : malgré les efforts menés sur d’innombrables brèches par des myriades d’associations, le feu des inégalités et des injustices maintenu en permanence sous de telles marmites à vapeur doit nécessairement les pousser à l’explosion. En porteront la première responsabilité non pas ceux qui lanceront maladroitement des cailloux, des cocktails Molotov ou des rockets, mais ceux dont l’insouciance aura préalablement contribué à exacerber ces inégalités et ces injustices.
Même si, chez ceux qui ont été poussés à bout, le geste de l’abrasion destructrice – le saccage – peut sans doute s’expliquer et s’excuser, il ne saurait pourtant se justifier. On ne gagne jamais rien (de bon) à vouloir tout remettre à plat. C’est toujours contre l’abrasion que doivent se définir les politiques de gauche. Des deux formes de maladresse évoquées ici, la première se caractérise en effet par une certaine insouciance (à la fois libératrice et potentiellement destructrice) : lorsque les opprimés se trouvent acculés au saccage dans l’insouciance de ses conséquences, ils ne font que renvoyer à leur oppresseur le mépris abrasif dont il les a couverts.
Les apôtres de la gaucherie, au contraire, sans doute parce qu’ils se trouvent dans une situation moins désespérée, s’efforcent de se soucier des conséquences de leurs gestes – et c’est bien cette souciance qui donne à ceux-ci leur caractère maladroit. En période de crise, leur objectif n’est pas de « tout remettre à plat », ni de jouir du bruit que ça fait lorsque ça s’effondre, mais de traduire les pulsions de saccages abrasifs en espoirs instituants et en frayage de brèches conviviales.
Pour des politiques de l’égalité qui ébrèchent sans abraser
Deux choses émergent au terme de ce parcours maladroit entre quatre livres virtuoses : une formule et un silence. La formule résume la façon dont une gaucherie conviviale pourrait concevoir ses interventions politiques : ébrécher les ornières sans les abraser.
Le silence touche à la question centrale de l’égalité, dont aucun de ces livres, justement occupés à réfléchir sur des politiques de la différence, ne fait une préoccupation majeure de son propos. Or la gauche aujourd’hui doit impérativement se rassembler autour d’une nouvelle pensée de l’égalité, ou, plus précisément, d’une nouvelle articulation entre une liberté qui favorise la différence et une égalité qui lui assure un terreau nourricier commun . Ce qui abrase et détruit les formes de vie, ce sont toujours des inégalités insoutenables. Les trente dernières années ont été marquées par l’exacerbation de ces inégalités (et même temps que par leur redistribution géopolitique), sur les multiples plans des revenus, des droits sociaux, des destructions environnementales. Cette exacerbation, qui abrase quotidiennement les perspectives existentielles de milliards d’êtres humains (ce qui suffit à la condamner d’un point de vue éthique), va inéluctablement, si elle se poursuit, détruire en retour les modes de vie des plus privilégiés eux-mêmes (ce qui en appelle à leur instinct de survie autant qu’à leur sens moral).
Le défi est donc aujourd’hui de savoir protéger à la fois les ornières et les brèches, à la fois les dénivellations qui donnent à notre vie sociale son relief en lui permettant de cultiver les différences, et une égalité fondamentale qui encapacite chacun à profiter de ce relief, à y circuler aussi librement que possible, pour s’y construire une niche à la fois habitable et singularisante. Ce qui nous menace aujourd’hui d’abrasion, ce ne sont pas les saccages esthétisés de GX Jupitter-Larsen : ce sont à la fois les murs que nos gouvernements construisent pour préserver des îlots d’inégalités insoutenables et les déferlantes dont la pression monte tout autour de ces fortifications rigidifiées. La chute de ces murs-là est (pour nous, « Européens de l’Ouest ») autant à craindre qu’à souhaiter.
Les politiques de gauche pourraient alors se concevoir comme une alternative à la fois au mur et à sa chute : ébrécher sans abraser. Cette formule ne débouche sur aucune solution miracle, ni aucune maîtrise surplombante. Si la faucille, trop coupante, mérite d’être mise au rancart, le marteau pourrait s’avérer utile – et emblématique : instrument de maladresse plutôt que de précision, il a tous les défauts et peu de vertus propres, sinon d’être moins destructeur que la dynamite ou le raz-de-marée.
Yves Citton
Yves Citton enseigne la littérature française du XVIIIe siècle à l’université de Grenoble au sein de l’umr LIRE (CNRS 5611). Membre du comité de rédaction de la revue Multitudes, il a récemment publié chez éditions Amsterdam Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? ainsi que L’Envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières. Il a co-édité, avec Frédéric Lordon, Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects et, avec Martial Poirson et Christian Biet, Les Frontières littéraires de l’économie.
Lectures : Michel Vanni, L’Adresse du politique. Essai d’approche responsive, Bernard Waldenfels, Topographie de l’étranger, Camille de Toledo, Le Hêtre et le Bouleau. Essai sur la tristesse européenne, suivi de L’Utopie linguistique ou pédagogie du vertige, GX Jupitter-Larsen, Saccages. Textes 1978-2009
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris