milleseptcentvingt
image : Maya Paules
Avant propos du groupe de traduction
Depuis quelque temps, s’est constitué un groupe qui travaille à produire des traductions françaises du travail de Sean Bonney (1969-2019), pour l’heure absent du paysage éditorial francophone.
À l’instar d’abandonedbuildings, le blog où Bonney a publié, en parallèle de ses livres, une large partie de ses écrits entre 2006 et 2019, milleseptcentvingt s’adonnera aux pratiques communistes éprouvées du plagiat, du collage et du refus canonique. Aussi ce projet se consacre-t-il moins au travail de Bonney, même s’il en reste indissociable, qu’il ne prolonge une certaine tradition poétique communiste au sein de laquelle Bonney s’inscrivait de toute son intransigeance. De nombreuses références revisitées par Bonney, contemporaines comme historiques, s’inscrivant dans cette même tradition, attendent encore d’être traduites en français ; elles pourront logiquement trouver leur place sur ce blog. De même, de nombreuses autres contributions à cette tradition restent encore à venir et on est en droit d’espérer que ce blog pourra contribuer à les forcer à se montrer “à la lumière crue du jour”. »
Certaines traductions ont été publiées en début d’année dans la revue Senna Hoy de Luc Benazet et Jacqueline Frost.
Lettre dans la tourmente
Sean Bonney
« Il n’est plus possible d’entretenir un rapport impartial au monde. » Je lis ça quelque part dans Ernst Bloch, je balance le livre contre le mur, je crie un bon moment avant de dévaler les six volées d’escaliers qui me séparent de la rue. On dirait que ça arrive plus ou moins tous les matins. Je fonce vers le canal et puis là-bas, je fixe les cygnes du regard, et je prononce certains mots, ceux d’un pouvoir flétri. Theresa May, par exemple, Stephen Crabb. Bien sûr, ces mots n’ont cours qu’au pays des morts, mais je les récite tout de même, leurs syllabes grincent ensemble comme les fantômes d’une machinerie médiévale, comme une parade de squelettes décapités ou la splendeur d’un train fantôme parfaitement préservé dans la saumure post-apocalyptique, la javel auditive dans laquelle on se baigne tous les jours. Le canal s’appelle le Landwehr et il est célèbre. Le 1e r juin 1919, on y a repêché le corps humilié de Rosa Luxemburg. Il était là depuis 6 mois. C’est à ça que je pense pendant que je regarde les cygnes. Je pense aussi au célèbre poème de Paul Celan qui évoque cet évènement, à la manière qu’il a de parler du silence du canal, ou du moins de la façon dont le canal est devenu silencieux, et je pense qu’il ne pourrait pas plus se tromper. Les inaudibles signaux radioactifs du canal ne s’arrêtent jamais de crisser, une impossible musique sur laquelle je ne parviens pas à m’arrêter de danser depuis des jours, chacune de ses notes étant la représentation d’un monde impossible, vacillant quelque part, juste en-dehors des frontières du spectre imaginaire connu, ces frontières impossibles, ces murs ridicules. On s’est écorché contre ces murs, à se réduire en miettes. Ou plutôt on a écrit là. Et ce qu’on écrit là ferait éclater tous les dictionnaires connus, si l’infecte lueur néolibérale du soi-disant soleil ne transformait pas tout ce qu’on avait inscrit, encore une fois, en ces mots du pouvoir décrit plus haut. May. Crabb. Crasse et ossements et gaz. Ouais tous les matins je m’assois là, près du canal, et quand la panique est passée je murmure tendrement aux cygnes, et puis je rentre chez moi et je rêve que je me suis fais ami avec eux et qu’ils ont fui bien au-delà de la frontière vers le pays des morts, et là-bas ils ont arraché la gorge de nos bourreaux et ils ont passé un baume apaisant sur les âmes de tous ceux qui continuent de vivre, mais prisonniers, en ce pays-là, et, bien sûr, par apaisant je veux dire corrosif et létal, et il est étrange que je ne me réveille pas en larmes. J’essaie d’arrêter cette merde. Dernièrement, j’ai étudié la magie, l’utopie et le maniement des armes. Je te tiendrai au courant de mes progrès.
La conversation ci-dessous entre Sean Bonney & Paal Bjelke Andersen s’ouvre sur une discussion à propos de Londres, plus particulièrement en lien avec les émeutes de 2011, puis questionne les effets que ce genre de soulèvement peut avoir sur l’expression poétique.
Tu serais un porc de ne pas répondre
PBA : Qu’est-ce que ta rue raconte de Londres ?
SB : Londres, ce ne sont pas les touristes ; ce n’est pas le métro ou les cabines téléphoniques rouges ou la Reine ou les riches. La moitié des maisons de ma rue n’ont pas de rideaux, on peut voir à travers les fenêtres et les gens n’ont rien. Nous sommes principalement des immigrés, on a pas de fric et la ville nous déteste. Le moment que j’ai préféré depuis que je vis ici, c’est quand des fachos ont voulu traverser notre quartier et qu’on les a bloqués en haut de ma rue. On leur a cassé la gueule, on les a fait cavaler. Pas le genre de truc qui sort dans les journaux, à la TV ou dans les dépliants touristiques. J’ai adoré tous les habitants de ma rue pour cette raison. Tous les six mois, les hindous font une grande marche. Ils passent sous ma fenêtre, je sors à chaque fois dans la rue pour les voir. La musique est incroyable, pour moi ça ressemble au dernier Coltrane — même si je sais que c’est Coltrane qui sonnait comme eux. Ça fait 5 ans environ que j’habite ici et maintenant, comme la plupart des gens, je vis dans la crainte. La gentrification a démarré, et démarré vite. Le pub de l’angle, qui était fréquenté par des vieux, des prolos, a été rénové. Maintenant il est rempli de familles de bourges avec leur gamins, ils mangent là le soir, en écoutant un truc qui se prétend du jazz, quelque chose qui crache à la gueule de Billie Holiday à chaque fois qu’on le joue. Billie Holiday a plus de valeur, même morte, que n’importe quel yuppie de cette ville. Quand je les vois, j’ai envie d’agir comme Rimbaud, c’est-à-dire que j’ai envie de gerber sur la vitrine du pub quand je les vois manger le soir, d’attendre devant la porte du pub et de les suivre chez eux, et me voilà, censément un genre d’écrivain. Mais on subit les attaques des puissances monétaires et conformistes. Je ne sais pas où aller. J’ai été autrefois amoureux de Londres. Plus maintenant. Il faut que je me casse de cette stupide ville raciste. Qu’on me donne un endroit où habiter. Voilà ce que dit ma rue. Elle me brise le cœur.
PBA : Comment tu te déplaces à travers Londres ?
SB : Prends à droite en haut de ma rue et parcourt un peu plus d’un kilomètre à pied, d’abord des maisons, puis des immeubles d’appartements, puis des ensembles industriels ; marche encore plus loin et tu arrives au réservoir. Puis après, les marais qui formaient la lisière de la ville, c’est sentimental et couvert de merde. L’autre direction, tu tournes à gauche en haut de ma rue, tu passes devant la mairie et les tribunaux, tu arrives à la forêt d’Epping, un des rares endroits en Angleterre où tu peux vraiment te perdre. J’ai pensé ce matin que ça serait marrant d’essayer de lancer la rumeur qu’il y aurait une sorte de monstre là-dedans — une sorte de truc hybride. Je n’y vais pas de toute façon. Je trouve les arbres chiants et Crass, le groupe hippie, vit dans une commune là-bas et j’ai trop peur de les croiser et d’avoir à dire « Salut, les Crass ». Il y a cependant un passage souterrain, en bordure de la forêt, où l’écho est super et un de mes moments préférés au cours de la dernière demie-décennie, c’était là-dedans, avec des potes, l’été il y a deux ans, à 4 h du mat’, à chanter des chansons de folk surnaturel et à sniffer du poppers. En-dehors de ça, je soutiens les grèves du métro. J’estime que les annonces automatiques dans les bus sont un complot contre la rêverie. Parfois je ressens toujours un frisson quand je suis sur le quai du métro, qu’il arrive à fond et comme un gosse je me dis, « putain de dieu, j’habite à Londres ».
PSA : Comment tu parles à Londres ?
SB : J’aimerais être un musicien. Je fredonne dans la cuisine des fois et ça sonne trop mal, et mes amis proches se foutent de ma gueule tout le temps. De plus en plus, on a pas besoin de parler à Londres. Ils ont des caisses automatiques dans les supermarchés et des machines à ticket dans le métro. Quand je finissais ma thèse, je n’ai parlé à personne pendant un mois, quasiment, sinon au buraliste. Ça ne me manquait pas, même je crois que je me suis conduit bizarrement quand je me suis remis à sortir. Je trouve qu’il est plus facile d’avoir une conversation quand je suis bourré. Je n’arrive à dire des trucs intelligents que quand ils sont écrits à l’avance. Ça me gêne et ce n’est pas tout à fait vrai.
PBA : Si je te pose ces questions, c’est parce que je suis en train de lire Happiness à la fois comme une réaction à un événement particulier dans un lieu particulier — les soulèvements de Londres en 2010 et 2011 — et à une situation générale et généralisée. Le livre se finit de deux façons différentes, ou peut-être d’une façon dialectique : « Comme le 24 novembre, on trainait autour de Charing Cross, juste appuyés contre les murs etc. quand 300 ados sont passés en courant devant nous, à défoncer le Strand, tous criant “QUELLES RUES — NOS RUES”. Et bien ça nous a bien fait marrer. Tu serais un porc de ne pas répondre. » et « la vie du conservatisme se déroule dans un silence qui reste bien plus intense que notre langage. ».
Tu pourrais parler un peu du contexte du livre et de son rapport aux soulèvements ?
SB : Le « silence plus intense que notre langage » est une paraphrase de Pasolini, je ne peux pas me souvenir exactement d’où c’est tiré. Il y a une quantité de citations qui ne sont pas attribuées dans tout le livre. J’ai essayé d’établir des rapports subliminaux entre ce qui à l’époque — entre 2010 et 2011 — apparaissait comme le début d’un soulèvement majeur, et certaines grappes d’énergie antagoniste dans l’histoire, ou plutôt certaines énergies plus ou moins bloquées à la porte de l’histoire. C’est un thème récurrent dans mon travail, et une façon de contourner le problème/le risque d’écrire sans le vouloir de la poésie « contestataire », plutôt que ces trucs plus directement antagonistes que j’espère parvenir à faire. Happiness parcourt un arc particulier, depuis la mise à sac du siège du parti conservateur le 10 novembre 2010 par les étudiants, en passant par la résurgence du mouvement ouvrier, l’apparition de UK Uncut, la réapparition du Black Bloc, pour finir juste avant les émeutes d’août 2011. La série des « Lettres » que j’ai écrites depuis, prolonge cet arc à travers l’effondrement du mouvement à la suite des émeutes (quel que soit l’évolution que ce mouvement avait pu connaitre), la montée de l’extrême-droite, et le renforcement du pouvoir des conservateurs. C’est bien plus sombre — mais aussi, espérons-le, bien plus marrant. Les poèmes sont résolument liés au soulèvement, c’est de ça dont ils parlent. Mais j’essaye aussi de les faire résonner à travers l’histoire de la gauche radicale, de l’anarchisme et aussi de la poésie radicale. J’ai qualifié ça de« poétique militante », pas pour faire une étiquette, mais pour distinguer ce que j’essaie de faire de la « poésie politique » d’une part et de la « poésie radicale » de l’autre. Parce qu’il est clair que tout ce qui est « politique » et « radical » peut aussi être envisagé comme renvoyant à un radicalisme purement formel. J’ai essayé de façonner une poétique qui puisse parler directement, mais sans sacrifier à sa complexité ou son radicalisme structurel. Peut-être que la dialectique entre le silence et le slogan politique — le « quelles rues/nos rues » — est là où se trouve réellement la poésie.
PBA : Tu écris sur ta peur. Si on est suffisamment acculé, la seule façon de s’en sortir est de rendre les coups, ou de faire le mort, comme on dit. Mais comme tu l’écris, le silence où « se déploie le conservatisme » est bien plus intense que « notre langage » et aussi notre rage. Est-ce que tu penses que tes poèmes rendent les coups, jouent le mort, ou…
SB : Un poème ne peut pas rendre les coups, évidemment. Mais des poèmes comme les miens — et aussi les poètes dont je me sens proche d’une façon ou d’une autre — ne font pas « le mort » en ce qu’ils cherchent à parler de la situation actuelle (et il y a un paquet de poètes « d’avant-garde » qui agissent comme par le passé, qui essaient de faire comme s’il ne se passait rien), de ce que ça fait à la subjectivité collective, de comment il est même possible de comprendre ce que peut vouloir dire « rendre les coups », et comment la langue de notre poésie peut contrer celle du conservatisme. Parce ce que jusqu’à présent, ça ne s’est pas présenté. J’ai été attaqué à plusieurs reprises pour la violence contenue dans mon travail récent, mais il n’y a rien là-dedans d’aussi dégueu que ce qu’on peut lire dans les journaux — en particulier le Daily Mail, mais les autres sont tout aussi mauvais — qui débordent de mensonges au sujet des migrants, des bénéficiaires d’aides sociales etc., des mensonges qui ruinent effectivement des vies. Si je pouvais écrire un poème qui soit en mesure de ruiner la vie de quelques députés conservateurs de la même façon que leurs publications (qui composent la poétique du capital dans l’urgence) détruisent les gens, alors je pourrais dire que ma poésie rend les coups. Je trouve vraiment bizarre qu’on se plaigne le plus souvent que la poésie militante n’ait aucune efficacité, et donc que ça ne sert à rien d’en écrire. J’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui aurait écrit un poème et qui se serait attendu à ce que le poème seul change quoi que ce soit. Ce qu’il y a d’intéressant, ce n’est pas de se demander si oui ou non la poésie peut contribuer au changement, mais plutôt ce que l’expérience de l’intensité politique et sociale fait à la poésie. Mon écriture a changé après avoir été à Millbank. Elle a d’autant plus changé après que je suis sorti dans la rue pendant les émeutes. Espérons qu’elle change de nouveau. Enfin, elle a intérêt.
PBA : Comment a-t-elle changé ?
SB : Tout d’abord, c’est la disposition par-rapport au travail qui a changé, plutôt que le travail lui-même. Je parlais à mon ami Jow Lindsay juste après que la révolte étudiante a touché à sa fin, et il m’a dit quelque chose qui se résume à : « toute notre poésie est devenue mille fois pire, ce qui signifie qu’elle est aussi devenue mille fois meilleure. » Le problème, dans le contexte de la tension sociale, n’était plus d’écrire un « bon poème » — quoi que ça signifie, de toute façon — mais d’écrire quelque chose qui parvienne, d’une façon ou d’une autre, à croiser la situation actuelle avec une certaine pertinence. Et je ne veux pas dire par là que j’ai soudainement ressenti la nécessité d’écrire dans un style socialiste réaliste — ce qui serait évidemment stupide, simplement ornemental — mais j’ai senti qu’il fallait que j’écrive quelque chose qui soit autant que possible en prise avec la situation, sans renoncer à sa complexité et son intensité poétiques. Ce qui est marrant, j’imagine, c’est que dès que je ne me suis plus préoccupé d’écrire un bon poème, j’ai fini par écrire les poèmes dont j’ai l’impression qu’ils sont les meilleurs que j’ai écrits.
Depuis, j’ai produit pas mal de réflexion et d’écrits sur la façon dont la poésie change dans le contexte de la lutte sociale. J’écris plus d’essais que de poèmes en ce moment, même si je m’intéresse à la façon qu’ont ces formes de se mélanger, les fissures et les frontières qui les séparent. Walter Benjamin suggère quelque chose de très intéressant dans son texte sur le surréalisme — pour le paraphraser, il dit que l’heure est venue d’écrire une histoire de la poésie ésotérique. C’était dans le contexte de l’Allemagne de 1929 — c’est-à-dire dans un moment de crise, de crise économique, les fantômes du nazisme s’approchant depuis le futur et, bien entendu, la défaite du communisme et du socialisme en Allemagne juste quelques années auparavant. C’est dans ce contexte d’urgence matérielle et sociale que Benjamin nous suggère d’étudier la poésie ésotérique comme façon de comprendre cette crise. Il poursuit en disant que cette poésie comporte un chargement secret, que ce chargement peut être découvert, en quelque sorte. J’ai écrit un texte qui est en partie une digression à partir de ça. J’ai cité la définition de l’image poétique par Aimé Césaire, la « fenêtre ouverte sur l’infini », et j’ai affirmé que si l’on renverse cette image, dans le contexte d’un soulèvement social, cet « infini » — la signification de cet infini — devient la fameuse formule dans le poème d’Amiri Baraka au sujet des rébellions de Newark en 1967 : « Les mots magiques sont : Contre le mur, enfoiré, c’est un braquage. » Le mot clé étant ici « magique » : un soulèvement social viendra laïciser le « secret » dissimulé dans la poésie ésotérique.
Césaire fait aussi ça, en quelque sort, si l’on songe à ses lectures de Lautréamont. Sa phrase au sujet de l’image comme fenêtre sur l’infini provient d’un essai de jeunesse sur Lautréamont, écrit dans les années 1940, mais une décennie plus tard, dans le Discours sur le colonialisme, sa lecture a changé, et pour lui Maldoror devient quasiment un travail d’analyse rationnelle du capital et du colonialisme.
PBA : Dans un texte qui vient de paraître dans Mute tu parles de L’éternité par les astres de Louis-Auguste Blanqui, le révolutionnaire français qui a passé le plus clair de sa vie en prison :
L’obscurité et la solitude de sa cellule sont exclues de l’univers qu’il imagine et, ainsi, l’imagination révolutionnaire en est aussi exclue, ce qui signifie que Blanqui, et les traditions radicales qu’il représente, doivent occuper un contre-univers, une anti-gravité, un magnétisme négatif dans lesquels la pensée bourgeoise ne peut entrer, qu’elle ne peut encercler ou occuper. La sentence du juge a a envahi toute la réalité, et l’imagination de Blanqui n’a d’autre choix que d’incarner l’anomalie de cette sentence, une poétique insurrectionnelle qui en vient à définir la loi du juge et, de ce fait, la rendre insignifiante et ridicule.
Plus tôt tu as dit . Ce qu’il y a d’intéressant, ce n’est pas de se demander si oui ou non la poésie peut contribuer au changement, mais plutôt ce que l’expérience de l’intensité politique et sociale fait à la poésie. Mais dans le texte que je cite et que j’ai lu comme une poétique, tu sembles aussi indiquer un effet de la poésie — au futur, du moins — sur l’expérience sociale/politique ?
SB : et bien, L’éternité par les astres, comme je le dis dans le texte, est un de ces ouvrages bizarres rédigés à la fin du xxe siècle. Comme Une Saison en enfer, Les Chants de Maldoror, et même les poèmes en prose de Baudelaire, ou l’idée du « livre » selon Mallarmé, et bien entendu l’Euréka de Poe, il est inclassable. C’est de la prose, mais elle fonctionne suivant des principes poétiques, si ça veut dire quelque chose. Le recueil des lettres sur lesquelles j’ai travaillé ces dernières années a subi l’influence — même si c’était d’abord inconsciemment — de ce genre de textes. Je ne sais pas si on peut les qualifier de poèmes, ni même de poèmes en prose. Bon, certains jours je me dis que oui. Puis, d’autres jours, je pense que ce sont évidemment des poèmes — et je m’en fous. Cela devient simplement de l’écriture (et aussi, incidemment, ils sont influencés, en ce qui concerne la méthode, par Les Chants de Maldoror, dans la mesure où, en particulier dans la première série, j’introduis des collages de citations sans les attribuer, etc.)
Pour Walter Benjamin, L’éternité par les astres constituait la déclaration finale de Blanqui, et une déclaration de résignation et de désespoir. Je ne le vois pas sous cet angle. Pour moi, c’est une vision immense du cosmos lui-même comme expression de la lutte de classes, où les comètes sont le prolétariat international en lutte avec les forces de la gravité. Bien entendu, c’est espiègle. Et bien entendu, cela dissout la conscience de classe en la renvoyant dans le cosmique, dans la spéculation visionnaire. Ça me fascine. On dirait un prolongement des idées de Benjamin sur la cargaison secrète de la poésie ésotérique. En ce moment, j’écris sur la poésie de Sun Ra, parallèlement au travail d’Amiri Baraka, où il semble se passer des choses comparables, ou du moins peut-on lire son réseau de métaphores sous cette angle. Et pas non plus de façon réductive. Je pense que ce que j’interroge vraiment ou que ce que j’évoque c’est ce qui arrive à ces énergies de la lutte, à ce qu’on pensait et qu’on ressentait dans un moment de révolte — et bon nombre d’entre nous, dans cet arc de lutte qui s’étend entre les rébellions étudiantes et les émeutes de l’été suivant ont senti qu’il se passait vraiment quelque chose, qu’on décollait à fond les manettes. Et même si je ne pensais pas qu’une révolution ou un truc du genre allait avoir lieu, je pensais réellement qu’on avait une possibilité de faire dégager le gouvernement conservateur. Ça n’est pas arrivé. On a perdu. Donc, qu’advient-t-il à ces énergies, ces émotions — et à notre poésie — dans le contexte de cette défaite ? On ne peut pas se replier en nous-mêmes et retourner au point où nous nous trouvions avant, revenir à la normale. Et si l’on ne veut pas simplement retomber dans le désespoir et la réconciliation, ça ouvre des questions sur le chemin que prend la poésie à partir de là. Comme une comète, elle disparaît. Et puis elle revient.
mail de contact du groupe de traduction : milleseptcentvingt@gmail.com


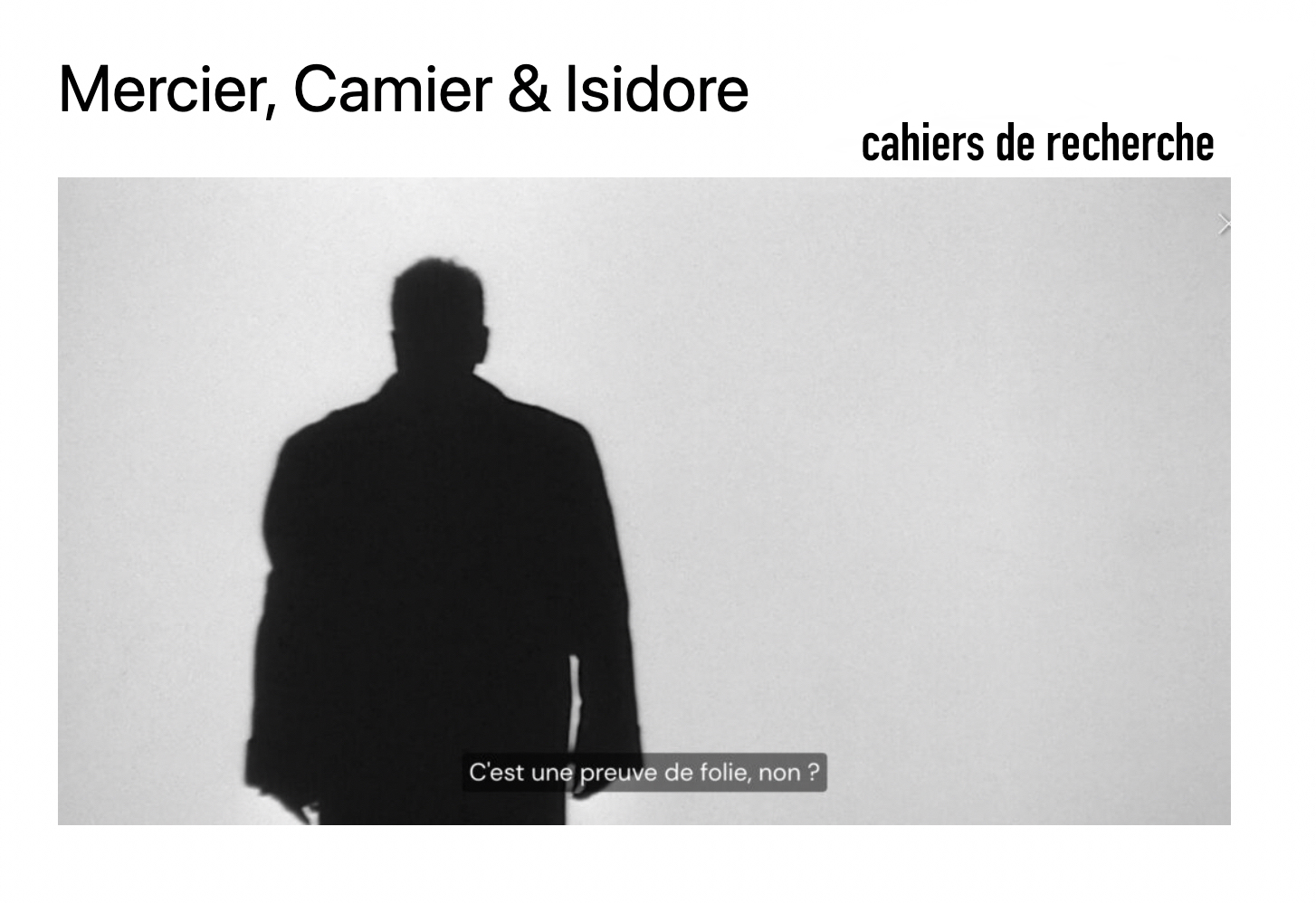



Lettre dans la tourmente et conversation. Sean Bonney.
milleseptcentvingt
image : Maya Paules
Avant propos du groupe de traduction
Depuis quelque temps, s’est constitué un groupe qui travaille à produire des traductions françaises du travail de Sean Bonney (1969-2019), pour l’heure absent du paysage éditorial francophone.
À l’instar d’abandonedbuildings, le blog où Bonney a publié, en parallèle de ses livres, une large partie de ses écrits entre 2006 et 2019, milleseptcentvingt s’adonnera aux pratiques communistes éprouvées du plagiat, du collage et du refus canonique. Aussi ce projet se consacre-t-il moins au travail de Bonney, même s’il en reste indissociable, qu’il ne prolonge une certaine tradition poétique communiste au sein de laquelle Bonney s’inscrivait de toute son intransigeance. De nombreuses références revisitées par Bonney, contemporaines comme historiques, s’inscrivant dans cette même tradition, attendent encore d’être traduites en français ; elles pourront logiquement trouver leur place sur ce blog. De même, de nombreuses autres contributions à cette tradition restent encore à venir et on est en droit d’espérer que ce blog pourra contribuer à les forcer à se montrer “à la lumière crue du jour”. »
Certaines traductions ont été publiées en début d’année dans la revue Senna Hoy de Luc Benazet et Jacqueline Frost.
Lettre dans la tourmente
Sean Bonney
« Il n’est plus possible d’entretenir un rapport impartial au monde. » Je lis ça quelque part dans Ernst Bloch, je balance le livre contre le mur, je crie un bon moment avant de dévaler les six volées d’escaliers qui me séparent de la rue. On dirait que ça arrive plus ou moins tous les matins. Je fonce vers le canal et puis là-bas, je fixe les cygnes du regard, et je prononce certains mots, ceux d’un pouvoir flétri. Theresa May, par exemple, Stephen Crabb. Bien sûr, ces mots n’ont cours qu’au pays des morts, mais je les récite tout de même, leurs syllabes grincent ensemble comme les fantômes d’une machinerie médiévale, comme une parade de squelettes décapités ou la splendeur d’un train fantôme parfaitement préservé dans la saumure post-apocalyptique, la javel auditive dans laquelle on se baigne tous les jours. Le canal s’appelle le Landwehr et il est célèbre. Le 1e r juin 1919, on y a repêché le corps humilié de Rosa Luxemburg. Il était là depuis 6 mois. C’est à ça que je pense pendant que je regarde les cygnes. Je pense aussi au célèbre poème de Paul Celan qui évoque cet évènement, à la manière qu’il a de parler du silence du canal, ou du moins de la façon dont le canal est devenu silencieux, et je pense qu’il ne pourrait pas plus se tromper. Les inaudibles signaux radioactifs du canal ne s’arrêtent jamais de crisser, une impossible musique sur laquelle je ne parviens pas à m’arrêter de danser depuis des jours, chacune de ses notes étant la représentation d’un monde impossible, vacillant quelque part, juste en-dehors des frontières du spectre imaginaire connu, ces frontières impossibles, ces murs ridicules. On s’est écorché contre ces murs, à se réduire en miettes. Ou plutôt on a écrit là. Et ce qu’on écrit là ferait éclater tous les dictionnaires connus, si l’infecte lueur néolibérale du soi-disant soleil ne transformait pas tout ce qu’on avait inscrit, encore une fois, en ces mots du pouvoir décrit plus haut. May. Crabb. Crasse et ossements et gaz. Ouais tous les matins je m’assois là, près du canal, et quand la panique est passée je murmure tendrement aux cygnes, et puis je rentre chez moi et je rêve que je me suis fais ami avec eux et qu’ils ont fui bien au-delà de la frontière vers le pays des morts, et là-bas ils ont arraché la gorge de nos bourreaux et ils ont passé un baume apaisant sur les âmes de tous ceux qui continuent de vivre, mais prisonniers, en ce pays-là, et, bien sûr, par apaisant je veux dire corrosif et létal, et il est étrange que je ne me réveille pas en larmes. J’essaie d’arrêter cette merde. Dernièrement, j’ai étudié la magie, l’utopie et le maniement des armes. Je te tiendrai au courant de mes progrès.
La conversation ci-dessous entre Sean Bonney & Paal Bjelke Andersen s’ouvre sur une discussion à propos de Londres, plus particulièrement en lien avec les émeutes de 2011, puis questionne les effets que ce genre de soulèvement peut avoir sur l’expression poétique.
Tu serais un porc de ne pas répondre
PBA : Qu’est-ce que ta rue raconte de Londres ?
SB : Londres, ce ne sont pas les touristes ; ce n’est pas le métro ou les cabines téléphoniques rouges ou la Reine ou les riches. La moitié des maisons de ma rue n’ont pas de rideaux, on peut voir à travers les fenêtres et les gens n’ont rien. Nous sommes principalement des immigrés, on a pas de fric et la ville nous déteste. Le moment que j’ai préféré depuis que je vis ici, c’est quand des fachos ont voulu traverser notre quartier et qu’on les a bloqués en haut de ma rue. On leur a cassé la gueule, on les a fait cavaler. Pas le genre de truc qui sort dans les journaux, à la TV ou dans les dépliants touristiques. J’ai adoré tous les habitants de ma rue pour cette raison. Tous les six mois, les hindous font une grande marche. Ils passent sous ma fenêtre, je sors à chaque fois dans la rue pour les voir. La musique est incroyable, pour moi ça ressemble au dernier Coltrane — même si je sais que c’est Coltrane qui sonnait comme eux. Ça fait 5 ans environ que j’habite ici et maintenant, comme la plupart des gens, je vis dans la crainte. La gentrification a démarré, et démarré vite. Le pub de l’angle, qui était fréquenté par des vieux, des prolos, a été rénové. Maintenant il est rempli de familles de bourges avec leur gamins, ils mangent là le soir, en écoutant un truc qui se prétend du jazz, quelque chose qui crache à la gueule de Billie Holiday à chaque fois qu’on le joue. Billie Holiday a plus de valeur, même morte, que n’importe quel yuppie de cette ville. Quand je les vois, j’ai envie d’agir comme Rimbaud, c’est-à-dire que j’ai envie de gerber sur la vitrine du pub quand je les vois manger le soir, d’attendre devant la porte du pub et de les suivre chez eux, et me voilà, censément un genre d’écrivain. Mais on subit les attaques des puissances monétaires et conformistes. Je ne sais pas où aller. J’ai été autrefois amoureux de Londres. Plus maintenant. Il faut que je me casse de cette stupide ville raciste. Qu’on me donne un endroit où habiter. Voilà ce que dit ma rue. Elle me brise le cœur.
PBA : Comment tu te déplaces à travers Londres ?
SB : Prends à droite en haut de ma rue et parcourt un peu plus d’un kilomètre à pied, d’abord des maisons, puis des immeubles d’appartements, puis des ensembles industriels ; marche encore plus loin et tu arrives au réservoir. Puis après, les marais qui formaient la lisière de la ville, c’est sentimental et couvert de merde. L’autre direction, tu tournes à gauche en haut de ma rue, tu passes devant la mairie et les tribunaux, tu arrives à la forêt d’Epping, un des rares endroits en Angleterre où tu peux vraiment te perdre. J’ai pensé ce matin que ça serait marrant d’essayer de lancer la rumeur qu’il y aurait une sorte de monstre là-dedans — une sorte de truc hybride. Je n’y vais pas de toute façon. Je trouve les arbres chiants et Crass, le groupe hippie, vit dans une commune là-bas et j’ai trop peur de les croiser et d’avoir à dire « Salut, les Crass ». Il y a cependant un passage souterrain, en bordure de la forêt, où l’écho est super et un de mes moments préférés au cours de la dernière demie-décennie, c’était là-dedans, avec des potes, l’été il y a deux ans, à 4 h du mat’, à chanter des chansons de folk surnaturel et à sniffer du poppers. En-dehors de ça, je soutiens les grèves du métro. J’estime que les annonces automatiques dans les bus sont un complot contre la rêverie. Parfois je ressens toujours un frisson quand je suis sur le quai du métro, qu’il arrive à fond et comme un gosse je me dis, « putain de dieu, j’habite à Londres ».
PSA : Comment tu parles à Londres ?
SB : J’aimerais être un musicien. Je fredonne dans la cuisine des fois et ça sonne trop mal, et mes amis proches se foutent de ma gueule tout le temps. De plus en plus, on a pas besoin de parler à Londres. Ils ont des caisses automatiques dans les supermarchés et des machines à ticket dans le métro. Quand je finissais ma thèse, je n’ai parlé à personne pendant un mois, quasiment, sinon au buraliste. Ça ne me manquait pas, même je crois que je me suis conduit bizarrement quand je me suis remis à sortir. Je trouve qu’il est plus facile d’avoir une conversation quand je suis bourré. Je n’arrive à dire des trucs intelligents que quand ils sont écrits à l’avance. Ça me gêne et ce n’est pas tout à fait vrai.
PBA : Si je te pose ces questions, c’est parce que je suis en train de lire Happiness à la fois comme une réaction à un événement particulier dans un lieu particulier — les soulèvements de Londres en 2010 et 2011 — et à une situation générale et généralisée. Le livre se finit de deux façons différentes, ou peut-être d’une façon dialectique : « Comme le 24 novembre, on trainait autour de Charing Cross, juste appuyés contre les murs etc. quand 300 ados sont passés en courant devant nous, à défoncer le Strand, tous criant “QUELLES RUES — NOS RUES”. Et bien ça nous a bien fait marrer. Tu serais un porc de ne pas répondre. » et « la vie du conservatisme se déroule dans un silence qui reste bien plus intense que notre langage. ».
Tu pourrais parler un peu du contexte du livre et de son rapport aux soulèvements ?
SB : Le « silence plus intense que notre langage » est une paraphrase de Pasolini, je ne peux pas me souvenir exactement d’où c’est tiré. Il y a une quantité de citations qui ne sont pas attribuées dans tout le livre. J’ai essayé d’établir des rapports subliminaux entre ce qui à l’époque — entre 2010 et 2011 — apparaissait comme le début d’un soulèvement majeur, et certaines grappes d’énergie antagoniste dans l’histoire, ou plutôt certaines énergies plus ou moins bloquées à la porte de l’histoire. C’est un thème récurrent dans mon travail, et une façon de contourner le problème/le risque d’écrire sans le vouloir de la poésie « contestataire », plutôt que ces trucs plus directement antagonistes que j’espère parvenir à faire. Happiness parcourt un arc particulier, depuis la mise à sac du siège du parti conservateur le 10 novembre 2010 par les étudiants, en passant par la résurgence du mouvement ouvrier, l’apparition de UK Uncut, la réapparition du Black Bloc, pour finir juste avant les émeutes d’août 2011. La série des « Lettres » que j’ai écrites depuis, prolonge cet arc à travers l’effondrement du mouvement à la suite des émeutes (quel que soit l’évolution que ce mouvement avait pu connaitre), la montée de l’extrême-droite, et le renforcement du pouvoir des conservateurs. C’est bien plus sombre — mais aussi, espérons-le, bien plus marrant. Les poèmes sont résolument liés au soulèvement, c’est de ça dont ils parlent. Mais j’essaye aussi de les faire résonner à travers l’histoire de la gauche radicale, de l’anarchisme et aussi de la poésie radicale. J’ai qualifié ça de« poétique militante », pas pour faire une étiquette, mais pour distinguer ce que j’essaie de faire de la « poésie politique » d’une part et de la « poésie radicale » de l’autre. Parce qu’il est clair que tout ce qui est « politique » et « radical » peut aussi être envisagé comme renvoyant à un radicalisme purement formel. J’ai essayé de façonner une poétique qui puisse parler directement, mais sans sacrifier à sa complexité ou son radicalisme structurel. Peut-être que la dialectique entre le silence et le slogan politique — le « quelles rues/nos rues » — est là où se trouve réellement la poésie.
PBA : Tu écris sur ta peur. Si on est suffisamment acculé, la seule façon de s’en sortir est de rendre les coups, ou de faire le mort, comme on dit. Mais comme tu l’écris, le silence où « se déploie le conservatisme » est bien plus intense que « notre langage » et aussi notre rage. Est-ce que tu penses que tes poèmes rendent les coups, jouent le mort, ou…
SB : Un poème ne peut pas rendre les coups, évidemment. Mais des poèmes comme les miens — et aussi les poètes dont je me sens proche d’une façon ou d’une autre — ne font pas « le mort » en ce qu’ils cherchent à parler de la situation actuelle (et il y a un paquet de poètes « d’avant-garde » qui agissent comme par le passé, qui essaient de faire comme s’il ne se passait rien), de ce que ça fait à la subjectivité collective, de comment il est même possible de comprendre ce que peut vouloir dire « rendre les coups », et comment la langue de notre poésie peut contrer celle du conservatisme. Parce ce que jusqu’à présent, ça ne s’est pas présenté. J’ai été attaqué à plusieurs reprises pour la violence contenue dans mon travail récent, mais il n’y a rien là-dedans d’aussi dégueu que ce qu’on peut lire dans les journaux — en particulier le Daily Mail, mais les autres sont tout aussi mauvais — qui débordent de mensonges au sujet des migrants, des bénéficiaires d’aides sociales etc., des mensonges qui ruinent effectivement des vies. Si je pouvais écrire un poème qui soit en mesure de ruiner la vie de quelques députés conservateurs de la même façon que leurs publications (qui composent la poétique du capital dans l’urgence) détruisent les gens, alors je pourrais dire que ma poésie rend les coups. Je trouve vraiment bizarre qu’on se plaigne le plus souvent que la poésie militante n’ait aucune efficacité, et donc que ça ne sert à rien d’en écrire. J’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui aurait écrit un poème et qui se serait attendu à ce que le poème seul change quoi que ce soit. Ce qu’il y a d’intéressant, ce n’est pas de se demander si oui ou non la poésie peut contribuer au changement, mais plutôt ce que l’expérience de l’intensité politique et sociale fait à la poésie. Mon écriture a changé après avoir été à Millbank. Elle a d’autant plus changé après que je suis sorti dans la rue pendant les émeutes. Espérons qu’elle change de nouveau. Enfin, elle a intérêt.
PBA : Comment a-t-elle changé ?
SB : Tout d’abord, c’est la disposition par-rapport au travail qui a changé, plutôt que le travail lui-même. Je parlais à mon ami Jow Lindsay juste après que la révolte étudiante a touché à sa fin, et il m’a dit quelque chose qui se résume à : « toute notre poésie est devenue mille fois pire, ce qui signifie qu’elle est aussi devenue mille fois meilleure. » Le problème, dans le contexte de la tension sociale, n’était plus d’écrire un « bon poème » — quoi que ça signifie, de toute façon — mais d’écrire quelque chose qui parvienne, d’une façon ou d’une autre, à croiser la situation actuelle avec une certaine pertinence. Et je ne veux pas dire par là que j’ai soudainement ressenti la nécessité d’écrire dans un style socialiste réaliste — ce qui serait évidemment stupide, simplement ornemental — mais j’ai senti qu’il fallait que j’écrive quelque chose qui soit autant que possible en prise avec la situation, sans renoncer à sa complexité et son intensité poétiques. Ce qui est marrant, j’imagine, c’est que dès que je ne me suis plus préoccupé d’écrire un bon poème, j’ai fini par écrire les poèmes dont j’ai l’impression qu’ils sont les meilleurs que j’ai écrits.
Depuis, j’ai produit pas mal de réflexion et d’écrits sur la façon dont la poésie change dans le contexte de la lutte sociale. J’écris plus d’essais que de poèmes en ce moment, même si je m’intéresse à la façon qu’ont ces formes de se mélanger, les fissures et les frontières qui les séparent. Walter Benjamin suggère quelque chose de très intéressant dans son texte sur le surréalisme — pour le paraphraser, il dit que l’heure est venue d’écrire une histoire de la poésie ésotérique. C’était dans le contexte de l’Allemagne de 1929 — c’est-à-dire dans un moment de crise, de crise économique, les fantômes du nazisme s’approchant depuis le futur et, bien entendu, la défaite du communisme et du socialisme en Allemagne juste quelques années auparavant. C’est dans ce contexte d’urgence matérielle et sociale que Benjamin nous suggère d’étudier la poésie ésotérique comme façon de comprendre cette crise. Il poursuit en disant que cette poésie comporte un chargement secret, que ce chargement peut être découvert, en quelque sorte. J’ai écrit un texte qui est en partie une digression à partir de ça. J’ai cité la définition de l’image poétique par Aimé Césaire, la « fenêtre ouverte sur l’infini », et j’ai affirmé que si l’on renverse cette image, dans le contexte d’un soulèvement social, cet « infini » — la signification de cet infini — devient la fameuse formule dans le poème d’Amiri Baraka au sujet des rébellions de Newark en 1967 : « Les mots magiques sont : Contre le mur, enfoiré, c’est un braquage. » Le mot clé étant ici « magique » : un soulèvement social viendra laïciser le « secret » dissimulé dans la poésie ésotérique.
Césaire fait aussi ça, en quelque sort, si l’on songe à ses lectures de Lautréamont. Sa phrase au sujet de l’image comme fenêtre sur l’infini provient d’un essai de jeunesse sur Lautréamont, écrit dans les années 1940, mais une décennie plus tard, dans le Discours sur le colonialisme, sa lecture a changé, et pour lui Maldoror devient quasiment un travail d’analyse rationnelle du capital et du colonialisme.
PBA : Dans un texte qui vient de paraître dans Mute tu parles de L’éternité par les astres de Louis-Auguste Blanqui, le révolutionnaire français qui a passé le plus clair de sa vie en prison :
L’obscurité et la solitude de sa cellule sont exclues de l’univers qu’il imagine et, ainsi, l’imagination révolutionnaire en est aussi exclue, ce qui signifie que Blanqui, et les traditions radicales qu’il représente, doivent occuper un contre-univers, une anti-gravité, un magnétisme négatif dans lesquels la pensée bourgeoise ne peut entrer, qu’elle ne peut encercler ou occuper. La sentence du juge a a envahi toute la réalité, et l’imagination de Blanqui n’a d’autre choix que d’incarner l’anomalie de cette sentence, une poétique insurrectionnelle qui en vient à définir la loi du juge et, de ce fait, la rendre insignifiante et ridicule.
Plus tôt tu as dit . Ce qu’il y a d’intéressant, ce n’est pas de se demander si oui ou non la poésie peut contribuer au changement, mais plutôt ce que l’expérience de l’intensité politique et sociale fait à la poésie. Mais dans le texte que je cite et que j’ai lu comme une poétique, tu sembles aussi indiquer un effet de la poésie — au futur, du moins — sur l’expérience sociale/politique ?
SB : et bien, L’éternité par les astres, comme je le dis dans le texte, est un de ces ouvrages bizarres rédigés à la fin du xxe siècle. Comme Une Saison en enfer, Les Chants de Maldoror, et même les poèmes en prose de Baudelaire, ou l’idée du « livre » selon Mallarmé, et bien entendu l’Euréka de Poe, il est inclassable. C’est de la prose, mais elle fonctionne suivant des principes poétiques, si ça veut dire quelque chose. Le recueil des lettres sur lesquelles j’ai travaillé ces dernières années a subi l’influence — même si c’était d’abord inconsciemment — de ce genre de textes. Je ne sais pas si on peut les qualifier de poèmes, ni même de poèmes en prose. Bon, certains jours je me dis que oui. Puis, d’autres jours, je pense que ce sont évidemment des poèmes — et je m’en fous. Cela devient simplement de l’écriture (et aussi, incidemment, ils sont influencés, en ce qui concerne la méthode, par Les Chants de Maldoror, dans la mesure où, en particulier dans la première série, j’introduis des collages de citations sans les attribuer, etc.)
Pour Walter Benjamin, L’éternité par les astres constituait la déclaration finale de Blanqui, et une déclaration de résignation et de désespoir. Je ne le vois pas sous cet angle. Pour moi, c’est une vision immense du cosmos lui-même comme expression de la lutte de classes, où les comètes sont le prolétariat international en lutte avec les forces de la gravité. Bien entendu, c’est espiègle. Et bien entendu, cela dissout la conscience de classe en la renvoyant dans le cosmique, dans la spéculation visionnaire. Ça me fascine. On dirait un prolongement des idées de Benjamin sur la cargaison secrète de la poésie ésotérique. En ce moment, j’écris sur la poésie de Sun Ra, parallèlement au travail d’Amiri Baraka, où il semble se passer des choses comparables, ou du moins peut-on lire son réseau de métaphores sous cette angle. Et pas non plus de façon réductive. Je pense que ce que j’interroge vraiment ou que ce que j’évoque c’est ce qui arrive à ces énergies de la lutte, à ce qu’on pensait et qu’on ressentait dans un moment de révolte — et bon nombre d’entre nous, dans cet arc de lutte qui s’étend entre les rébellions étudiantes et les émeutes de l’été suivant ont senti qu’il se passait vraiment quelque chose, qu’on décollait à fond les manettes. Et même si je ne pensais pas qu’une révolution ou un truc du genre allait avoir lieu, je pensais réellement qu’on avait une possibilité de faire dégager le gouvernement conservateur. Ça n’est pas arrivé. On a perdu. Donc, qu’advient-t-il à ces énergies, ces émotions — et à notre poésie — dans le contexte de cette défaite ? On ne peut pas se replier en nous-mêmes et retourner au point où nous nous trouvions avant, revenir à la normale. Et si l’on ne veut pas simplement retomber dans le désespoir et la réconciliation, ça ouvre des questions sur le chemin que prend la poésie à partir de là. Comme une comète, elle disparaît. Et puis elle revient.
mail de contact du groupe de traduction : milleseptcentvingt@gmail.com
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris