Colloque du Collège International de Philosophie qui s’est tenu les 6,7 & 8 avril 2017 à la Parole Errante et au Théâtre L’échangeur.
Organisateurs : Bernard Aspe (Ciph), Patrizia Atzei (Université Paris VIII, éditions NOUS), Camille Louis (collectif kom.post, Université Paris VIII), Frédéric Neyrat (Université de Wisconsin-Madison).
En collaboration avec le département de littérature comparée de l’université de Wisconsin-Madison. Cette rencontre est pensée comme une première étape pour une seconde session à Madison (Wisconsin) l’année suivante.
Le titre choisi pour le colloque donne une indication sur ce qui y est supposé. Disons que l’on fait ici un nœud de trois suppositions : premièrement, la politique se laisse aborder sous l’angle du conflit spécifique qu’elle met en œuvre. Deuxièmement, il y a une logique de ce conflit, ce qui veut dire plus précisément qu’il y en a une intelligibilité, entendons par là une saisie conceptuelle et discursive. Troisièmement, cette intelligibilité, comme dirait Lacan, est « pas-toute » ; le concept de « pratiques » peut alors être mobilisé pour indiquer les éléments (les gestes, les postures, les dispositions) qui se transmettent par d’autres voies que celle du discours ou de la saisie conceptuelle.
Logiques et pratiques ainsi entendues sont au pluriel : nous verrons qu’il s’agit aussi d’identifier une diversité de logiques, et une diversité de pratiques qui les accompagne. Mais il faut voir dès le départ que l’entrelacs des logiques et des pratiques doit être conçu à distance d’une énième variation du « rapport entre la théorie et la pratique ». L’entremêlement des logiques et des pratiques suit des voies beaucoup moins linéaires, et fécondes pour cette raison même. Entre les logiques et les pratiques de la politique, il y a des reprises et des relances dans les deux sens, mais aussi des tensions et des écarts.
Prenons donc pour axiome de départ que là où il y a politique, il y a du désaccord, de la dissension, bref ce qui peut donner lieu à un conflit. La question est alors d’identifier la forme de ce conflit et son objet. Quel est au juste l’objet du conflit politique ? Jacques Rancière propose de considérer que cet objet n’est autre que la politique elle-même, c’est-à-dire ce qui définit son existence propre : il y a politique là où a lieu un conflit sur la manière même d’entendre ce que signifie « politique ». Mais cette entente même n’est l’enjeu de la politique que dans la mesure où elle présuppose une certaine manière de concevoir et de pratiquer le conflit politique. En d’autres termes, la politique est d’abord un conflit sur l’identification de ce qui constitue un conflit politique. Ou encore : l’objet de la politique, c’est tout d’abord l’alternative entre les formes que peut ou que doit prendre la conflictualité politique. Nous dirons alors : la politique a pour objet la forme que l’on peut donner à la conflictualité politique elle-même.
Nous choisissons d’organiser ce colloque à la veille des élections présidentielles, à l’heure où est supposée une certaine entente de la politique (celle qui voit dans les élections la manifestation centrale de la pratique démocratique), et une certaine entente de la forme que prend le conflit politique (à travers la polarisation gauche-droite et la logique d’alternance). Il s’agirait, pour commencer, de mettre en question cette supposition.
Mais bien au-delà de la critique du modèle parlementaire de la politique, il s’agit surtout d’essayer de comprendre ce qui s’impose à nous : des guerres « asymétriques » à la « crise » écologique, des développements du capitalisme aux luttes locales qui cherchent à les contrer. Tout cela configure une situation nouvelle, qui oblige à reprendre la notion même de politique, et par là même à vérifier que cette notion, loin de renvoyer à une essence transhistorique, ne peut être conçue qu’au présent.
Retour sur les pratiques de lutte apparues lors du mouvement de 2016 en France
Invités : Collectif de traduction de l’Orda d’oro / Collectif « Mauvaise troupe » / La Défense collective de Rennes.
La soirée du 6 avril à la Parole errante met en présence des personnes dont on pourrait dire qu’elles ont à la fois des approches différentes et un héritage commun. Le but est donc bien de faire apparaître et cet héritage, et ces différences.
La visée du colloque dans son ensemble est de travailler à rendre plus poreuses les frontières entre le travail d’analyse critique et le travail d’intervention au sein des luttes. Les intervenants de la première soirée sont sans doute tous d’accord sur ce point : ils ne croient pas qu’une véritable intellectualité critique puisse exister sans être d’une manière ou d’une autre en prise avec l’expérience des luttes actuelles. Mais il s’agirait de savoir de quelle manière concevoir le travail de cette intellectualité critique immanente aux luttes.
Pour cela, on peut revenir sur la manière dont l’inscription du savoir critique dans les luttes était mise en œuvre dans ce qui demeure comme le dernier grand moment du mouvement révolutionnaire européen, celui du « long mai » italien, qui est au cœur du livre la Horde d’or. Mais il faut voir aussi quelle portée, quels effets peuvent avoir les textes d’intervention, comme l’est exemplairement Défendre la ZAD, écrit par le collectif Mauvaise troupe, dans les luttes actuelles. Un tout autre versant de l’intellectualité critique est celui de l’appropriation des domaines de savoir censés être réservés à des spécialistes – par exemple, le droit. Lorsqu’il y a conflit, il y a répression, et lorsqu’il y a répression, il y a des inculpés, il y a des procès, il y a des condamnations. Les membres de la Défense collective de Rennes pourront nous éclairer sur l’importance d’une connaissance et d’un usage politique des droits, notamment après les nombreuses condamnations et mises en accusation qui ont eu lieu lors du mouvement contre la loi « travail », et qui se poursuivent aujourd’hui pour celles et ceux qui participent au mouvement contre les violences policières.
Cette démarche nous conduit vers un autre héritage commun. Dans l’Italie des années 1970, le « mouvement théoricien » de l’autonomie organisée portait cette idée apparemment toute simple, mais déterminante : on ne peut pas « être contre » sans « être dans ». On ne peut pas être contre le « système » sans s’appuyer sur ses dispositifs. Un de ces dispositifs est le droit : même si ce dernier sert essentiellement à maintenir un certain ordre des choses, il peut être retourné contre cet ordre – la question, là aussi, est de savoir comment. Un autre de ces dispositifs concerne le revenu : les mouvements des années 1970 en Italie, en tout cas une partie de ceux-ci, ont mis au centre des revendications le « salaire garanti », comme une manière de retourner contre es patrons ce qui était leur principal instrument de contrôle. Enfin, pour occuper une ZAD, il faut bien construire un espace à l’intérieur de l’espace du pouvoir, justement pour contester au pouvoir sa prétention de s’approprier l’intégralité de l’espace – ce qu’il appelle « aménagement du territoire ».
Mais c’est peut-être aussi sur ce point que les différences pourraient apparaître : jusqu’à quel point peut-on créer ainsi un véritable « dehors », une zone d’autonomie collective, tout en restant à l’intérieur du « système » pour pouvoir le combattre ? Ou à l’inverse : jusqu’à quel point faut-il s’appuyer sur les dispositifs de ce système, jusqu’à quel point faut-il parler la langue du pouvoir, pour pouvoir retourner contre lui ses propres instruments ?
Ce qui est sûr en tout cas, c’est que, au centre de ces enjeux, il y a la question du lieu politique – celui qu’il s’agit de tenir, et celui qu’il s’agit d’occuper. Il s’agit d’occuper les lieux censés être voués à la circulation mondialisée pour en faire des zones d’expérimentation d’une autonomie collective. Mais il s’agit aussi de créer une zone d’autonomie collective à l’intérieur des dispositifs judiciaires lorsque la défense se veut, justement, collective – c’est-à-dire d’emblée en rupture avec ce que semblent être les présupposés même du droit « bourgeois » (c’est, disons, l’autre forme de « garantisme », indissociable du garantisme juridique). Dans l’Italie des années 1970, il s’agissait bien aussi de créer des lieux de l’autonomie – en rapport avec les problématiques de l’éducation, de la psychothérapie, du logement, etc. Et de les créer au moment où l’usine commençait à se diffuser à l’ensemble de la société – c’est à cette époque que l’on a commencé à parler de la « société-usine ».
L’héritage commun et les différences pourront donc s’éclairer à partir de l’articulation entre les lieux qui sont à occuper et ceux qui sont à construire.
Le modèle de la guerre
Lorsque la question du conflit est posée, il semble qu’un paradigme vient aussitôt hanter la discussion : celui de la guerre. C’est bien ce que nous pouvons observer aujourd’hui, alors que planent la menace des attentats autant que celle de la réponse par « l’état d’urgence » : on nous somme de prendre parti dans ce qui nous est présenté comme une guerre des civilisations. Il n’est pas sûr que nous devions répondre à cette sommation. Il nous faut plutôt examiner la situation : de quelle guerre s’agit-il au juste ? Cette guerre dont on nous parle n’en recouvre-t-elle pas une autre ? Une guerre des classes, comme le pensait Marx ? Dit autrement : n’est-elle pas, cette guerre des civilisations, ce qui vient se substituer à une autre pratique du conflit, celle qui a longtemps porté le nom de « politique » ? Quelle est alors, dans sa spécificité, la forme que peut prendre le conflit politique en tant qu’il se distingue du conflit proprement guerrier ? N’en est-il pas, justement, l’interruption ? Mais la politique ainsi entendue existe-t-elle vraiment, et durablement, aujourd’hui ? La guerre en cours, telle que nous la présente les médias et les hommes de pouvoir, n’est-elle pas tout d’abord ce qui repose sur l’absentement de la politique ? Et si tel est le cas, comment répondre à cet absentement ? L’exigence de la politique suffit-elle à la faire exister ?
Bernard Aspe (Ciph), « La pensée du conflit ».
Je comprends l’enjeu de ce colloque comme une tentative pour cerner la pensée du conflit politique, entendue non comme ce qui prend pour objet le conflit, mais comme la pensée qui est en jeu dans le conflit. Non sur le mode d’une théorie préalable qui y serait « appliquée », mais sur celui d’une pensée « en immanence », interne aux gestes de la révolte, en acte dans ses gestes. Pour cette première matinée, il sera essentiellement question du rapport entre la politique et la guerre. Je proposerai une utilisation très restreinte du paradigme de la guerre pour éclairer la pensée de/dans la conflictualité politique, en convoquant seulement trois aspects traditionnellement associés à la guerre : la figure de l’ennemi ; la question de la stratégie ; et celle de l’objectif.
Catherine Hass (CNRS, Institut d’Histoire du Temps Présent), « Nom de guerre : contre-enquête ».
Dans une période, la nôtre, marquée par la déshérence et la dés-historicisation du nom même de guerre, je chercherai à montrer comment il est possible de le maintenir et d’en avoir une intelligence renouvelée dès lors la politique devient son opérateur exclusif d’intellection. Cette opération est sous condition de l’enquête, une enquête spécifique puisqu’elle se concentre sur la politique dans la guerre. La guerre devient alors pensable, pour elle-même, à partir de la politique.
Loin d’être identifiable à un invariant ou à une diversité typologique, la guerre est ici affaire de configurations politiques et subjectives, enquêter sur le nom signifiant enquêter sur les politiques à l’œuvre dans la guerre, dans leur historicité propre et pour des séquences données. Selon cette approche, la guerre se déploie à l’aune d’un type de savoir inédit, sa connaissance et sa rationalité étant disposées par la seule politique. Cette investigation est rendue possible par le statut particulier qu’y occupe la politique puisque, faisant fond sur la conception qu’en donne Sylvain Lazarus dans l’Anthropologie du nom, je la qualifie de pensée singulière, subjective et séquentielle, pensable à partir d’elle-même soit, sans convocation de référents objectivistes ou positivistes ou l’appui d’autres disciplines.
Si l’on admet que la politique ne pense pas la guerre selon les mêmes termes, catégories et prescriptions, en Prusse au début du XIXe, en Chine en 1932, en Allemagne en 1941, aux États-Unis en 2001 ou dans l’État islamique en 2015, l’enquête sur la politique, ses catégories et termes s’impose. C’est à ce prix que le nom de guerre peut être maintenu et la guerre devenir pensable, à mesure des intellectualités politiques qui peuvent, ou ont pu, l’identifier et le prescrire. La guerre s’appréhende dès lors à partir de ce que je nomme des modes politiques de guerre.
Oliver Feltham (American University of Paris), « L’action politique et ses contextes disjoints ».
Le point de départ de ma communication est le constat, à l’époque actuelle, d’une indistinction entre le conflit politique et le conflit militaire. Une telle indistinction estompe les différences entre la sphère politique et la sphère militaire à la fois au niveau des fins, des moyens employés et au niveau de la forme même de l’action. Afin de rétablir une distinction entre les formes de l’action militaires et celles d’ordre politique, je vais tenter de reconstruire l’investigation épistémologique de l’action chez Locke en termes ontologiques. L’objectif est de développer une conception ontologique de la faction (le terme anciennement utilisé pour indiquer un conflit irrémédiable) à la lumière des zones de réception des actions politiques : ces milieux, nous allons les appeler des contextes disjoints. C’est à partir du rapport entre les actions et leurs contextes disjoints que l’on va trouver une manière de nuancer l’indistinction existante entre la politique et la guerre.
Sophie Wahnich (CNRS), « Révolution, guerre civile, lutte entre deux classes pendant la Révolution française ».
Cette communication reviendra sur le passage conceptuel pendant la période révolutionnaire de la « révolution » à la « guerre civile » et de la « guerre civile » à « la lutte entre deux classes ». C’est un travail qui met l’accent sur les rapports de Saint-Just quand il explique ce qui fait obstacle concret à la transformation révolutionnaire car la politique n’ a pas changé de régime de confiance, que l’on reste dans des logiques de cour avec méfiance et chausse trappe et non dans un régime d’intérêts partagés voire de bien commun qui suppose la confiance et la circulation des hommes et des idées dans un esprit de justice politique et sociale. Le rapport au présent sera instruit dans cette perspective de laboratoire historique.
Discussion avec la salle
La politique de l’économie ou la politique contre l’économie ?
Si la politique se distingue de la guerre, elle doit donc être pensable dans son ordre propre. Mais à partir de quoi saisir ce « propre » de la politique ? Faut-il considérer qu’il faut la concevoir à distance de tout ce avec quoi on avait pu la confondre : l’histoire, le droit, l’économie ? Insistons particulièrement sur cette dernière : quel rapport l’intelligibilité propre de la politique entretient-elle avec l’analyse de l’économie ? Doit-on envisager ici une disjonction radicale, et considérer par exemple que les modes de la subjectivation politique ne sont jamais les effets d’une situation objective – ce pour quoi ils ont précisément une logique propre ? De ce point de vue, « l’économie » peut être perçue comme un faux-semblant qui ne serait en définitive qu’un instrument tout entier aux mains de ceux qui cherchent à en imposer les prétendues « lois ».
Il n’en reste pas moins qu’il faut bien saisir de quelle manière les subjectivations peuvent s’inscrire dans l’état réel du monde. Si l’on s’accorde à suivre l’indication de Marx et à nommer « capitalisme » le complexe de puissances qui configure l’état du monde (mais cela même peut être un point de discussion), il faut bien disposer aussi d’une analyse de ce qui se présente non pas comme l’objet des « sciences » économiques, mais comme le réel d’une économie-monde. Dès lors comment articuler aujourd’hui l’analyse de l’économie-monde et celle de la politique ? Quelle place prend dans cette articulation l’analyse des formes contemporaines du travail ? Quelle place y est laissée au motif supposé ancien de la « lutte des classes » ? Et surtout : un point est-il identifiable, depuis lequel l’économie-monde pourrait être combattue en tant que telle ?
En définitive, il s’agit ici de savoir si, et de quelle manière, on peut accorder une approche de la politique « en intériorité », selon sa logique et ses exigences propres, et une analyse des processus globaux qui configurent l’espace d’une économie-monde.
Jodi Dean (Hobart and William Smith College, New York), « Communicative capitalism and the subject of politics » / « Le capitalisme communicationnel et le sujet de la politique ».
La recomposition du capital autour des technologies de la communication en réseau a un double effet : d’une part ouvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles forces pour les capitalistes ; d’autre part à l’inverse, accentuer la fragmentation et l’inconsistance de la gauche. Dans ces conditions, comment reposer la question du sujet de la politique ? En particulier : comment doit être pensée l’articulation entre ce sujet et l’économie ? Le sujet de la politique n’est pas le produit d’une infrastructure économique ; il n’est pas pour autant « sans rapport » avec les configurations spécifiques de l’économie à une époque donnée (comme peuvent le faire croire Laclau et Mouffe). Il s’agit de penser le sujet de la politique à partir du peuple, à condition que celui-ci ne soit pas pensé comme un Tout, mais au contraire comme ce qui manque à faire un tout – un manque éminemment positif.
Maria Kakogianni, (collectif PhiCTIONS, enseignante précaire SAIF) « Queeriser la luttes des classes : conflits, antagonismes, diférrances ».
Pendant une longue séquence, la dualisation des classes, la division arbitraire du corps social en prolétaires et bourgeois opérait comme une matrice fictionnelle des luttes politiques. Au tournant des années ’70-‘80, alors que le mouvement ouvrier semblait à bout de souffle et rentrait peu à peu dans un cycle de défaites, une certaine conceptualisation de la politique s’exposait à une mise en crise radicale. La logique oppositionnelle de « la » lutte des classes et ses binarités hiérarchiques cédait la place à une logique de la différence. La pensée critique se voulait radicalement antidialectique et pluraliste.
Aujourd’hui, une nouvelle séquence semble s’ouvrir pour les politiques d’émancipation. Des nouveaux printemps précaires de peuples dont l’inscription dans la durée reste fragile. Précaire. A l’écriture derridienne de la « différance » (avec un « a ») on proposera ici une petite torsion mettant l’accent sur l’errance. L’hégémonie du conflit binaire et oppositionnel semble avoir cédé la place à nos « diférrances » : des meutes qui s’interdisent une identification de l’ennemi et d’entrer dans des face-à-face. Si le communisme a cédé la place à l’anti-capitalisme, nous sommes aujourd’hui dans un « anti- » qui n’assume pas l’opposition mais flirte sans cesse avec la différence. Pendant ce temps, le marché semble bien s’accommoder avec les exceptions miniatures, et les altérations démultipliées mais inoffensives.
Queeriser la lutte des classes, ce n’est pas vouloir promouvoir une politique queer, si tant est que cela existe ou que cela puisse exister, mais donner nom à une inquiétude et une enquête : Comment dans ces nouveaux printemps précaires de peuples, penser et agir en refusant le choix forcé entre ou bien « logique d’opposition » ou bien « logique de différence » ?
Dalie Giroux (Université d’Ottawa), « Marx indigène : un devenir-terrien du communisme ».
La communication permettra de mettre en discussion quelques éléments d’une enquête en cours portant sur la cohabitation des dépossessions dans l’espace-temps habitable du capitalisme, en portant une attention particulière aux apprentissages liés à l’occurrence des luttes indigènes nord-américaines dans le continuum des pratiques de résistance contemporaine. Le concept d’accumulation primitive fournit à cet effet un schème d’intelligibilité qui, à travers une histoire politique de la matière qui donne lieu à une géographie et à une scénographie du conflit, rend visible la production en creux d’un commun dont le référent est la dépossession originaire.
Alain Badiou, « La politique : les deux voies, les deux lignes et les deux classes ».
Le contenu de ces dualités est en gros le suivant : les deux voies, qui sont du registre de l’Idée, sont la voie communiste et la voie capitaliste. Ce sont des déterminations normatives, à partir desquelles on peut juger de la pertinence d’une « ligne » organisée dans une situation définie. Les lignes seront dites « de gauche » ou « de droite », et elles sont transversales tant aux activistes des mouvements qu’aux militants des organisations. Les deux classes sont le support objectif de l’ensemble, en même temps qu’elles sont pour part définies, en subjectivité, par rétroaction de comment se manifeste et se prononce, dans une situation définie, la ligne de gauche, elle-même portant la matérialité de la voie communiste.
Discussion avec la salle
Extension de la politique ?
Bernard Aspe, retour sur les interventions précédentes.
Pour nombre de penseurs, d’historiens ou de militants, ce qui identifie notre présent est la situation d’urgence qui découle du désastre écologique produit par l’économie capitaliste. C’est cette situation qui oblige selon eux à redéfinir entièrement ce que nous entendons par « politique ». Cette redéfinition met notamment en question le paradigme « humaniste » – plus qu’anthropocentrique – de la politique, pour chercher à inclure dans les processus de la politique l’ensemble des vivants. La question est ici de savoir si cet élargissement de la notion même de « politique » n’aboutit pas à en diluer le concept, et en particulier sa teneur proprement conflictuelle. À supposer que le conflit politique ne se confonde pas avec la guerre, qu’il est peut-être même une tentative pour interrompre la guerre, n’y a-t-il pas, justement, une guerre menée contre le(s) vivant(s) ? Si oui, par qui est-elle menée ? Et comment l’interrompre ? Quelle politique, c’est-à-dire aussi quelle entente de la politique, permettrait véritablement de constituer une réponse à hauteur du diagnostic et de l’urgence qui semble s’y attacher ? Autrement dit, le point de vue qui entend dépasser la politique humaniste peut-il vraiment disposer d’une pratique de la politique, qui ne se confonde pas avec l’attente passive d’un « changement de paradigme civilisationnel » ?
Sophie Gosselin (Université de Tours), « Rendre justice à la Terre ».
Mon intervention portera sur le basculement politique et historique qui se trouve mis en jeu dans la déclaration des Droits de la Terre (d’abord proclamée à Cochabamba en Bolivie en 2010 puis reprise à l’échelle internationale par divers mouvements politiques et sociaux).
David Gé Bartoli (Editions du Dehors), « Une Révolution cosmique ».
Il s’agit de penser les nouvelles figures de conflictualité apparues récemment( Gaïa/Capital, Humains/Terriens, Cyborg/Déesse, Cybèle/Cyborg) comme sujets politiques étendus à l’échelle cosmique, et de prendre la mesure des termes comme Capitalocène, Anthropocène ou Cthulucène, indiquant aussi une échelle qui ne soit plus seulement historique mais cosmique (une temporalité courant sur des dizaines ou centaines d’années mais sur des milliers ou millions d’années). Il s’agit par ailleurs de penser une démocratie étendue, c’est-à-dire qui concerne non seulement les humains mais aussi l’ensemble des formes de vie qui habitent la Terre : la nécessité étant de penser une démocratie des usages et non des propriétés mais aussi de penser le politique comme garant non seulement des conditions de vie des humains mais aussi plus largement les conditions de la vie elle-même.
Frédéric Neyrat (Université de Wisconsin-Madison), « L’esprit du communisme et la condition planétaire ».
Mon intervention portera sur le rapport entre le communisme – plus précisément l’esprit du communisme – et l’écologie entendue comme condition planétaire, soit la relation entre la situation environnementale de tout être vivant sur Terre et ce qui excède cette situation de terrestre, un excès que j’ose qualifier d’extra-terrestre. Par ce terme, je cherche à repenser le transcendantal de l’humanité, un transcendantal creusé à même la Terre. Pour éviter que les replis identitaires actuels ne conduisent non seulement à la guerre mondiale mais également au désastre climatique, ce qui est nécessaire est une forme de communisme qui puisse allier ses membres en vertu de ce qui traverse la situation terrestre : il ne suffit pas de dire que le champ de bataille est un champ, encore faut-il l’ouvrir au hors-champ qui lui donne sa profondeur d’espace et de temps.
Patrizia Atzei (Université Paris VIII, éditions NOUS), « « L’universel, c’est le local moins les murs ». L’universalité comme extension de la politique ».
Au-delà de l’opposition matricielle universel/particulier, on peut considérer que ce n’est qu’à partir des singularités qu’on peut penser l’universel — ce qui nous permet de sortir du piège de la formalisation comme de celui de l’essentialisme, qui guettent, tels deux pôles opposés, cette notion. Toute universalité se déploie à partir de lieux et de processus de subjectivation particuliers, de singularités — idée qu’exprime l’aphorisme du poète portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ». Si l’universalité peut être opérante pour la pensée de la politique, c’est donc au prix d’une redéfinition radicale du mot, et d’une distinction par rapport à ce qu’on y entend d’habitude : les débats sur l’universalisme. Si le maintien de ce mot peut être utile, c’est parce qu’il permet d’articuler deux sens de l’adresse générique de la politique : le « tous » potentiel (ouvert, indéterminé, inconstructible), en amont et en aval, qui est l’adresse intrinsèque de la politique ; et la potentielle « traduction » d’une situation à une autre, par-delà le caractère situé des luttes, de ce qui dépasse leur inscription locale.
Discussion avec la salle
Formalismes, formes sensibles, formes de vie
Après avoir étendu le questionnement jusqu’aux limites de l’économie-monde et de la planète entière, il sera temps de revenir à ce qu’on pourra appeler les logiques internes des pratiques politiques. Ces logiques sont autant de rationalités qui guident l’action politique, et qui apparaissent lorsqu’il s’agit d’exemplifier l’entente d’une politique « autre », c’est-à-dire en tout cas distincte de son entente parlementaire. Cette exemplification a pris ces dernières années, sur les diverses places occupées du monde, la forme d’une démocratie directe. On a cependant pu reprocher à ce type de mise en œuvre un excès de formalisme, qui pouvait l’apparenter au modèle dont elle cherchait précisément à s’éloigner. On pourrait définir le formalisme comme une autonomisation de la forme qui s’applique indifféremment à ce qu’elle constitue dès lors en matière. À ce formalisme, il ne s’agit pas nécessairement d’opposer une spontanéité informelle. Il s’agirait plutôt d’approfondir le questionnement sur les formes nécessaires à l’existence même de la politique – car sans elles, il n’y en aurait pas de transmission.
Mais comment concevoir des formes qui ne se laissent pas dissocier de ce dont elles sont la forme – qui ne s’autonomisent pas en formalismes ? Faut-il convoquer la forme de vie, si celle-ci est entendue précisément comme ce qui rend la vie inséparable de sa forme ? Ou bien faut-il convoquer le paradigme de l’esthétique, dont la caractéristique serait précisément de ne pas dissocier la forme de l’expérience sensible ? Mais peut-être l’esthétique est-elle ici plus qu’un paradigme ?
Olivier Sarrouy (Université de Rennes II), « Les foules ou le dehors de la souveraineté. La gouvernementalité numérique / libérale comme tactique politique ».
Cette intervention s’intéressera à trois cas d’usage des technologies numériques : le Liberator (une arme imprimable en 3D), les Anonymous et les Organisations Autonomes Décentralisées. Elle s’efforcera de discerner dans ces cas d’usage une reconduction, et en même temps, une altération de certains traits de la rationalité libérale. Une reconduction / altération conduisant, peut-être, à retourner cette rationalité contre les intérêts que celle-ci tend usuellement à servir. Il s’agira ainsi de disséquer les procédés et les points d’appui de ce « gouvernement des foules », à en faire voir les affinités avec la gouvernementalité libérale telle qu’a pu l’analyser Foucault – notamment dans Sécurité, Territoire, Population et Naissance de la Biopolitique – et de dégager de cette analyse les grandes lignes d’orientation tactiques qui sont celles de ces dispositifs. Nous essaierons ainsi de montrer comment ces outils s’efforcent de dégager des « zones d’autonomies » neutralisant les mécanismes traditionnels du pouvoir en supprimant tout point d’appui à l’exercice de la souveraineté.
Erik Bordeleau (Senselab – Montréal), « Finance dans l’Undercommons »
Les mouvements d’occupation qui ont essaimé aux quatre coins du monde suite à la crise financière de 2008 ont mis au jour une hypothèse qui, depuis lors, n’a cessé de se vérifier. La dette n’est pas qu’une relation comptable : c’est d’abord et surtout un rapport politique d’assujettissement. Qui, dans ce contexte, oserait imaginer que le renouvellement de la pensée du commun et la réappropriation de notre puissance d’agir collective passerait par les moyens proprement spéculatifs de la finance?
Nous assistons depuis peu à l’émergence d’une série d’initiatives qui, sur la base de la technologie blockchain, redéfinissent en profondeur le paysage financier. Leur intérêt proprement politique réside dans leur potentiel de décentraliser la finance par l’entremise d’une prolifération d’“organisations autonomes distribuées” (connues sous l’acronyme anglais DAO) coordonnées par l’usage de crypto-monnaies. Adoptées à plus grande échelle, peut-on rêver du jour où ces crypto-monnaies deviendront les vecteurs de nouveaux agencements collectifs et de nouvelles machines de guerre capable de tenir tête à l’oligarchie bancaire et son arme de prédilection, la gouvernementalité par la dette? Car la finance, du moins celle autonome et pratiquée selon les règles du « fugitive planning » en vigueur dans l’Undercommons, ne concerne pas tant les valeurs monétarisées que la mise à l’aventure relationnelle et futuriale des formes-de-vie.
Jacques Rancière (professeur émérite, Université Paris VIII)
Il s’agirait de mettre à l’épreuve des mouvements récents la thèse que j’avais proposée dans La Mésentente : la politique n’est pas un conflit de forces, elle est un conflit de mondes. D’un côté, on peut dire que les mouvements des places et des occupations ont donné une visibilité nouvelle à ce conflit de mondes à travers le bouleversement d’une distribution donnée des espaces, des temps, des identités et des capacités. De l’autre ils ont reposé la question du rapport problématique entre le dissensus par quoi l’on devient étranger au monde de l’ennemi et l’affrontement par lequel on met des forces en face des siennes. Comment penser la forme du rapport entre un être ailleurs et un être-en-face et aussi celle du rapport entre un être-ensemble et un être-contre ? Comment penser la figure présente de cette indissociation des moyens et des fins, des formes et des contenus qui fait le fond « esthétique » de l’idée communiste ?
Discussion avec la salle



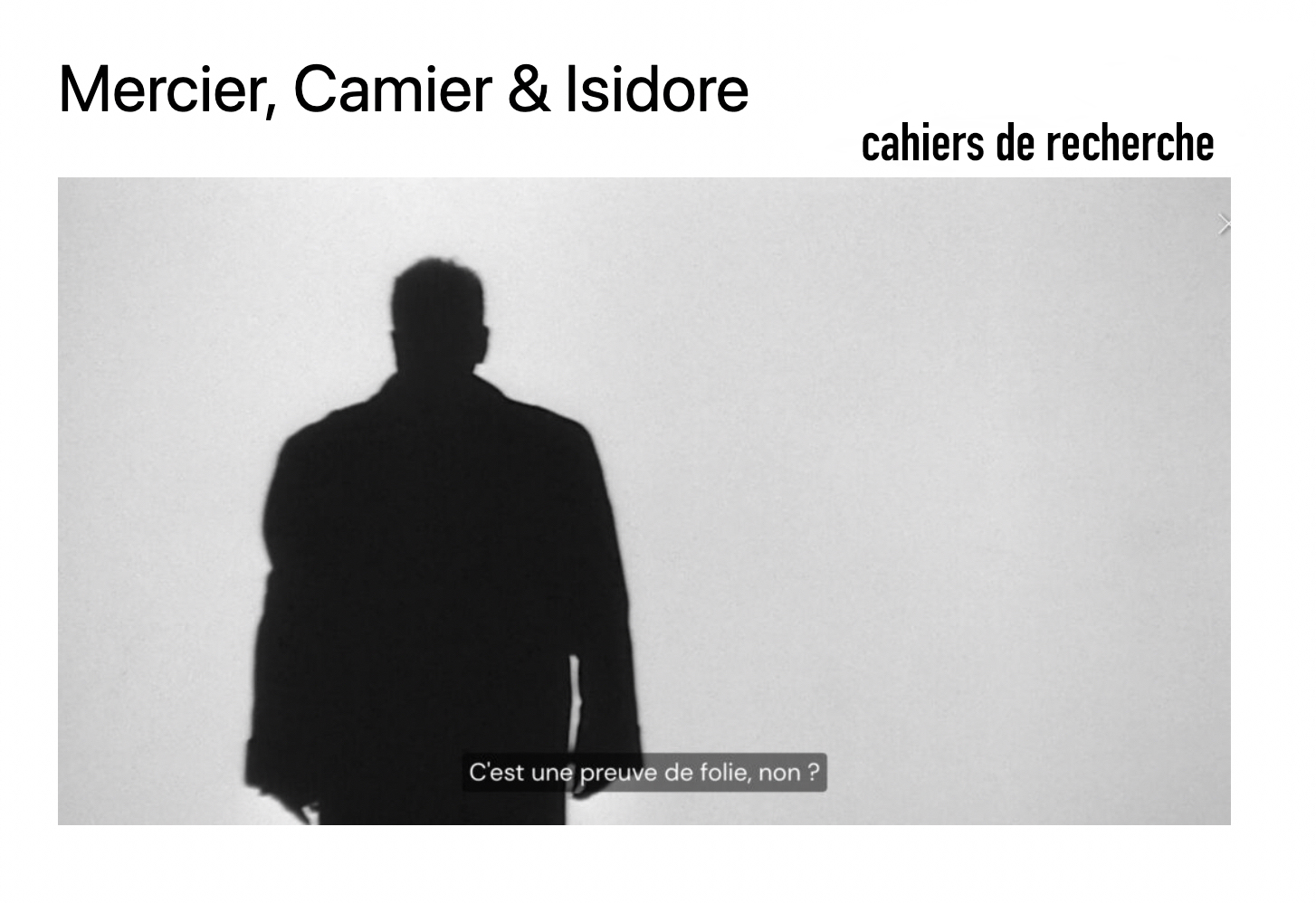




Le conflit politique : logiques et pratiques
Colloque du Collège International de Philosophie qui s’est tenu les 6,7 & 8 avril 2017 à la Parole Errante et au Théâtre L’échangeur.
Organisateurs : Bernard Aspe (Ciph), Patrizia Atzei (Université Paris VIII, éditions NOUS), Camille Louis (collectif kom.post, Université Paris VIII), Frédéric Neyrat (Université de Wisconsin-Madison).
En collaboration avec le département de littérature comparée de l’université de Wisconsin-Madison. Cette rencontre est pensée comme une première étape pour une seconde session à Madison (Wisconsin) l’année suivante.
Le titre choisi pour le colloque donne une indication sur ce qui y est supposé. Disons que l’on fait ici un nœud de trois suppositions : premièrement, la politique se laisse aborder sous l’angle du conflit spécifique qu’elle met en œuvre. Deuxièmement, il y a une logique de ce conflit, ce qui veut dire plus précisément qu’il y en a une intelligibilité, entendons par là une saisie conceptuelle et discursive. Troisièmement, cette intelligibilité, comme dirait Lacan, est « pas-toute » ; le concept de « pratiques » peut alors être mobilisé pour indiquer les éléments (les gestes, les postures, les dispositions) qui se transmettent par d’autres voies que celle du discours ou de la saisie conceptuelle.
Logiques et pratiques ainsi entendues sont au pluriel : nous verrons qu’il s’agit aussi d’identifier une diversité de logiques, et une diversité de pratiques qui les accompagne. Mais il faut voir dès le départ que l’entrelacs des logiques et des pratiques doit être conçu à distance d’une énième variation du « rapport entre la théorie et la pratique ». L’entremêlement des logiques et des pratiques suit des voies beaucoup moins linéaires, et fécondes pour cette raison même. Entre les logiques et les pratiques de la politique, il y a des reprises et des relances dans les deux sens, mais aussi des tensions et des écarts.
Prenons donc pour axiome de départ que là où il y a politique, il y a du désaccord, de la dissension, bref ce qui peut donner lieu à un conflit. La question est alors d’identifier la forme de ce conflit et son objet. Quel est au juste l’objet du conflit politique ? Jacques Rancière propose de considérer que cet objet n’est autre que la politique elle-même, c’est-à-dire ce qui définit son existence propre : il y a politique là où a lieu un conflit sur la manière même d’entendre ce que signifie « politique ». Mais cette entente même n’est l’enjeu de la politique que dans la mesure où elle présuppose une certaine manière de concevoir et de pratiquer le conflit politique. En d’autres termes, la politique est d’abord un conflit sur l’identification de ce qui constitue un conflit politique. Ou encore : l’objet de la politique, c’est tout d’abord l’alternative entre les formes que peut ou que doit prendre la conflictualité politique. Nous dirons alors : la politique a pour objet la forme que l’on peut donner à la conflictualité politique elle-même.
Nous choisissons d’organiser ce colloque à la veille des élections présidentielles, à l’heure où est supposée une certaine entente de la politique (celle qui voit dans les élections la manifestation centrale de la pratique démocratique), et une certaine entente de la forme que prend le conflit politique (à travers la polarisation gauche-droite et la logique d’alternance). Il s’agirait, pour commencer, de mettre en question cette supposition.
Mais bien au-delà de la critique du modèle parlementaire de la politique, il s’agit surtout d’essayer de comprendre ce qui s’impose à nous : des guerres « asymétriques » à la « crise » écologique, des développements du capitalisme aux luttes locales qui cherchent à les contrer. Tout cela configure une situation nouvelle, qui oblige à reprendre la notion même de politique, et par là même à vérifier que cette notion, loin de renvoyer à une essence transhistorique, ne peut être conçue qu’au présent.
Retour sur les pratiques de lutte apparues lors du mouvement de 2016 en France
Invités : Collectif de traduction de l’Orda d’oro / Collectif « Mauvaise troupe » / La Défense collective de Rennes.
La soirée du 6 avril à la Parole errante met en présence des personnes dont on pourrait dire qu’elles ont à la fois des approches différentes et un héritage commun. Le but est donc bien de faire apparaître et cet héritage, et ces différences.
La visée du colloque dans son ensemble est de travailler à rendre plus poreuses les frontières entre le travail d’analyse critique et le travail d’intervention au sein des luttes. Les intervenants de la première soirée sont sans doute tous d’accord sur ce point : ils ne croient pas qu’une véritable intellectualité critique puisse exister sans être d’une manière ou d’une autre en prise avec l’expérience des luttes actuelles. Mais il s’agirait de savoir de quelle manière concevoir le travail de cette intellectualité critique immanente aux luttes.
Pour cela, on peut revenir sur la manière dont l’inscription du savoir critique dans les luttes était mise en œuvre dans ce qui demeure comme le dernier grand moment du mouvement révolutionnaire européen, celui du « long mai » italien, qui est au cœur du livre la Horde d’or. Mais il faut voir aussi quelle portée, quels effets peuvent avoir les textes d’intervention, comme l’est exemplairement Défendre la ZAD, écrit par le collectif Mauvaise troupe, dans les luttes actuelles. Un tout autre versant de l’intellectualité critique est celui de l’appropriation des domaines de savoir censés être réservés à des spécialistes – par exemple, le droit. Lorsqu’il y a conflit, il y a répression, et lorsqu’il y a répression, il y a des inculpés, il y a des procès, il y a des condamnations. Les membres de la Défense collective de Rennes pourront nous éclairer sur l’importance d’une connaissance et d’un usage politique des droits, notamment après les nombreuses condamnations et mises en accusation qui ont eu lieu lors du mouvement contre la loi « travail », et qui se poursuivent aujourd’hui pour celles et ceux qui participent au mouvement contre les violences policières.
Cette démarche nous conduit vers un autre héritage commun. Dans l’Italie des années 1970, le « mouvement théoricien » de l’autonomie organisée portait cette idée apparemment toute simple, mais déterminante : on ne peut pas « être contre » sans « être dans ». On ne peut pas être contre le « système » sans s’appuyer sur ses dispositifs. Un de ces dispositifs est le droit : même si ce dernier sert essentiellement à maintenir un certain ordre des choses, il peut être retourné contre cet ordre – la question, là aussi, est de savoir comment. Un autre de ces dispositifs concerne le revenu : les mouvements des années 1970 en Italie, en tout cas une partie de ceux-ci, ont mis au centre des revendications le « salaire garanti », comme une manière de retourner contre es patrons ce qui était leur principal instrument de contrôle. Enfin, pour occuper une ZAD, il faut bien construire un espace à l’intérieur de l’espace du pouvoir, justement pour contester au pouvoir sa prétention de s’approprier l’intégralité de l’espace – ce qu’il appelle « aménagement du territoire ».
Mais c’est peut-être aussi sur ce point que les différences pourraient apparaître : jusqu’à quel point peut-on créer ainsi un véritable « dehors », une zone d’autonomie collective, tout en restant à l’intérieur du « système » pour pouvoir le combattre ? Ou à l’inverse : jusqu’à quel point faut-il s’appuyer sur les dispositifs de ce système, jusqu’à quel point faut-il parler la langue du pouvoir, pour pouvoir retourner contre lui ses propres instruments ?
Ce qui est sûr en tout cas, c’est que, au centre de ces enjeux, il y a la question du lieu politique – celui qu’il s’agit de tenir, et celui qu’il s’agit d’occuper. Il s’agit d’occuper les lieux censés être voués à la circulation mondialisée pour en faire des zones d’expérimentation d’une autonomie collective. Mais il s’agit aussi de créer une zone d’autonomie collective à l’intérieur des dispositifs judiciaires lorsque la défense se veut, justement, collective – c’est-à-dire d’emblée en rupture avec ce que semblent être les présupposés même du droit « bourgeois » (c’est, disons, l’autre forme de « garantisme », indissociable du garantisme juridique). Dans l’Italie des années 1970, il s’agissait bien aussi de créer des lieux de l’autonomie – en rapport avec les problématiques de l’éducation, de la psychothérapie, du logement, etc. Et de les créer au moment où l’usine commençait à se diffuser à l’ensemble de la société – c’est à cette époque que l’on a commencé à parler de la « société-usine ».
L’héritage commun et les différences pourront donc s’éclairer à partir de l’articulation entre les lieux qui sont à occuper et ceux qui sont à construire.
Le modèle de la guerre
Lorsque la question du conflit est posée, il semble qu’un paradigme vient aussitôt hanter la discussion : celui de la guerre. C’est bien ce que nous pouvons observer aujourd’hui, alors que planent la menace des attentats autant que celle de la réponse par « l’état d’urgence » : on nous somme de prendre parti dans ce qui nous est présenté comme une guerre des civilisations. Il n’est pas sûr que nous devions répondre à cette sommation. Il nous faut plutôt examiner la situation : de quelle guerre s’agit-il au juste ? Cette guerre dont on nous parle n’en recouvre-t-elle pas une autre ? Une guerre des classes, comme le pensait Marx ? Dit autrement : n’est-elle pas, cette guerre des civilisations, ce qui vient se substituer à une autre pratique du conflit, celle qui a longtemps porté le nom de « politique » ? Quelle est alors, dans sa spécificité, la forme que peut prendre le conflit politique en tant qu’il se distingue du conflit proprement guerrier ? N’en est-il pas, justement, l’interruption ? Mais la politique ainsi entendue existe-t-elle vraiment, et durablement, aujourd’hui ? La guerre en cours, telle que nous la présente les médias et les hommes de pouvoir, n’est-elle pas tout d’abord ce qui repose sur l’absentement de la politique ? Et si tel est le cas, comment répondre à cet absentement ? L’exigence de la politique suffit-elle à la faire exister ?
Bernard Aspe (Ciph), « La pensée du conflit ».
Je comprends l’enjeu de ce colloque comme une tentative pour cerner la pensée du conflit politique, entendue non comme ce qui prend pour objet le conflit, mais comme la pensée qui est en jeu dans le conflit. Non sur le mode d’une théorie préalable qui y serait « appliquée », mais sur celui d’une pensée « en immanence », interne aux gestes de la révolte, en acte dans ses gestes. Pour cette première matinée, il sera essentiellement question du rapport entre la politique et la guerre. Je proposerai une utilisation très restreinte du paradigme de la guerre pour éclairer la pensée de/dans la conflictualité politique, en convoquant seulement trois aspects traditionnellement associés à la guerre : la figure de l’ennemi ; la question de la stratégie ; et celle de l’objectif.
Catherine Hass (CNRS, Institut d’Histoire du Temps Présent), « Nom de guerre : contre-enquête ».
Dans une période, la nôtre, marquée par la déshérence et la dés-historicisation du nom même de guerre, je chercherai à montrer comment il est possible de le maintenir et d’en avoir une intelligence renouvelée dès lors la politique devient son opérateur exclusif d’intellection. Cette opération est sous condition de l’enquête, une enquête spécifique puisqu’elle se concentre sur la politique dans la guerre. La guerre devient alors pensable, pour elle-même, à partir de la politique.
Loin d’être identifiable à un invariant ou à une diversité typologique, la guerre est ici affaire de configurations politiques et subjectives, enquêter sur le nom signifiant enquêter sur les politiques à l’œuvre dans la guerre, dans leur historicité propre et pour des séquences données. Selon cette approche, la guerre se déploie à l’aune d’un type de savoir inédit, sa connaissance et sa rationalité étant disposées par la seule politique. Cette investigation est rendue possible par le statut particulier qu’y occupe la politique puisque, faisant fond sur la conception qu’en donne Sylvain Lazarus dans l’Anthropologie du nom, je la qualifie de pensée singulière, subjective et séquentielle, pensable à partir d’elle-même soit, sans convocation de référents objectivistes ou positivistes ou l’appui d’autres disciplines.
Si l’on admet que la politique ne pense pas la guerre selon les mêmes termes, catégories et prescriptions, en Prusse au début du XIXe, en Chine en 1932, en Allemagne en 1941, aux États-Unis en 2001 ou dans l’État islamique en 2015, l’enquête sur la politique, ses catégories et termes s’impose. C’est à ce prix que le nom de guerre peut être maintenu et la guerre devenir pensable, à mesure des intellectualités politiques qui peuvent, ou ont pu, l’identifier et le prescrire. La guerre s’appréhende dès lors à partir de ce que je nomme des modes politiques de guerre.
Oliver Feltham (American University of Paris), « L’action politique et ses contextes disjoints ».
Le point de départ de ma communication est le constat, à l’époque actuelle, d’une indistinction entre le conflit politique et le conflit militaire. Une telle indistinction estompe les différences entre la sphère politique et la sphère militaire à la fois au niveau des fins, des moyens employés et au niveau de la forme même de l’action. Afin de rétablir une distinction entre les formes de l’action militaires et celles d’ordre politique, je vais tenter de reconstruire l’investigation épistémologique de l’action chez Locke en termes ontologiques. L’objectif est de développer une conception ontologique de la faction (le terme anciennement utilisé pour indiquer un conflit irrémédiable) à la lumière des zones de réception des actions politiques : ces milieux, nous allons les appeler des contextes disjoints. C’est à partir du rapport entre les actions et leurs contextes disjoints que l’on va trouver une manière de nuancer l’indistinction existante entre la politique et la guerre.
Sophie Wahnich (CNRS), « Révolution, guerre civile, lutte entre deux classes pendant la Révolution française ».
Cette communication reviendra sur le passage conceptuel pendant la période révolutionnaire de la « révolution » à la « guerre civile » et de la « guerre civile » à « la lutte entre deux classes ». C’est un travail qui met l’accent sur les rapports de Saint-Just quand il explique ce qui fait obstacle concret à la transformation révolutionnaire car la politique n’ a pas changé de régime de confiance, que l’on reste dans des logiques de cour avec méfiance et chausse trappe et non dans un régime d’intérêts partagés voire de bien commun qui suppose la confiance et la circulation des hommes et des idées dans un esprit de justice politique et sociale. Le rapport au présent sera instruit dans cette perspective de laboratoire historique.
Discussion avec la salle
La politique de l’économie ou la politique contre l’économie ?
Si la politique se distingue de la guerre, elle doit donc être pensable dans son ordre propre. Mais à partir de quoi saisir ce « propre » de la politique ? Faut-il considérer qu’il faut la concevoir à distance de tout ce avec quoi on avait pu la confondre : l’histoire, le droit, l’économie ? Insistons particulièrement sur cette dernière : quel rapport l’intelligibilité propre de la politique entretient-elle avec l’analyse de l’économie ? Doit-on envisager ici une disjonction radicale, et considérer par exemple que les modes de la subjectivation politique ne sont jamais les effets d’une situation objective – ce pour quoi ils ont précisément une logique propre ? De ce point de vue, « l’économie » peut être perçue comme un faux-semblant qui ne serait en définitive qu’un instrument tout entier aux mains de ceux qui cherchent à en imposer les prétendues « lois ».
Il n’en reste pas moins qu’il faut bien saisir de quelle manière les subjectivations peuvent s’inscrire dans l’état réel du monde. Si l’on s’accorde à suivre l’indication de Marx et à nommer « capitalisme » le complexe de puissances qui configure l’état du monde (mais cela même peut être un point de discussion), il faut bien disposer aussi d’une analyse de ce qui se présente non pas comme l’objet des « sciences » économiques, mais comme le réel d’une économie-monde. Dès lors comment articuler aujourd’hui l’analyse de l’économie-monde et celle de la politique ? Quelle place prend dans cette articulation l’analyse des formes contemporaines du travail ? Quelle place y est laissée au motif supposé ancien de la « lutte des classes » ? Et surtout : un point est-il identifiable, depuis lequel l’économie-monde pourrait être combattue en tant que telle ?
En définitive, il s’agit ici de savoir si, et de quelle manière, on peut accorder une approche de la politique « en intériorité », selon sa logique et ses exigences propres, et une analyse des processus globaux qui configurent l’espace d’une économie-monde.
Jodi Dean (Hobart and William Smith College, New York), « Communicative capitalism and the subject of politics » / « Le capitalisme communicationnel et le sujet de la politique ».
La recomposition du capital autour des technologies de la communication en réseau a un double effet : d’une part ouvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles forces pour les capitalistes ; d’autre part à l’inverse, accentuer la fragmentation et l’inconsistance de la gauche. Dans ces conditions, comment reposer la question du sujet de la politique ? En particulier : comment doit être pensée l’articulation entre ce sujet et l’économie ? Le sujet de la politique n’est pas le produit d’une infrastructure économique ; il n’est pas pour autant « sans rapport » avec les configurations spécifiques de l’économie à une époque donnée (comme peuvent le faire croire Laclau et Mouffe). Il s’agit de penser le sujet de la politique à partir du peuple, à condition que celui-ci ne soit pas pensé comme un Tout, mais au contraire comme ce qui manque à faire un tout – un manque éminemment positif.
Maria Kakogianni, (collectif PhiCTIONS, enseignante précaire SAIF) « Queeriser la luttes des classes : conflits, antagonismes, diférrances ».
Pendant une longue séquence, la dualisation des classes, la division arbitraire du corps social en prolétaires et bourgeois opérait comme une matrice fictionnelle des luttes politiques. Au tournant des années ’70-‘80, alors que le mouvement ouvrier semblait à bout de souffle et rentrait peu à peu dans un cycle de défaites, une certaine conceptualisation de la politique s’exposait à une mise en crise radicale. La logique oppositionnelle de « la » lutte des classes et ses binarités hiérarchiques cédait la place à une logique de la différence. La pensée critique se voulait radicalement antidialectique et pluraliste.
Aujourd’hui, une nouvelle séquence semble s’ouvrir pour les politiques d’émancipation. Des nouveaux printemps précaires de peuples dont l’inscription dans la durée reste fragile. Précaire. A l’écriture derridienne de la « différance » (avec un « a ») on proposera ici une petite torsion mettant l’accent sur l’errance. L’hégémonie du conflit binaire et oppositionnel semble avoir cédé la place à nos « diférrances » : des meutes qui s’interdisent une identification de l’ennemi et d’entrer dans des face-à-face. Si le communisme a cédé la place à l’anti-capitalisme, nous sommes aujourd’hui dans un « anti- » qui n’assume pas l’opposition mais flirte sans cesse avec la différence. Pendant ce temps, le marché semble bien s’accommoder avec les exceptions miniatures, et les altérations démultipliées mais inoffensives.
Queeriser la lutte des classes, ce n’est pas vouloir promouvoir une politique queer, si tant est que cela existe ou que cela puisse exister, mais donner nom à une inquiétude et une enquête : Comment dans ces nouveaux printemps précaires de peuples, penser et agir en refusant le choix forcé entre ou bien « logique d’opposition » ou bien « logique de différence » ?
Dalie Giroux (Université d’Ottawa), « Marx indigène : un devenir-terrien du communisme ».
La communication permettra de mettre en discussion quelques éléments d’une enquête en cours portant sur la cohabitation des dépossessions dans l’espace-temps habitable du capitalisme, en portant une attention particulière aux apprentissages liés à l’occurrence des luttes indigènes nord-américaines dans le continuum des pratiques de résistance contemporaine. Le concept d’accumulation primitive fournit à cet effet un schème d’intelligibilité qui, à travers une histoire politique de la matière qui donne lieu à une géographie et à une scénographie du conflit, rend visible la production en creux d’un commun dont le référent est la dépossession originaire.
Alain Badiou, « La politique : les deux voies, les deux lignes et les deux classes ».
Le contenu de ces dualités est en gros le suivant : les deux voies, qui sont du registre de l’Idée, sont la voie communiste et la voie capitaliste. Ce sont des déterminations normatives, à partir desquelles on peut juger de la pertinence d’une « ligne » organisée dans une situation définie. Les lignes seront dites « de gauche » ou « de droite », et elles sont transversales tant aux activistes des mouvements qu’aux militants des organisations. Les deux classes sont le support objectif de l’ensemble, en même temps qu’elles sont pour part définies, en subjectivité, par rétroaction de comment se manifeste et se prononce, dans une situation définie, la ligne de gauche, elle-même portant la matérialité de la voie communiste.
Discussion avec la salle
Extension de la politique ?
Bernard Aspe, retour sur les interventions précédentes.
Pour nombre de penseurs, d’historiens ou de militants, ce qui identifie notre présent est la situation d’urgence qui découle du désastre écologique produit par l’économie capitaliste. C’est cette situation qui oblige selon eux à redéfinir entièrement ce que nous entendons par « politique ». Cette redéfinition met notamment en question le paradigme « humaniste » – plus qu’anthropocentrique – de la politique, pour chercher à inclure dans les processus de la politique l’ensemble des vivants. La question est ici de savoir si cet élargissement de la notion même de « politique » n’aboutit pas à en diluer le concept, et en particulier sa teneur proprement conflictuelle. À supposer que le conflit politique ne se confonde pas avec la guerre, qu’il est peut-être même une tentative pour interrompre la guerre, n’y a-t-il pas, justement, une guerre menée contre le(s) vivant(s) ? Si oui, par qui est-elle menée ? Et comment l’interrompre ? Quelle politique, c’est-à-dire aussi quelle entente de la politique, permettrait véritablement de constituer une réponse à hauteur du diagnostic et de l’urgence qui semble s’y attacher ? Autrement dit, le point de vue qui entend dépasser la politique humaniste peut-il vraiment disposer d’une pratique de la politique, qui ne se confonde pas avec l’attente passive d’un « changement de paradigme civilisationnel » ?
Sophie Gosselin (Université de Tours), « Rendre justice à la Terre ».
Mon intervention portera sur le basculement politique et historique qui se trouve mis en jeu dans la déclaration des Droits de la Terre (d’abord proclamée à Cochabamba en Bolivie en 2010 puis reprise à l’échelle internationale par divers mouvements politiques et sociaux).
David Gé Bartoli (Editions du Dehors), « Une Révolution cosmique ».
Il s’agit de penser les nouvelles figures de conflictualité apparues récemment( Gaïa/Capital, Humains/Terriens, Cyborg/Déesse, Cybèle/Cyborg) comme sujets politiques étendus à l’échelle cosmique, et de prendre la mesure des termes comme Capitalocène, Anthropocène ou Cthulucène, indiquant aussi une échelle qui ne soit plus seulement historique mais cosmique (une temporalité courant sur des dizaines ou centaines d’années mais sur des milliers ou millions d’années). Il s’agit par ailleurs de penser une démocratie étendue, c’est-à-dire qui concerne non seulement les humains mais aussi l’ensemble des formes de vie qui habitent la Terre : la nécessité étant de penser une démocratie des usages et non des propriétés mais aussi de penser le politique comme garant non seulement des conditions de vie des humains mais aussi plus largement les conditions de la vie elle-même.
Frédéric Neyrat (Université de Wisconsin-Madison), « L’esprit du communisme et la condition planétaire ».
Mon intervention portera sur le rapport entre le communisme – plus précisément l’esprit du communisme – et l’écologie entendue comme condition planétaire, soit la relation entre la situation environnementale de tout être vivant sur Terre et ce qui excède cette situation de terrestre, un excès que j’ose qualifier d’extra-terrestre. Par ce terme, je cherche à repenser le transcendantal de l’humanité, un transcendantal creusé à même la Terre. Pour éviter que les replis identitaires actuels ne conduisent non seulement à la guerre mondiale mais également au désastre climatique, ce qui est nécessaire est une forme de communisme qui puisse allier ses membres en vertu de ce qui traverse la situation terrestre : il ne suffit pas de dire que le champ de bataille est un champ, encore faut-il l’ouvrir au hors-champ qui lui donne sa profondeur d’espace et de temps.
Patrizia Atzei (Université Paris VIII, éditions NOUS), « « L’universel, c’est le local moins les murs ». L’universalité comme extension de la politique ».
Au-delà de l’opposition matricielle universel/particulier, on peut considérer que ce n’est qu’à partir des singularités qu’on peut penser l’universel — ce qui nous permet de sortir du piège de la formalisation comme de celui de l’essentialisme, qui guettent, tels deux pôles opposés, cette notion. Toute universalité se déploie à partir de lieux et de processus de subjectivation particuliers, de singularités — idée qu’exprime l’aphorisme du poète portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ». Si l’universalité peut être opérante pour la pensée de la politique, c’est donc au prix d’une redéfinition radicale du mot, et d’une distinction par rapport à ce qu’on y entend d’habitude : les débats sur l’universalisme. Si le maintien de ce mot peut être utile, c’est parce qu’il permet d’articuler deux sens de l’adresse générique de la politique : le « tous » potentiel (ouvert, indéterminé, inconstructible), en amont et en aval, qui est l’adresse intrinsèque de la politique ; et la potentielle « traduction » d’une situation à une autre, par-delà le caractère situé des luttes, de ce qui dépasse leur inscription locale.
Discussion avec la salle
Formalismes, formes sensibles, formes de vie
Après avoir étendu le questionnement jusqu’aux limites de l’économie-monde et de la planète entière, il sera temps de revenir à ce qu’on pourra appeler les logiques internes des pratiques politiques. Ces logiques sont autant de rationalités qui guident l’action politique, et qui apparaissent lorsqu’il s’agit d’exemplifier l’entente d’une politique « autre », c’est-à-dire en tout cas distincte de son entente parlementaire. Cette exemplification a pris ces dernières années, sur les diverses places occupées du monde, la forme d’une démocratie directe. On a cependant pu reprocher à ce type de mise en œuvre un excès de formalisme, qui pouvait l’apparenter au modèle dont elle cherchait précisément à s’éloigner. On pourrait définir le formalisme comme une autonomisation de la forme qui s’applique indifféremment à ce qu’elle constitue dès lors en matière. À ce formalisme, il ne s’agit pas nécessairement d’opposer une spontanéité informelle. Il s’agirait plutôt d’approfondir le questionnement sur les formes nécessaires à l’existence même de la politique – car sans elles, il n’y en aurait pas de transmission.
Mais comment concevoir des formes qui ne se laissent pas dissocier de ce dont elles sont la forme – qui ne s’autonomisent pas en formalismes ? Faut-il convoquer la forme de vie, si celle-ci est entendue précisément comme ce qui rend la vie inséparable de sa forme ? Ou bien faut-il convoquer le paradigme de l’esthétique, dont la caractéristique serait précisément de ne pas dissocier la forme de l’expérience sensible ? Mais peut-être l’esthétique est-elle ici plus qu’un paradigme ?
Olivier Sarrouy (Université de Rennes II), « Les foules ou le dehors de la souveraineté. La gouvernementalité numérique / libérale comme tactique politique ».
Cette intervention s’intéressera à trois cas d’usage des technologies numériques : le Liberator (une arme imprimable en 3D), les Anonymous et les Organisations Autonomes Décentralisées. Elle s’efforcera de discerner dans ces cas d’usage une reconduction, et en même temps, une altération de certains traits de la rationalité libérale. Une reconduction / altération conduisant, peut-être, à retourner cette rationalité contre les intérêts que celle-ci tend usuellement à servir. Il s’agira ainsi de disséquer les procédés et les points d’appui de ce « gouvernement des foules », à en faire voir les affinités avec la gouvernementalité libérale telle qu’a pu l’analyser Foucault – notamment dans Sécurité, Territoire, Population et Naissance de la Biopolitique – et de dégager de cette analyse les grandes lignes d’orientation tactiques qui sont celles de ces dispositifs. Nous essaierons ainsi de montrer comment ces outils s’efforcent de dégager des « zones d’autonomies » neutralisant les mécanismes traditionnels du pouvoir en supprimant tout point d’appui à l’exercice de la souveraineté.
Erik Bordeleau (Senselab – Montréal), « Finance dans l’Undercommons »
Les mouvements d’occupation qui ont essaimé aux quatre coins du monde suite à la crise financière de 2008 ont mis au jour une hypothèse qui, depuis lors, n’a cessé de se vérifier. La dette n’est pas qu’une relation comptable : c’est d’abord et surtout un rapport politique d’assujettissement. Qui, dans ce contexte, oserait imaginer que le renouvellement de la pensée du commun et la réappropriation de notre puissance d’agir collective passerait par les moyens proprement spéculatifs de la finance?
Nous assistons depuis peu à l’émergence d’une série d’initiatives qui, sur la base de la technologie blockchain, redéfinissent en profondeur le paysage financier. Leur intérêt proprement politique réside dans leur potentiel de décentraliser la finance par l’entremise d’une prolifération d’“organisations autonomes distribuées” (connues sous l’acronyme anglais DAO) coordonnées par l’usage de crypto-monnaies. Adoptées à plus grande échelle, peut-on rêver du jour où ces crypto-monnaies deviendront les vecteurs de nouveaux agencements collectifs et de nouvelles machines de guerre capable de tenir tête à l’oligarchie bancaire et son arme de prédilection, la gouvernementalité par la dette? Car la finance, du moins celle autonome et pratiquée selon les règles du « fugitive planning » en vigueur dans l’Undercommons, ne concerne pas tant les valeurs monétarisées que la mise à l’aventure relationnelle et futuriale des formes-de-vie.
Jacques Rancière (professeur émérite, Université Paris VIII)
Il s’agirait de mettre à l’épreuve des mouvements récents la thèse que j’avais proposée dans La Mésentente : la politique n’est pas un conflit de forces, elle est un conflit de mondes. D’un côté, on peut dire que les mouvements des places et des occupations ont donné une visibilité nouvelle à ce conflit de mondes à travers le bouleversement d’une distribution donnée des espaces, des temps, des identités et des capacités. De l’autre ils ont reposé la question du rapport problématique entre le dissensus par quoi l’on devient étranger au monde de l’ennemi et l’affrontement par lequel on met des forces en face des siennes. Comment penser la forme du rapport entre un être ailleurs et un être-en-face et aussi celle du rapport entre un être-ensemble et un être-contre ? Comment penser la figure présente de cette indissociation des moyens et des fins, des formes et des contenus qui fait le fond « esthétique » de l’idée communiste ?
Discussion avec la salle
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris