A partir d’un extrait du « Roseau Révolté » de Nina Berberova, Plinio Walder Prado, met au jour l’existence d’un « no man’s land« . Un espace inconnu de tous et qui nous appartient sans réserve, que chacun abrite, en soi, à son insu, et d’où il est possible de cultiver une existence secrète et libre échappant à tout contrôle.
L’art n’assume aucune fonction sociale, nous dira-t-il, il est infonctionnel et l’artiste, est celui qui cultive son « no man’s land« , à l’écoute de ce qui en lui, n’a pas encore été dit. Il est sans considération vis-à-vis du public et d’une quelconque mission de ses œuvres. Le public, lui, ne préexiste pas l’œuvre, mais c’est l’œuvre qui façonne son public.
Cette intervention de Plinio Walder Prado et le dialogue qui l’a suivi, a eu lieu en Mars 2009, à Tours, lors de « Veiller par le geste« , une proposition du Centre Chorégraphique National de Tours, sous la direction de Bernardo Montet.
Intervention de Plinio Walder Prado, professeur de philosophie à l’Université Paris VIII.
Plinio Walder Prado :
« J’enseigne la philosophie au département de philosophie de l’université Paris VIII. Depuis que j’ai accepté l’invitation pour intervenir ici, j’ai préparé trois interventions différentes, et maintenant, je ne sais plus laquelle je vais mobiliser. J’ai trois sujets que je vous propose, à la carte. Le premier sujet qui était le point de départ de ma conversation avec le CCN Tours : la question de l’espace public. Le deuxième sujet : la question de l’art. Le troisième sujet : l’épouvantable situation actuelle en France et en particulier, en ce qui me concerne, à l’université. Donc voilà trois sujets qui m’occupent l’esprit. Je vais peut-être enchaîner sur le sujet le plus difficile, celui de la question de l’art. Pour aggraver mon cas, je fais l’hypothèse suivante : L’art n’a rien à voir avec des fonctions, l’art n’a rien à voir avec le social et non plus avec de la communication. Si on suit cette hypothèse, ce qui fait le noyau dur de l’art concerne quelque chose qui est absolument in-fonctionnel.
Je voudrais être bref, je vais donc partir, pour essayer de circonscrire ce que j’avance, de quelques phrases d’un petit roman de Nina Berberova, « Le Roseau Révolté ». A mon sens, dans ce petit texte, Berberova circonscrit l’enjeu de l’art qui me permet d’affirmer mon hypothèse. Elle dit ceci : « dans ma jeunesse, j’ai pensé que chacun dans ce monde a son no man’s land, une région inhumaine que chacun abrite en soi, à son insu » Il y a, dit-elle, « l’existence apparente, celle du sociale et puis l’autre, inconnue, de tous et qui nous appartient sans réserve. Cela ne veut pas dire que l’une est morale et l’autre pas. Ou que l’une est permise et l’autre interdite. Cela veut dire simplement que chaque être humain, de temps à autre, échappe à tout contrôle, vit dans la liberté et dans le mystère, seul ou avec quelqu’un, une heure par jour ou un soir par semaine ou un jour par mois. Et cette existence secrète et libre, cette seconde existence, se poursuit d’une soirée ou d’une journée à l’autre. De telles heures secrètes, que chacun doit avoir le droit de cultiver en soi, n’ajoutent rien à la vie sociale. » Elles peuvent être, dit Berberova « des moments de joie ou de nécessité » en tout cas, et c’est le point important, ces heures secrètes, cette vie mystérieuse « sert à garder une ligne générale ».
Si on veut mener une vie qui vaille d’être vécue, dit Berberova « il faut cultiver ses heures secrètes » ; et elle ajoute ceci : «qui n’ a pas usé de ce droit ou en a été privé par des circonstances, découvrira un jour avec surprise qu’il ne s’est jamais rencontré avec lui même. On ne peut penser à cela sans mélancolie et ils me font pitié ceux qui en dehors de leur salle de bains ne sont jamais seuls. »
L’enjeu est une rencontre avec soi, un travail sur soi qui échappe justement à la socialité au sens courant du terme. Berberova ajoute ceci : « dans ce no man’s land [dans cette région inhumaine, inconnue, mais qui appartient sans réserve à chacun, dans ce no man’s land donc] prévalent la liberté et les mystères, et adviennent parfois, quand je me consacre à mes heures secrètes, des choses étonnantes : On peut rencontrer des hommes qui se ressemblent, on peut relire un livre avec une acuité particulière ou écouter une musique comme jamais on ne l’avait entendue. A la faveur du silence et de la solitude, mais qui peut être une solitude à plusieurs, on est parfois traversé d’une pensée qui changera notre existence. On prend une décision qui nous sauvera ou nous perdra. Il est possible aussi que certains pleurent ou boivent ou se rappellent quelque chose à jamais oublié ou simplement examinent leur pieds nus. »
Le point important, c’est qu’il ne faut pas penser que cette seconde existence est une fête et que tout le reste relève du quotidien. La frontière passe entre la vie sociale d’une part et d’autre part l’existence secrète. Je voudrais ajouter une dernière phrase de Berberova, parce que cette phrase à mon sens, nous renvoie au contexte politique actuel en France (pas seulement en France, mais puisqu’on y est…) : «L’inquisition ou l’Etat totalitaire ne saurait admettre cette seconde existence qui échappe à leur contrôle. Ils savent ce qu’ils font, ceux qui organisent la vie des hommes de manière à leur interdire toute solitude hors de la salle de bains. Et même dans les casernes, dans les prisons, on n’a plus cette solitude là », celle où un travail sur soi est possible.
Au cours du roman Berberova va montrer que ce qu’on appelle amour, la « communauté des amants », le véritable amour, c’est-à-dire ce qu’on appelle l’amour-passion, n’a lieu que dans le « no man’s land », lorsque deux personnes se rencontrent dans cette région inhumaine. Et si on entend par « no man’s land » ce que le latin appelle infantia, on dira qu’on ne peut être amant qu’en redevenant enfant. Elle développe cette idée tout en disant que, pour garder la ligne générale d’une vie qui vaille d’être vécue, il est absolument indispensable de cultiver ce rapport à cet inconnu en soi, et par conséquent, ne jamais laisser autrui ou l’Etat ou l’économie ou l’échange économique coloniser cette intimité-là. Elle montre par exemple comment dans les rapports de couple – c’est l’objet du livre – il peut arriver que l’un des conjoints essaie de coloniser le « no man’s land » de l’autre. Et une vie où son « no man’s land » est colonisé, c’est une vie vaine, ajoute Berberova.
(Vous avez remarqué qu’elle parle de l’Etat totalitaire et on pourrait faire la remarque qu’aujourd’hui nous ne sommes pas, en tout cas en France, dans un régime totalitaire, puisque c’est une démocratie parlementaire. Quoique c’est une démocratie médiatique et une démocratie médiatique c’est tout autre chose que la République. Ceci étant dit, il y a malgré tout quelque chose à vocation totalisante en France aujourd’hui, et c’est exactement la question de l’échange économique. C’est à dire que quelque chose n’a le droit à exister que s’il est échangeable, c’est-à-dire monnayable, c’est à dire que s’il se plie à la loi du marché et du marchandage. Cette situation, Baudelaire l’avait déjà décrite comme étant la Prostitution, le prostitutionnel. Le prostitutionnel c’est justement l’ensemble des conditions d’existence où vous ne pouvez survivre que si vous avez quelque chose à vendre. Or, c’est ce qui arrive en particulier à l’Université en ce moment où la recherche et l’enseignement sont sous une menace vraiment mortelle de ne pas survire à la logique de l’entrepreneuriat que l’Etat est en train de préparer sur le dos des universitaires.)
Je ne voudrais pas oublier la question qui était mon point de départ, c’est-à-dire la question de l’art. La question de l’art s’articule avec ce que dit Berberova en ceci que je ne peux être capable de dire quelque chose qui n’a pas été dit – c’est-à-dire en matière d’art – que si j’écoute mon « no man’s land ». L’écoute du « no man’s land », c’est l’écoute de ce qui en moi n’a pas encore de mots pour se dire. L’écoute de ce qui en moi appelle, espère, parfois désespère, de ne pas trouver des formes pour se dire. C’est dans ce travail sur soi que je peux avoir une chance de créer quoi que ce soit. Donc vous voyez que ce « no man’s land », dont parle Berberova, ouvre une sorte d’ascèse, de travail sur soi pour que la création d’une forme inédite (couleur, ligne, musique, littérature), soit possible. Cela implique une chose importante par rapport à notre débat : Cela veut dire que l’artiste, au sens de Berberova, c’est quelqu’un qui a un engagement fondamental avec son « no man’s land ». Ce à quoi il faut essayer de donner des formes, c’est quelque chose rattaché à son « no man’s land ».
Vous voyez que cela n’a rien, en principe, à voir avec le public. L’oeuvre d’art est une bouteille lancée à la mer. Si elle trouve le public, c’est très bien, si elle ne le trouve pas, tant pis. Mais la première responsabilité de l’artiste est à l’égard de son « no man’s land ». Ecouter ce qui en lui demande à être mis en forme. Cette position est très importante, et ça veut dire en quelque sorte, pour Berberova, que si ce que je suis en train de faire est véritablement inouï ou inédit, mon public n’existe pas encore, parce que le public est en attente de ce qu’il connaît déjà. C’est la formule du « best-seller » : Le « best-seller» est justement ce qui offre ce qui répond à un horizon d’attente. Or Berberova dit, si ma création est radicale, alors mon public n’existe pas encore. Je lance ma bouteille à la mer et si j’ai le bonheur de trouver un public, ce sera un public façonné par mon oeuvre d’art. Je vais créer un nouveau public.
L’exemple classique est celui de Samuel Becket lorsqu’il écrit « En attendant Godot » – qui est la pièce de théâtre, m’a t-on dit la plus jouée au monde, y compris dans les prisons -, lorsqu’il a écrit cette pièce, il a failli faire un échec, on a pas voulu jouer sa pièce, il a été sifflé, etc, ce qui arrive souvent lorsqu’on est radical dans la création. Mais Adorno, en commentant l’oeuvre de Becket, rappelle que l’oeuvre de Beckett est en train de forger un public. Public qu’on va appeler par la suite des « beckettiens », voire même des « beckettologues »… Mais l’arrivée des « beckettologues » appelle à un nouveau déplacement, cette arrivée exige de trouver autre chose qui n’a pas encore son public. Cet engagement vis-à-vis du « no man’s land » au sens de Berberova, est un engagement vis-à-vis d’une création radicale qui déplace l’attente de ce qu’on appelle le public, déjà là.
Je crois que je vais m’arrêter sur ces deux ou trois remarques. Je n’ai rien dit de l’Espace public. Mais il y aurait à lever un malentendu entre « lieu public » et « espace public ». Rapidement, quelques mots à propos de l’histoire du concept d’espace public. Espace public est une traduction française de ce qu’on appelle en allemand Oeffentlichkeit. Oeffentlichkeit, s’il fallait le traduire littéralement, ce serait la Publicité au sens noble du terme. Mais comme la publicité n’a rien de noble aujourd’hui, on n’a pas pu traduire Oeffentlichkeit par Publicité. Parce que la publicité, au sens de la réclame, c’est-à-dire la prostitution, a accaparé le concept d’Oeffentlichkeit. Donc on le traduit en français par Espace public. Mais l’Espace public originalement, ça n’a pas vraiment à voir avec des lieux publics. L’espace public commence au XVIIIe siècle avec l’échange des lettres. Le XVIIIe siècle, c’est le Siècle épistolaire.
C’est un siècle où s’invente une culture de la lettre : j’écris à toi, en travaillant sur moi, sur toi et sur notre relation, et tu me réponds également en retour, sur tous ces plans. C’est sur cet échange-là que commence à naître une série de questions sur la société : Qu’est-ce que la monarchie ? Qu’est-ceque le droit ? Est-ce que l’amour a des droits par rapport à l’argent ? etc. L’Espace public commence par des mises en question, par l’échange de lettres s’interrogeant sur les valeurs reçues, instituées. Et tout de suite après, vont naître les remarquables romans par lettres (Pamela de Richardson, la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les Liaisons Dangereuses de Laclos). Mais les romans par lettres supposent la société de relations épistolaires. Et cette société sera contemporaine de la multiplication des Salons littéraires, des Cafés littéraires, mais aussi de la naissance des bibliothèques, soit d’une discussion intense qui va culminer avec la Révolution. Et aussi avec la Déclaration des Droits, qui sont si bafoués de nos jours, comme le rappelle régulièrement le Réseau Education Sans Frontière (que nous venons d’entendre). Déclaration des Droits, donc, et naissance d’un nouvel Espace public qui est l’espace républicain, lui-même aussi bafoué aujourd’hui.
Ce qui est important, c’est que cette idée qui énonce que par la discussion, le débat, nous pouvons tout questionner, y compris le président de la République, y compris l’Etat, y compris les lois civiles, et que nous avons le droit à la – et même le devoir de – désobéissance civile, cette idée donc, était le gage de la promesse d’un avenir pour une société de demain, meilleure que celle d’aujourd’hui. Cette promesse a été théorisée dans des petits textes politiques de Kant, où Kant dit qu’il y a une promesse d’émancipation à venir, il suffit qu’on laisse libre, ouvert l’Espace public.
Ces textes sont des textes de 1784. Or, de 1784 à 1984 vous avez Orwell. Orwell marque le roman de la fin de l’Espace public. C’est-à-dire le roman où justement il n’est plus possible de discuter librement, d’élaborer sa pensée collectivement et publiquement. Dans le romans d’Orwell, le seul résistant, Winston, c’est justement quelqu’un qui achète clandestinement un cahier et, clandestinement chez lui – parce que vous savez, ce sont des sociétés à écrans interactifs, ce qui veut dire que même étant chez vous, vous êtes épiés par les écrans du réseau communicationnel -, donc Winston chez lui, tourne le dos à l’écran pour tenir un journal intime. Et qu’est-ce que le journal intime de Winston si ce n’est justement la recherche du « no man’s land » au sens de Berberova. Winston cherche à élaborer quelque chose dont l’Etat totalitaire de 1984, ne veut rien savoir, qu’il forclot, interdit.
Or je pense, et c’est la dernière chose que je voudrais dire avant qu’on passe au débat, je pense que s’il y a une chose absolument sacrée à laquelle nous ne devrions pas laisser toucher, c’est justement le droit pour chacun d’élaborer ce qu’il doit être. C’est-à-dire, de travailler sur soi sur son « no man’s land » et de décider de comment il doit mener sa vie. C’est justement cela qui nous est de plus en plus interdit aujourd’hui, y compris dans ce dernier rempartcontre la totalisation économique qu’a été jusqu’à aujourd’hui l’Université. L’Université au sens premier du terme, cela voulait dire justement, que nous avions droit à un temps improductif pour élaborer ce que nous devons être. Une phrase célèbre d’Erasme : « On ne naît pas humain on le devient ». Or l’Université est en un sens le dernier endroit où il est encore possible d’élaborer ce devenir. C’est justement cela qu’on est en train de liquider en ce moment et vous voyez que finalement mes trois points distincts (du début ) finissent par se relier. »
Question 1 : « Si on vous suit, l’artiste serait celui qui cultive son « no man’s land ». Et s’il est dans un engagement radical vis-à-vis de ce « no man’s land » il est aussi celui qui résiste à la colonisation de son « no man’s land » par le pouvoir. Cet artiste serait donc quelqu’un qui, au quotidien, résisterait. La question ne serait alors plus celle de l’art mais celle de l’artiste. Non pas, est-ce que l’art assume des fonctions sociales, mais est-ce que l’artiste en tant qu’il est celui qui cultive son « no man’s land » assume un rôle, qui pourrait être celui d’enseigner des pratiques, des techniques de soi ? L’artiste comme celui qui a la capacité ou les moyens d’enseigner des pratiques de soi au autres ? »
Question 2 : « J’ai été sensible à ce qui vient d’être dit et je suis convaincue par ce que vous avez dit. Mais il y a un mot, une expression qui m’a gêné et que vous reprenez de Nina Berberova : « travail sur soi ». Or, qu’est-ce que le « travail sur soi » dans la société française de 2009 ? Pour moi ça évoque ce supermarché, cet hypermarché de la psycho-machin chose : « je recherche un gourou qui va m’aider à travailler sur moi » et on retombe complètement dans précisément tout ce que vous avez pointé comme étant justement l’adversaire de tout ce qui peut nous émanciper. Ne pourrait-on pas trouver une expression autre ? « Travail sur soi » évoque pour moi le marché du pseudo-individualisme. »
Plinio Walder Prado : « L’usage que je fais de l’expression « travail sur soi » n’est pas à confondre avec l’actuel marché de la psyché. Il y a chez Freud un concept de « travail » qui est essentiel pour comprendre ce qu’il appelle le fonctionnement de l’énergie libidinale, ses déplacements, investissements et contre-investissements, etc., et les possibilités d’intervenir dans ce fonctionnement, de l’élaborer ou le perlaborer, de le « travailler » ; c’est le cas par exemple de ce qu’on appelle le « travail du deuil ». « Travail » veut dire : transformation de l’énergie. Et là on pourrait à mon sens aller très sérieusement dans la direction que vous pointez. Il y a une autre expression qui dit à cet égard la même chose que « travail sur soi » et qui nous vient des Grecs : «l’epimeleia heautou », c’est-à-dire, « souci de soi ». Le souci de soi ouvre sur la question qui m’intéresse ici : qu’on peut, on doit se transformer. Il y a une phrase célèbre de Socrate, au moment où il va être condamné à mort : « Une vie sans examen ne vaut pas d’être vécue ». Le mot « examen » dans cette phrase renvoie à un auto-questionnement ou à une interrogation sur sa vie au cours de sa propre vie. C’est à cela que j’ai voulu faire allusion avec l’expression « travail sur soi ». Et cela n’a rien à voir non plus avec ce qu’on appelle aujourd’hui l’individualisme ou l’égocentrisme, bien au contraire : il n’y a pas de souci des autres, de souci de la Cité, sans le souci de soi dont nous parlons. Pierre Hadot et Michel Foucault, par exemple, se sont bien expliqués là-dessus.
Mais dans ce que vous pointez là, il y a quelque chose d’encore plus épouvantable, pour moi en tout cas, et qui est que tout les mots sont plus ou moins pris aujourd’hui. Lorsque Michel Foucault parle du souci de soi et particulièrement dans le livre « L‘herméneutique du sujet », eh bien, on peut voir la façon soigneuse avec laquelle il va travailler le concept de « souci de soi ». Or, dès qu’il commence à travailler sur ce concept, les californiens, qui sont en plein dans le marché de ce qu’ils appellent, eux la culture ou le culte du soi, voire le « souci de soi » – ce marché que vous dénoncez –, les californiens donc, disent « Mais ce que vous faites, ce que vous êtes en train d’expliquer, c’est exactement ce que nous faisons en Californie : la recherche du « vrai moi », etc., c’est le souci de soi ». Et Foucault a du mal pour essayer de faire départager ce qu’il est en train de dire d’avec ce qu’on appelle aujourd’hui « le souci de soi » sur le marché des gadgets « thérapiques ». Et je sais qu’il y a même ce qu’on appelle des philosophes, qui, à travers leurs sites, proposent la marchandise « souci de soi » moyennant une Carte Bleu à 40 euros l’heure. Il faudrait donc qu’on prenne la mesure de la gravité de cette question de l’échange, du marché qui va jusque là – jusqu’à la souffrance psychique considérée comme un marché porteur, un buisness. Et qu’on y soit vigilant.Donc je suis mille fois d’accord avec vous. Ceci dit, j’ai pris cette expression et il faut parfois parier que au-delà des mots, vous saisissiez ce que je veux dire.
En ce qui concerne ce qui a été dit auparavant (la question 1), je pense que la responsabilité de l’artiste est de répondre à la question qu’est-ce que l’art ? Chaque fois qu’un artiste va danser, ou qu’il s’assoit au piano, ou qu’il est devant une page blanche, ou devant une toile vierge, la question pour lui est d’essayer de dire qu’est-ce que la danse ? qu’est-ce que la musique ? qu’est-ce que l’écriture ? qu’est-ce que la peinture ? A chaque fois cette question est remise à plat. La question de savoir « est-ce que le public va me comprendre ? n’est pas la question de l’artiste.
J’ai travaillé avec ceux qu’on appelle des « agents culturels ». Ce sont des gens qui essayent de faire comprendre au public ce que font les artistes. Des gens qui étaient dans un état d’angoisse pénible… Il faut faire là un départage, donc, entre ce que sont les textes, « L‘innommable » par exemple de Beckett, et puis la question de savoir si dans les médias, à la radio, à la télévision il est possible de parler de « L‘innommable ». Ce sont à mon avis deux questions différentes. Or, lorsque Beckett écrit « L‘innommable », pour continuer sur cet exemple, Beckett, la « voix » qui parle à travers lui, ne cesse de répéter que ce n’est pas lui qui écrit. Il dit : je prête ma main pour que quelque chose se dise ou s’écrive à travers moi. Et ce quelque chose qui doit se dire à travers moi, ce n’est même pas des mots. Les mots sont là pour que la chose puisse se « dire », mais la chose qui doit se dire est innommable. Donc il faut être courageux pour tenir le pari d’écrire un livre qui s’appelle « L’innommable », qui a le droit de s’appeler « L’innommable ». Donc, je pense que l’artiste n’est responsable que de cette question là : qu’est-ce qu’écrire ? qu’est-ce que l’art. Et il n’a pas non plus à mon sens à enseigner quelque chose à quelqu’un. Je crois que si Beckett entendait cela il éclaterait de rire, comme il le faisait. L’artiste ne prétend enseigner rien à personne. Il prétend descendre au fond de son « no man’s land » et éprouver sa misère, ce que Beckett appelle parfois « l’insondable misère de l’être ». On n’est pas dans la pédagogie, on est dans un travail d’écoute, auprès du mystère que chacun porte en soi, que chacun est en soi.
Juste un dernier mot. Je pense que cette question du souci de soi- mais je préfère parler de « s’occuper de son no man’s land »- cette question, si elle fut ou aurait du être un des enjeux majeurs de l’Université, elle est aujourd’hui menacée plus que jamais à mon sens, y compris à l’Université. »
Question 3 : « C’était juste pour rebondir. Vous parlez du « no man’s land » et je pensait au philologue allemand Victor Klemperer qui notait les rêves des gens qu’il rencontrait sous le III Reich. On voit comment le pouvoir a la possibilité de venir investir un espace intime. Et plutôt que de poser la question : l’art assume-t-il des fonctions sociales, ce serait plutôt la question de savoir comment le public peut cultiver des moyens pour s’emparer de l’art afin de trouver des espaces imaginaire pour échapper à ce qui vient nous marteler tous les jours dans le plus intime de nous-même. Par exemple dernièrement, arteradio a récolté des rêves de jeunes femmes qui rêvent de Nicolas Sarkozy et de son couple. Ce qui est intéressant c’est comment à chaque fois ce qui se dit dans ces rêves c’est la question de l’intrusion dans l’intimité. Comment résister à ce qui vient nous hanter dans notre sommeil ? Peut-être que l’art est une possibilité de trouver des points de fuites ? »
Question 4 : « Vous disiez qu’il n’y avait pas de pédagogie possible. Est-ce que vous pensez alors qu’il n’y a pas de connaissances propre au travail artistique ? Des connaissances qui puissent être transmises ? C’est aussi la question de la technique, pour descendre en soi il doit bien exister des techniques ? »
Plinio Walder Prado : « Dans l’hypothèse que je suis ici, ce qui fait la spécificité de l’art passe par la sensibilité, c’est-à-dire ce qu’on appelle l’aisthêsis, le sentiment. Il y a à mon sens, un abîme entre cette dimension sentimentale et la dimension proprement cognitive. Si des penseurs comme Benjamin ou Adorno ont essayé de dire que la grande affaire du monde administré, le nôtre, le monde de la « vie administré », c’est la question de l’art, ce n’est pas parce que ce sont des « esthètes » ou ont je ne sais quel penchant esthétisant. C’est parce qu’ils ont perçu que le véritable enjeu est cette dimension irréductible de la sensibilité, qu’il faut protéger. Or cette dimension-là, de l’affect, croise celle de la singularité. Tout le mystère, c’est qu’on puisse partager, en dehors de la connaissance, quelque chose qui est pur sentiment. Un partage du sentiment. Kant l’a élaboré dans la Critique du jugement, c’est ce qu’il appelle une « communauté sentimentale », une « communauté de sentiments ». La communauté sentimentale, ce n’est pas la communauté scientifique, ni la communauté politique. C’est une communauté où on peut partager quelque chose dans le seul ordre de la sensibilité, par le seul sentiment, une communauté « aisthétique », comme l’est la communauté des amants. Cette idée va être reprise par Schiller et exploitée dans une perspective politique. Il dira que l’Europe n’a qu’une chance, si elle veut vraiment se constituer en tant que communauté digne de ce nom, c’est celle de construire une communauté de sentiments, façonnée par l' »éducation esthétique », et surtout pas une prétendue « communauté économique », bâtie en fait sur la guerre des intérêts. Schiller le dit en 1795. La promesse de l’art, Stendhal l’appelait « promesse de bonheur », et ce bonheur-là, c’est un partage des singularités « simplement » par le sentiment. Dès qu’on passe à la connaissance, au travail du concept, on perd cette dimension singulière irréductible. »



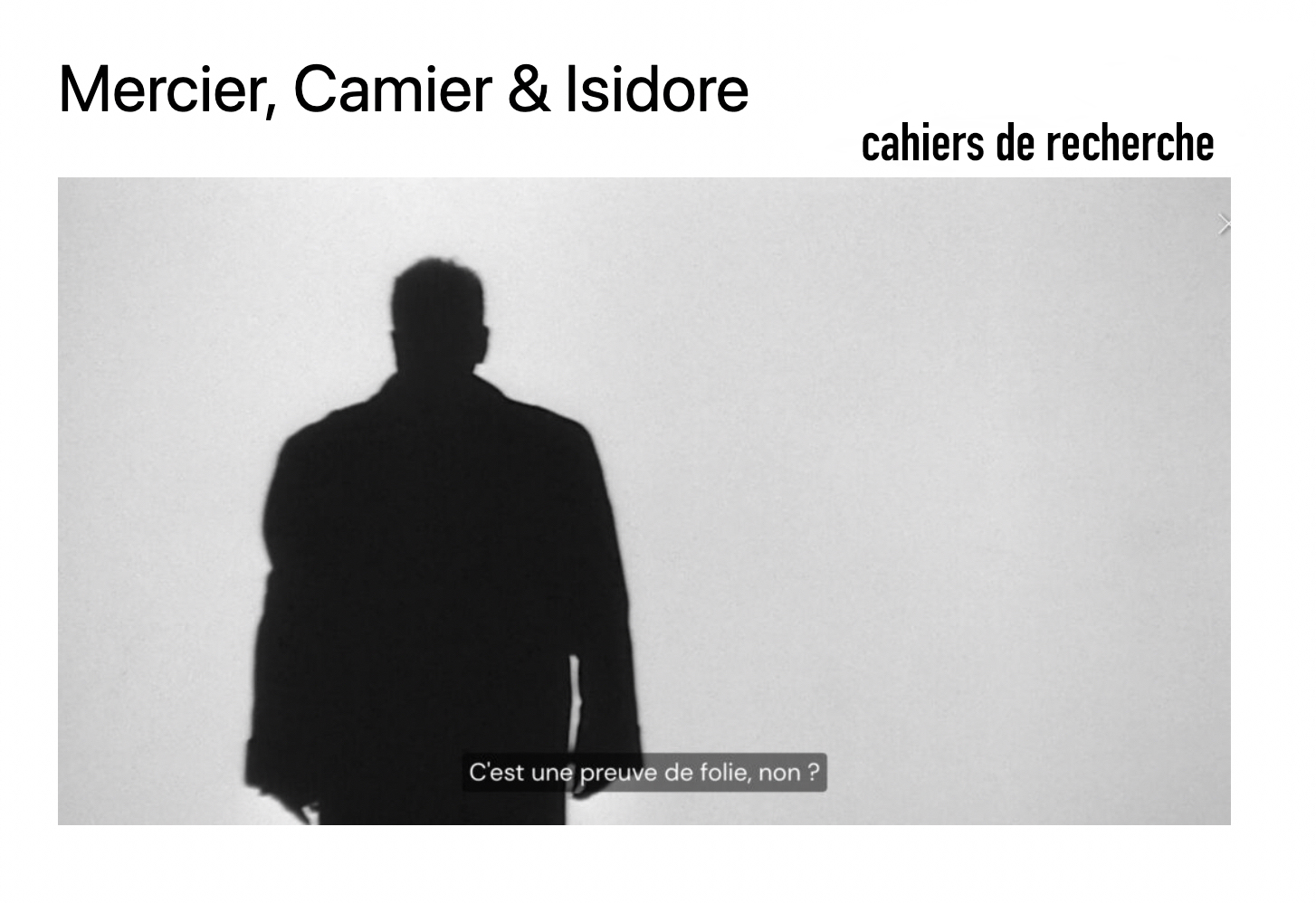




L’art assume t-il des fonctions sociales ?, Plinio Walder Prado
A partir d’un extrait du « Roseau Révolté » de Nina Berberova, Plinio Walder Prado, met au jour l’existence d’un « no man’s land« . Un espace inconnu de tous et qui nous appartient sans réserve, que chacun abrite, en soi, à son insu, et d’où il est possible de cultiver une existence secrète et libre échappant à tout contrôle.
L’art n’assume aucune fonction sociale, nous dira-t-il, il est infonctionnel et l’artiste, est celui qui cultive son « no man’s land« , à l’écoute de ce qui en lui, n’a pas encore été dit. Il est sans considération vis-à-vis du public et d’une quelconque mission de ses œuvres. Le public, lui, ne préexiste pas l’œuvre, mais c’est l’œuvre qui façonne son public.
Cette intervention de Plinio Walder Prado et le dialogue qui l’a suivi, a eu lieu en Mars 2009, à Tours, lors de « Veiller par le geste« , une proposition du Centre Chorégraphique National de Tours, sous la direction de Bernardo Montet.
Intervention de Plinio Walder Prado, professeur de philosophie à l’Université Paris VIII.
Plinio Walder Prado :
« J’enseigne la philosophie au département de philosophie de l’université Paris VIII. Depuis que j’ai accepté l’invitation pour intervenir ici, j’ai préparé trois interventions différentes, et maintenant, je ne sais plus laquelle je vais mobiliser. J’ai trois sujets que je vous propose, à la carte. Le premier sujet qui était le point de départ de ma conversation avec le CCN Tours : la question de l’espace public. Le deuxième sujet : la question de l’art. Le troisième sujet : l’épouvantable situation actuelle en France et en particulier, en ce qui me concerne, à l’université. Donc voilà trois sujets qui m’occupent l’esprit. Je vais peut-être enchaîner sur le sujet le plus difficile, celui de la question de l’art. Pour aggraver mon cas, je fais l’hypothèse suivante : L’art n’a rien à voir avec des fonctions, l’art n’a rien à voir avec le social et non plus avec de la communication. Si on suit cette hypothèse, ce qui fait le noyau dur de l’art concerne quelque chose qui est absolument in-fonctionnel.
Je voudrais être bref, je vais donc partir, pour essayer de circonscrire ce que j’avance, de quelques phrases d’un petit roman de Nina Berberova, « Le Roseau Révolté ». A mon sens, dans ce petit texte, Berberova circonscrit l’enjeu de l’art qui me permet d’affirmer mon hypothèse. Elle dit ceci : « dans ma jeunesse, j’ai pensé que chacun dans ce monde a son no man’s land, une région inhumaine que chacun abrite en soi, à son insu » Il y a, dit-elle, « l’existence apparente, celle du sociale et puis l’autre, inconnue, de tous et qui nous appartient sans réserve. Cela ne veut pas dire que l’une est morale et l’autre pas. Ou que l’une est permise et l’autre interdite. Cela veut dire simplement que chaque être humain, de temps à autre, échappe à tout contrôle, vit dans la liberté et dans le mystère, seul ou avec quelqu’un, une heure par jour ou un soir par semaine ou un jour par mois. Et cette existence secrète et libre, cette seconde existence, se poursuit d’une soirée ou d’une journée à l’autre. De telles heures secrètes, que chacun doit avoir le droit de cultiver en soi, n’ajoutent rien à la vie sociale. » Elles peuvent être, dit Berberova « des moments de joie ou de nécessité » en tout cas, et c’est le point important, ces heures secrètes, cette vie mystérieuse « sert à garder une ligne générale ».
Si on veut mener une vie qui vaille d’être vécue, dit Berberova « il faut cultiver ses heures secrètes » ; et elle ajoute ceci : «qui n’ a pas usé de ce droit ou en a été privé par des circonstances, découvrira un jour avec surprise qu’il ne s’est jamais rencontré avec lui même. On ne peut penser à cela sans mélancolie et ils me font pitié ceux qui en dehors de leur salle de bains ne sont jamais seuls. »
L’enjeu est une rencontre avec soi, un travail sur soi qui échappe justement à la socialité au sens courant du terme. Berberova ajoute ceci : « dans ce no man’s land [dans cette région inhumaine, inconnue, mais qui appartient sans réserve à chacun, dans ce no man’s land donc] prévalent la liberté et les mystères, et adviennent parfois, quand je me consacre à mes heures secrètes, des choses étonnantes : On peut rencontrer des hommes qui se ressemblent, on peut relire un livre avec une acuité particulière ou écouter une musique comme jamais on ne l’avait entendue. A la faveur du silence et de la solitude, mais qui peut être une solitude à plusieurs, on est parfois traversé d’une pensée qui changera notre existence. On prend une décision qui nous sauvera ou nous perdra. Il est possible aussi que certains pleurent ou boivent ou se rappellent quelque chose à jamais oublié ou simplement examinent leur pieds nus. »
Le point important, c’est qu’il ne faut pas penser que cette seconde existence est une fête et que tout le reste relève du quotidien. La frontière passe entre la vie sociale d’une part et d’autre part l’existence secrète. Je voudrais ajouter une dernière phrase de Berberova, parce que cette phrase à mon sens, nous renvoie au contexte politique actuel en France (pas seulement en France, mais puisqu’on y est…) : «L’inquisition ou l’Etat totalitaire ne saurait admettre cette seconde existence qui échappe à leur contrôle. Ils savent ce qu’ils font, ceux qui organisent la vie des hommes de manière à leur interdire toute solitude hors de la salle de bains. Et même dans les casernes, dans les prisons, on n’a plus cette solitude là », celle où un travail sur soi est possible.
Au cours du roman Berberova va montrer que ce qu’on appelle amour, la « communauté des amants », le véritable amour, c’est-à-dire ce qu’on appelle l’amour-passion, n’a lieu que dans le « no man’s land », lorsque deux personnes se rencontrent dans cette région inhumaine. Et si on entend par « no man’s land » ce que le latin appelle infantia, on dira qu’on ne peut être amant qu’en redevenant enfant. Elle développe cette idée tout en disant que, pour garder la ligne générale d’une vie qui vaille d’être vécue, il est absolument indispensable de cultiver ce rapport à cet inconnu en soi, et par conséquent, ne jamais laisser autrui ou l’Etat ou l’économie ou l’échange économique coloniser cette intimité-là. Elle montre par exemple comment dans les rapports de couple – c’est l’objet du livre – il peut arriver que l’un des conjoints essaie de coloniser le « no man’s land » de l’autre. Et une vie où son « no man’s land » est colonisé, c’est une vie vaine, ajoute Berberova.
(Vous avez remarqué qu’elle parle de l’Etat totalitaire et on pourrait faire la remarque qu’aujourd’hui nous ne sommes pas, en tout cas en France, dans un régime totalitaire, puisque c’est une démocratie parlementaire. Quoique c’est une démocratie médiatique et une démocratie médiatique c’est tout autre chose que la République. Ceci étant dit, il y a malgré tout quelque chose à vocation totalisante en France aujourd’hui, et c’est exactement la question de l’échange économique. C’est à dire que quelque chose n’a le droit à exister que s’il est échangeable, c’est-à-dire monnayable, c’est à dire que s’il se plie à la loi du marché et du marchandage. Cette situation, Baudelaire l’avait déjà décrite comme étant la Prostitution, le prostitutionnel. Le prostitutionnel c’est justement l’ensemble des conditions d’existence où vous ne pouvez survivre que si vous avez quelque chose à vendre. Or, c’est ce qui arrive en particulier à l’Université en ce moment où la recherche et l’enseignement sont sous une menace vraiment mortelle de ne pas survire à la logique de l’entrepreneuriat que l’Etat est en train de préparer sur le dos des universitaires.)
Je ne voudrais pas oublier la question qui était mon point de départ, c’est-à-dire la question de l’art. La question de l’art s’articule avec ce que dit Berberova en ceci que je ne peux être capable de dire quelque chose qui n’a pas été dit – c’est-à-dire en matière d’art – que si j’écoute mon « no man’s land ». L’écoute du « no man’s land », c’est l’écoute de ce qui en moi n’a pas encore de mots pour se dire. L’écoute de ce qui en moi appelle, espère, parfois désespère, de ne pas trouver des formes pour se dire. C’est dans ce travail sur soi que je peux avoir une chance de créer quoi que ce soit. Donc vous voyez que ce « no man’s land », dont parle Berberova, ouvre une sorte d’ascèse, de travail sur soi pour que la création d’une forme inédite (couleur, ligne, musique, littérature), soit possible. Cela implique une chose importante par rapport à notre débat : Cela veut dire que l’artiste, au sens de Berberova, c’est quelqu’un qui a un engagement fondamental avec son « no man’s land ». Ce à quoi il faut essayer de donner des formes, c’est quelque chose rattaché à son « no man’s land ».
Vous voyez que cela n’a rien, en principe, à voir avec le public. L’oeuvre d’art est une bouteille lancée à la mer. Si elle trouve le public, c’est très bien, si elle ne le trouve pas, tant pis. Mais la première responsabilité de l’artiste est à l’égard de son « no man’s land ». Ecouter ce qui en lui demande à être mis en forme. Cette position est très importante, et ça veut dire en quelque sorte, pour Berberova, que si ce que je suis en train de faire est véritablement inouï ou inédit, mon public n’existe pas encore, parce que le public est en attente de ce qu’il connaît déjà. C’est la formule du « best-seller » : Le « best-seller» est justement ce qui offre ce qui répond à un horizon d’attente. Or Berberova dit, si ma création est radicale, alors mon public n’existe pas encore. Je lance ma bouteille à la mer et si j’ai le bonheur de trouver un public, ce sera un public façonné par mon oeuvre d’art. Je vais créer un nouveau public.
L’exemple classique est celui de Samuel Becket lorsqu’il écrit « En attendant Godot » – qui est la pièce de théâtre, m’a t-on dit la plus jouée au monde, y compris dans les prisons -, lorsqu’il a écrit cette pièce, il a failli faire un échec, on a pas voulu jouer sa pièce, il a été sifflé, etc, ce qui arrive souvent lorsqu’on est radical dans la création. Mais Adorno, en commentant l’oeuvre de Becket, rappelle que l’oeuvre de Beckett est en train de forger un public. Public qu’on va appeler par la suite des « beckettiens », voire même des « beckettologues »… Mais l’arrivée des « beckettologues » appelle à un nouveau déplacement, cette arrivée exige de trouver autre chose qui n’a pas encore son public. Cet engagement vis-à-vis du « no man’s land » au sens de Berberova, est un engagement vis-à-vis d’une création radicale qui déplace l’attente de ce qu’on appelle le public, déjà là.
Je crois que je vais m’arrêter sur ces deux ou trois remarques. Je n’ai rien dit de l’Espace public. Mais il y aurait à lever un malentendu entre « lieu public » et « espace public ». Rapidement, quelques mots à propos de l’histoire du concept d’espace public. Espace public est une traduction française de ce qu’on appelle en allemand Oeffentlichkeit. Oeffentlichkeit, s’il fallait le traduire littéralement, ce serait la Publicité au sens noble du terme. Mais comme la publicité n’a rien de noble aujourd’hui, on n’a pas pu traduire Oeffentlichkeit par Publicité. Parce que la publicité, au sens de la réclame, c’est-à-dire la prostitution, a accaparé le concept d’Oeffentlichkeit. Donc on le traduit en français par Espace public. Mais l’Espace public originalement, ça n’a pas vraiment à voir avec des lieux publics. L’espace public commence au XVIIIe siècle avec l’échange des lettres. Le XVIIIe siècle, c’est le Siècle épistolaire.
C’est un siècle où s’invente une culture de la lettre : j’écris à toi, en travaillant sur moi, sur toi et sur notre relation, et tu me réponds également en retour, sur tous ces plans. C’est sur cet échange-là que commence à naître une série de questions sur la société : Qu’est-ce que la monarchie ? Qu’est-ceque le droit ? Est-ce que l’amour a des droits par rapport à l’argent ? etc. L’Espace public commence par des mises en question, par l’échange de lettres s’interrogeant sur les valeurs reçues, instituées. Et tout de suite après, vont naître les remarquables romans par lettres (Pamela de Richardson, la Nouvelle Héloïse de Rousseau, les Liaisons Dangereuses de Laclos). Mais les romans par lettres supposent la société de relations épistolaires. Et cette société sera contemporaine de la multiplication des Salons littéraires, des Cafés littéraires, mais aussi de la naissance des bibliothèques, soit d’une discussion intense qui va culminer avec la Révolution. Et aussi avec la Déclaration des Droits, qui sont si bafoués de nos jours, comme le rappelle régulièrement le Réseau Education Sans Frontière (que nous venons d’entendre). Déclaration des Droits, donc, et naissance d’un nouvel Espace public qui est l’espace républicain, lui-même aussi bafoué aujourd’hui.
Ce qui est important, c’est que cette idée qui énonce que par la discussion, le débat, nous pouvons tout questionner, y compris le président de la République, y compris l’Etat, y compris les lois civiles, et que nous avons le droit à la – et même le devoir de – désobéissance civile, cette idée donc, était le gage de la promesse d’un avenir pour une société de demain, meilleure que celle d’aujourd’hui. Cette promesse a été théorisée dans des petits textes politiques de Kant, où Kant dit qu’il y a une promesse d’émancipation à venir, il suffit qu’on laisse libre, ouvert l’Espace public.
Ces textes sont des textes de 1784. Or, de 1784 à 1984 vous avez Orwell. Orwell marque le roman de la fin de l’Espace public. C’est-à-dire le roman où justement il n’est plus possible de discuter librement, d’élaborer sa pensée collectivement et publiquement. Dans le romans d’Orwell, le seul résistant, Winston, c’est justement quelqu’un qui achète clandestinement un cahier et, clandestinement chez lui – parce que vous savez, ce sont des sociétés à écrans interactifs, ce qui veut dire que même étant chez vous, vous êtes épiés par les écrans du réseau communicationnel -, donc Winston chez lui, tourne le dos à l’écran pour tenir un journal intime. Et qu’est-ce que le journal intime de Winston si ce n’est justement la recherche du « no man’s land » au sens de Berberova. Winston cherche à élaborer quelque chose dont l’Etat totalitaire de 1984, ne veut rien savoir, qu’il forclot, interdit.
Or je pense, et c’est la dernière chose que je voudrais dire avant qu’on passe au débat, je pense que s’il y a une chose absolument sacrée à laquelle nous ne devrions pas laisser toucher, c’est justement le droit pour chacun d’élaborer ce qu’il doit être. C’est-à-dire, de travailler sur soi sur son « no man’s land » et de décider de comment il doit mener sa vie. C’est justement cela qui nous est de plus en plus interdit aujourd’hui, y compris dans ce dernier rempartcontre la totalisation économique qu’a été jusqu’à aujourd’hui l’Université. L’Université au sens premier du terme, cela voulait dire justement, que nous avions droit à un temps improductif pour élaborer ce que nous devons être. Une phrase célèbre d’Erasme : « On ne naît pas humain on le devient ». Or l’Université est en un sens le dernier endroit où il est encore possible d’élaborer ce devenir. C’est justement cela qu’on est en train de liquider en ce moment et vous voyez que finalement mes trois points distincts (du début ) finissent par se relier. »
Question 1 : « Si on vous suit, l’artiste serait celui qui cultive son « no man’s land ». Et s’il est dans un engagement radical vis-à-vis de ce « no man’s land » il est aussi celui qui résiste à la colonisation de son « no man’s land » par le pouvoir. Cet artiste serait donc quelqu’un qui, au quotidien, résisterait. La question ne serait alors plus celle de l’art mais celle de l’artiste. Non pas, est-ce que l’art assume des fonctions sociales, mais est-ce que l’artiste en tant qu’il est celui qui cultive son « no man’s land » assume un rôle, qui pourrait être celui d’enseigner des pratiques, des techniques de soi ? L’artiste comme celui qui a la capacité ou les moyens d’enseigner des pratiques de soi au autres ? »
Question 2 : « J’ai été sensible à ce qui vient d’être dit et je suis convaincue par ce que vous avez dit. Mais il y a un mot, une expression qui m’a gêné et que vous reprenez de Nina Berberova : « travail sur soi ». Or, qu’est-ce que le « travail sur soi » dans la société française de 2009 ? Pour moi ça évoque ce supermarché, cet hypermarché de la psycho-machin chose : « je recherche un gourou qui va m’aider à travailler sur moi » et on retombe complètement dans précisément tout ce que vous avez pointé comme étant justement l’adversaire de tout ce qui peut nous émanciper. Ne pourrait-on pas trouver une expression autre ? « Travail sur soi » évoque pour moi le marché du pseudo-individualisme. »
Plinio Walder Prado : « L’usage que je fais de l’expression « travail sur soi » n’est pas à confondre avec l’actuel marché de la psyché. Il y a chez Freud un concept de « travail » qui est essentiel pour comprendre ce qu’il appelle le fonctionnement de l’énergie libidinale, ses déplacements, investissements et contre-investissements, etc., et les possibilités d’intervenir dans ce fonctionnement, de l’élaborer ou le perlaborer, de le « travailler » ; c’est le cas par exemple de ce qu’on appelle le « travail du deuil ». « Travail » veut dire : transformation de l’énergie. Et là on pourrait à mon sens aller très sérieusement dans la direction que vous pointez. Il y a une autre expression qui dit à cet égard la même chose que « travail sur soi » et qui nous vient des Grecs : «l’epimeleia heautou », c’est-à-dire, « souci de soi ». Le souci de soi ouvre sur la question qui m’intéresse ici : qu’on peut, on doit se transformer. Il y a une phrase célèbre de Socrate, au moment où il va être condamné à mort : « Une vie sans examen ne vaut pas d’être vécue ». Le mot « examen » dans cette phrase renvoie à un auto-questionnement ou à une interrogation sur sa vie au cours de sa propre vie. C’est à cela que j’ai voulu faire allusion avec l’expression « travail sur soi ». Et cela n’a rien à voir non plus avec ce qu’on appelle aujourd’hui l’individualisme ou l’égocentrisme, bien au contraire : il n’y a pas de souci des autres, de souci de la Cité, sans le souci de soi dont nous parlons. Pierre Hadot et Michel Foucault, par exemple, se sont bien expliqués là-dessus.
Mais dans ce que vous pointez là, il y a quelque chose d’encore plus épouvantable, pour moi en tout cas, et qui est que tout les mots sont plus ou moins pris aujourd’hui. Lorsque Michel Foucault parle du souci de soi et particulièrement dans le livre « L‘herméneutique du sujet », eh bien, on peut voir la façon soigneuse avec laquelle il va travailler le concept de « souci de soi ». Or, dès qu’il commence à travailler sur ce concept, les californiens, qui sont en plein dans le marché de ce qu’ils appellent, eux la culture ou le culte du soi, voire le « souci de soi » – ce marché que vous dénoncez –, les californiens donc, disent « Mais ce que vous faites, ce que vous êtes en train d’expliquer, c’est exactement ce que nous faisons en Californie : la recherche du « vrai moi », etc., c’est le souci de soi ». Et Foucault a du mal pour essayer de faire départager ce qu’il est en train de dire d’avec ce qu’on appelle aujourd’hui « le souci de soi » sur le marché des gadgets « thérapiques ». Et je sais qu’il y a même ce qu’on appelle des philosophes, qui, à travers leurs sites, proposent la marchandise « souci de soi » moyennant une Carte Bleu à 40 euros l’heure. Il faudrait donc qu’on prenne la mesure de la gravité de cette question de l’échange, du marché qui va jusque là – jusqu’à la souffrance psychique considérée comme un marché porteur, un buisness. Et qu’on y soit vigilant.Donc je suis mille fois d’accord avec vous. Ceci dit, j’ai pris cette expression et il faut parfois parier que au-delà des mots, vous saisissiez ce que je veux dire.
En ce qui concerne ce qui a été dit auparavant (la question 1), je pense que la responsabilité de l’artiste est de répondre à la question qu’est-ce que l’art ? Chaque fois qu’un artiste va danser, ou qu’il s’assoit au piano, ou qu’il est devant une page blanche, ou devant une toile vierge, la question pour lui est d’essayer de dire qu’est-ce que la danse ? qu’est-ce que la musique ? qu’est-ce que l’écriture ? qu’est-ce que la peinture ? A chaque fois cette question est remise à plat. La question de savoir « est-ce que le public va me comprendre ? n’est pas la question de l’artiste.
J’ai travaillé avec ceux qu’on appelle des « agents culturels ». Ce sont des gens qui essayent de faire comprendre au public ce que font les artistes. Des gens qui étaient dans un état d’angoisse pénible… Il faut faire là un départage, donc, entre ce que sont les textes, « L‘innommable » par exemple de Beckett, et puis la question de savoir si dans les médias, à la radio, à la télévision il est possible de parler de « L‘innommable ». Ce sont à mon avis deux questions différentes. Or, lorsque Beckett écrit « L‘innommable », pour continuer sur cet exemple, Beckett, la « voix » qui parle à travers lui, ne cesse de répéter que ce n’est pas lui qui écrit. Il dit : je prête ma main pour que quelque chose se dise ou s’écrive à travers moi. Et ce quelque chose qui doit se dire à travers moi, ce n’est même pas des mots. Les mots sont là pour que la chose puisse se « dire », mais la chose qui doit se dire est innommable. Donc il faut être courageux pour tenir le pari d’écrire un livre qui s’appelle « L’innommable », qui a le droit de s’appeler « L’innommable ». Donc, je pense que l’artiste n’est responsable que de cette question là : qu’est-ce qu’écrire ? qu’est-ce que l’art. Et il n’a pas non plus à mon sens à enseigner quelque chose à quelqu’un. Je crois que si Beckett entendait cela il éclaterait de rire, comme il le faisait. L’artiste ne prétend enseigner rien à personne. Il prétend descendre au fond de son « no man’s land » et éprouver sa misère, ce que Beckett appelle parfois « l’insondable misère de l’être ». On n’est pas dans la pédagogie, on est dans un travail d’écoute, auprès du mystère que chacun porte en soi, que chacun est en soi.
Juste un dernier mot. Je pense que cette question du souci de soi- mais je préfère parler de « s’occuper de son no man’s land »- cette question, si elle fut ou aurait du être un des enjeux majeurs de l’Université, elle est aujourd’hui menacée plus que jamais à mon sens, y compris à l’Université. »
Question 3 : « C’était juste pour rebondir. Vous parlez du « no man’s land » et je pensait au philologue allemand Victor Klemperer qui notait les rêves des gens qu’il rencontrait sous le III Reich. On voit comment le pouvoir a la possibilité de venir investir un espace intime. Et plutôt que de poser la question : l’art assume-t-il des fonctions sociales, ce serait plutôt la question de savoir comment le public peut cultiver des moyens pour s’emparer de l’art afin de trouver des espaces imaginaire pour échapper à ce qui vient nous marteler tous les jours dans le plus intime de nous-même. Par exemple dernièrement, arteradio a récolté des rêves de jeunes femmes qui rêvent de Nicolas Sarkozy et de son couple. Ce qui est intéressant c’est comment à chaque fois ce qui se dit dans ces rêves c’est la question de l’intrusion dans l’intimité. Comment résister à ce qui vient nous hanter dans notre sommeil ? Peut-être que l’art est une possibilité de trouver des points de fuites ? »
Question 4 : « Vous disiez qu’il n’y avait pas de pédagogie possible. Est-ce que vous pensez alors qu’il n’y a pas de connaissances propre au travail artistique ? Des connaissances qui puissent être transmises ? C’est aussi la question de la technique, pour descendre en soi il doit bien exister des techniques ? »
Plinio Walder Prado : « Dans l’hypothèse que je suis ici, ce qui fait la spécificité de l’art passe par la sensibilité, c’est-à-dire ce qu’on appelle l’aisthêsis, le sentiment. Il y a à mon sens, un abîme entre cette dimension sentimentale et la dimension proprement cognitive. Si des penseurs comme Benjamin ou Adorno ont essayé de dire que la grande affaire du monde administré, le nôtre, le monde de la « vie administré », c’est la question de l’art, ce n’est pas parce que ce sont des « esthètes » ou ont je ne sais quel penchant esthétisant. C’est parce qu’ils ont perçu que le véritable enjeu est cette dimension irréductible de la sensibilité, qu’il faut protéger. Or cette dimension-là, de l’affect, croise celle de la singularité. Tout le mystère, c’est qu’on puisse partager, en dehors de la connaissance, quelque chose qui est pur sentiment. Un partage du sentiment. Kant l’a élaboré dans la Critique du jugement, c’est ce qu’il appelle une « communauté sentimentale », une « communauté de sentiments ». La communauté sentimentale, ce n’est pas la communauté scientifique, ni la communauté politique. C’est une communauté où on peut partager quelque chose dans le seul ordre de la sensibilité, par le seul sentiment, une communauté « aisthétique », comme l’est la communauté des amants. Cette idée va être reprise par Schiller et exploitée dans une perspective politique. Il dira que l’Europe n’a qu’une chance, si elle veut vraiment se constituer en tant que communauté digne de ce nom, c’est celle de construire une communauté de sentiments, façonnée par l' »éducation esthétique », et surtout pas une prétendue « communauté économique », bâtie en fait sur la guerre des intérêts. Schiller le dit en 1795. La promesse de l’art, Stendhal l’appelait « promesse de bonheur », et ce bonheur-là, c’est un partage des singularités « simplement » par le sentiment. Dès qu’on passe à la connaissance, au travail du concept, on perd cette dimension singulière irréductible. »
recevoir la newsletter
INDEX
A
Maxime Actis - Emmanuel Adely - Norman Ajari - Philippe Aigrain - Conrad Aiken - Anne-Marie Albiach - Will Alexander - Mohamed Amer Meziane - Adil Amimi - Jean-Loup Amselle - Florence Andoka - Amandine André - Antonin Artaud - Bernard Aspe - Alexis Audren - Patrizia Atzei
B
Francis Bacon - Alain Badiou - Jean-Christophe Bailly - Aïcha M’Barek - Gil Bartholeyns - Bas Jan Ader - Fabiana Bartuccelli - Georges Bataille - Jean Baudrillard - Nacera Belaza - Mathieu Bellahsen - Mustapha Benfodil - Fethi Benslama - Tal Beit-Halachmi - Mehdi Belhaj Kacem - Véronique Bergen - Augustin Berque - Jérôme Bertin - Elizabeth Bishop - Sean Bonney - Maurice Blanchot - Michel Blazy - Max Blecher - François Bon - Christophe Bonneuil - Erik Bordeleau - Hélène Bordes - Oscarine Bosquet - Dominique Boivin - Patrick Bouchain - Brassaï - Alain Brossat - Mathieu Brosseau - Judith Butler
C
Valérie Cabanes - Romain Candusso - Anna Carlier - Nicolas Carras - Jean-Philippe Cazier - Elisa Cecchinato - Boris Charmatz - Max Charvolen - Ronan Chéneau - Sonia Chiambretto - Pierre Chopinaud - Gilles Clément - Lambert Clet - Daniela Cerqui - Yves Citton - Emanuele Coccia - Benjamin Cohen - Danielle Collobert - Muriel Combes - Alain Condrieux - Mona Convert - Volmir Cordeiro - Sylvain Courtoux - Martin Crowley - Jean Paul Curnier
D
Abdelkader Damani - Eric Darsan - Jodi Dean - Justin Delareux - Raphaëlle Delaunay - Gilles Deleuze - Fabien Delisle - Christine Delphy - Philippe Descola - Vinciane Despret - Gérard Dessons - Hafiz Dhaou - Georges Didi-Huberman - Catherine Diverres - Daniel Dobbels - Elsa Dorlin - Christoph Draeger - Florent Draux - Olivier Dubois - Frédéric Dumont - Raphaël Dupin - Vincent Dupont - Marguerite Duras - Isabelle Duthoit
E
Fred L'Epée - eRikm - Jean-Michel Espitallier - Félix Boggio Ewanjé-Epée
F
Frantz Fanon - Eric Fassin - Héla Fatoumi - Claude Favre - Oliver Feltham - Denis Ferdinande - Thomas Ferrand - Federico Ferrari - Michel Foucault - Benjamin Fouché - Jean-Baptiste Fressoz
G
Jérôme Game - Liliane Giraudon - Dalie Giroux - Jean-Luc Godard - Julien Gosselin - Douglas Gordon - Sophie Gosselin - David gé Bartoli - David Graeber - Lisbeth Gruwez - Johan Grzelczyk - Félix Guattari - Frédérique Guetat Liviani - Maël Guesdon - Pierre Guyotat
H
Emilie Hache - Catherine Hass - Ian Hatcher - A.C. Hello - Gabriel Henry - Bernard Heidsieck - Hassania Himmi - Benjamin Hollander - La Horde d’or - Angélique Humbert - Pierre-Damien Huyghe
I
Charlotte Imbault - Wolfgang Iser - Taoufiq Izeddiou
J
Philippe Jaffeux - Anselm Jappe - Laurent Jarfer - Emmanuèle Jawad - Meyrem Jazouli - Adnen Jdey - Paul Jorion - Alain Jugnon - Barbara Jovino
k
Maria Kakogianni - Richard Kalisz - Anne Kawala - Mizoguchi Kenji - Rina Kenović - Razmig Keucheyan
L
Philippe Lacoue-Labarthe - Geoffroy de Lagasnerie - Virginie Lalucq - Eric Lamoureux - Josée Lapeyrère - Karl Laquit - Bruno Latour - Emmanuel Laugier - Céline Laurens - Christine Lavant - Maurizio Lazzarato - Noémi Lefebvre - Joëlle Léandre - Pascal Le Gall - Franck Leibovici - Fabienne Létang - Marius Loris - Michel Lussault
M
Marielle Macé - Stella Magliani-Belkacem - Hamid Ben Mahi - Boyan Manchev - André Markowicz - Jean-Pierre Marquet - Jean-Clet Martin - Valérie Masson-Delmote - Philippe Maurel - Béatrice Mauri - Marc Mercier - Juliette Mézenc - Olga Mesa - Etienne Michelet - Jacques-Henri Michot - Antoine Miserey - Ossama Mohammed - Marie-José Mondzain - Jacques Monory - Marlene Monteiro Freitas - Bernardo Montet - Emmanuel Moreira - Yann Moulier Boutang - Dorothée Munyaneza - Natacha Muslera
N
Mathilde Nabias - Jean Luc Nancy - Stéphane Nadaud - Nathanaël - Frédéric Neyrat - Vaslav Nijinski - Nimrod - Kettly Noël - Nox - Stephane Nowak
O
Gaëlle Obiégly - Yoko Ono - F.J Ossang - Bouchra Ouizguen - Kenny Ozier-Lafontaine
P
Giulia Palladini - Arnaud des Pallières - Pier Paolo Pasolini - Charles Pennequin - Marc Perrin - Vivian Petit - Jean-Daniel Pollet - Mathieu Potte-Bonneville - Frédéric Pouillaude - Plinio Walder Prado - Myriam Pruvot
Q
Marie de Quatrebarbes - Fanny Quément - Philippe Quesne - Nathalie Quintane
R
Walid Raad - Josep Rafanell i Orra - Yvonne Rainer - Jacques Rancière - Matt Reeck - Alexandre Roccoli - Cécile Richard - Denis Roche - Gwenola Ricordeau - Nicholas Ridout - Jacob Rogozinski - Willy Rousseau - Agnès Rouzier
S
Maxime Sacchetto - Olivier de Sagazan - Catérina Sagna - Carolina Sanin - Connie Scozzaro - Esther Salmona - Julie Sas - Gaby Saranouffi - Olivier Sarrouy - Thierry Schaffauser - Ryoko Sekiguchi - Kit Schluter - Carlo Sévéri - Hooman Sharifi - Vicky Skoumbi - Albertine Simonet - Frank Smith - Olivier Smolders - Noé Soulier - Camille Sova - Spinoza - Isabelle Stengers - Sacha Steurer - Bernard Stiegler - Ceija Stojka - Michel Surya
T
Olivia Tapiero - Louis-Georges Tin - Benoît Toqué - Yannick Torlini - Vladeck Trocherie
V
Guido Van der Werve - César Vayssié - Laura Vazquez - David Vercauteren - Marie Juliette Verga - Jérôme Vidal - Thomas Vinau
W
Laura Waddington - Sophie Wahnich - Anders Weberg - We insist
Z
Christian Zanesi - Alexis Zimmer - Nicolas Zurstrassen
-----------------------
Images
Khalik Allah - Nathalie Blanchard - Anael Chadli - Sylvain Couzinet Jacques - Alexis Delanoue - Clémentine Delahaut - Jean Frémiot - Max Kuiper - Gaétane Laurent-Darbon - Sheena J-Galan - Kenny Ozier-Lafontaine - Alice Lewis - Saadi My Mhamed - Maya Paules - Armine Rouhani - François Santerre - Alessandra d'Urso - Nicolas Vermeulin - Sadie von Paris